J’ai lu pour vous« Penser contre soi-même » de Nathan Devers paru en 2024 aux Éditions Albin Michel. Ce livre m’a ravi autant par son écriture, son caractère autobiographique et les propos de son auteur au sujet de la philosophie. J’accorde à ce livre cinq étoiles sur cinq. |
Menu de cette page
- Couvertures
- Données au catalogue
- Texte de présentation (Quatrième de couverture)
- Sommaire
- Extraits de l’œuvre
- Au sujet de l’auteur
- Du même auteur
- Revue de presse
- Mon rapport de lecture
Couvertures
Article # 138
NATHAN DEVERS
Penser contre soi-même
Palmarès Les 100 livres de l’année 2024 – Lire Magazine
Prix Cazes – Brasserie LIPP 2024
Sélection de Printemps du Prix Renaudot
Éditions Albin Michel, 2024
Données au catalogue
Penser contre soi-même
Nathan Devers
Date de sortie : 3 Janvier 2024
Auteur(s) : Nathan Devers
Éditeur : Albin Michel
Distributeur : Hachette
Date de parution : 03/01/2024
Collection : Itinéraires
EAN : 9782226483867
Nombre de pages : 336 Pages
Longueur : 20.6 cm
Largeur : 14.1 cm
Épaisseur : 2.7 cm
Poids : 438 g
Présentation
TEXTE EN QUATRIÈME DE COUVERTURE
Pourquoi la philosophie ?
Qu’apporte-t-elle à l’existence ?
Que change-t-elle à nos vies ?
Nathan Devers a voulu répondre à ces questions de manière personnelle : pourquoi, alors qu’il avait choisi de devenir rabbin au terme d’une adolescence très croyante, a-t-il perdu la foi ? Comment a-t-il pu abandonner une vocation profonde au profit d’un univers sans dogme ?
Intense et puissant, avec sa poésie mais aussi sa violence, ce récit est une vibrante invitation à philosopher, c’est-à-dire à penser contre soi-même. Une quête universelle et pourtant difficile : le désir d’échapper à ses préjugés, de bouleverser ses certitudes, d’aller au-delà de l’identité déterminée par sa naissance.
C’est l’histoire d’une rupture vécue comme une aurore. Ou comment donner du sens à un monde qui en manque.
Nathan Devers est né en 1997. Normalien et agrégé de philosophie, il a publié l’essai Espace fumeur (Grasset, 2021) et deux romans : Ciel et terre (Flammarion, 2020), Prix du Cercle interallié du premier roman, et Les liens artificiels (Albin Michel, 2022) qui a connu un grand succès. Avec Penser contre soi-même, il signe son deuxième essai.
» Un livre [..] disert, inventif, éclatant. Feu d’artifice d’écriture, il mêle intelligence et humour, rigueur et poésie. C’est brillant […]. » Roger Pol-Droit – Le Monde des livres
» Un récit brillant et intense. » La Tribune du Dimanche
Source : Éditions Albin Michel.
Sommaire
Dédicace
Exergue
Prologue
Partie I. Comment s’éteignent les commencements
- Chapitre 1
- Chapitre 2
- Chapitre 3
- Chapitre 4
- Chapitre 5
- Chapitre 6
Partie II. Les noms viennent d’ailleurs
- Chapitre 1
- Chapitre 2
- Chapitre 3
- Chapitre 4
- Chapitre 5
- Chapitre 6
- Chapitre 7
- Chapitre 8
- Chapitre 9
- Chapitre 10
- Chapitre 11
- Chapitre 12
- Chapitre 13
Partie III. À qui répond l’appel
- Chapitre 1
- Chapitre 2
- Chapitre 3
- Chapitre 4
- Chapitre 5
Partie IV. Le désert est une source
- Chapitre 1
- Chapitre 2
- Chapitre 3
- Chapitre 4
- Chapitre 5
- Chapitre 6
- Chapitre 7
- Chapitre 8
- Chapitre 9
- Chapitre 10
- Chapitre 11
Partie V. Les choses sont des mots
- Chapitre 1
- Chapitre 2
- Chapitre 3
- Chapitre 4
- Chapitre 5
- Chapitre 6
- Chapitre 7
- Chapitre 8
- Chapitre 9
- Chapitre 10
- Chapitre 11
- Chapitre 12
- Chapitre 13
Épilogue. Chercher
- Chapitre 1
- Chapitre 2
- Chapitre 3
- Chapitre 4
- Chapitre 5
- Chapitre 6
Extraits
Ces extraits sont disponibles sur le site web Immateriel.fr
Prologue
Pourquoi la philosophie ?
Chaque rentrée universitaire, j’aime introduire mes cours en posant cette question. Je ne demande pas aux étudiants de la décortiquer à la manière d’un sujet de dissertation, encore moins d’en définir les termes. Mais de parler concrètement, depuis la vérité fuyante des intuitions vécues : pourquoi avez-vous choisi de vous orienter vers cette discipline étrange, qui ne répond à aucune fonction précise dans notre société ? Comment est née cette résolution d’apprendre un non-métier ? Que signifie, pour chacun d’entre nous, un tel commencement ?
Je tiens à partir de ce dialogue car je suis convaincu que la philosophie débute ainsi : par un saut intérieur. Un élan immédiat et lointain, qui tient tantôt à des hasards, souvent à des logiques, toujours à des orages, bonjours autant qu’adieux, ruptures et aubes mêlées. Un cheminement intime qui se raconte plutôt qu’il ne s’explique. Une quête, un instinct, peu importe le nom pourvu que cette recherche soit éprouvée avant toute analyse. Cette histoire mérite d’être aventurée en soi, à la première personne, comme un voyage décidant seul du monde, des récits et des voix qui en émergeront. C’est une expérience qui nous pense à mesure qu’elle s’écrit. Car la pensée s’incarne : nos existences sont des méditations.
Il s’agirait, non de discuter dans l’abstrait, qu’est-ce que la « philosophie » ?, mais de prendre le problème à l’envers, par son aspect premier : pourquoi, comment s’y engage-t-on ? D’où vient qu’encore étrangère cette voie nous attire déjà ? Quel est ce désir inconnu que la philosophie nous inspire dès le petit matin, avant même que nous n’ayons la moindre idée de ce qu’elle représente ?
Ce jour-là, dans la salle, je sentais des bonnes ondes. Le groupe me semblait souriant, dynamique, visiblement disposé à participer, et non à transcrire mécaniquement mes propos sur des ordinateurs. Je n’eus pas à attendre longtemps pour qu’une dizaine de mains se lèvent. Il y eut d’abord François qui, dans son adolescence, avait découvert avec fascination les podcasts de France Culture. Puis Inès, une future comédienne qui rêvait d’adapter, sur scène, les dialogues de Platon. Thomas, admirateur de Marx, espérait mieux déceler la vérité dans les rapports sociaux. Mathilde, européiste convaincue, ambitionnait de comprendre les doctrines du contrat social, persuadée que la politique était une théorie appliquée. Malo, amateur de boxe, entendait se plonger dans d’intenses et éclectiques lectures. Carla, passionnée de cinéma italien, était en quête du Beau. Hermione avait hâte d’être curieuse de tout, intéressée autant par la métaphysique que par l’éthique et les sciences humaines. Natacha, humoriste en devenir, était certaine que la philosophie l’aiderait à aiguiser son regard sur le potentiel comique de l’Humanité. Jawad étudiait la médecine. Et Antoine, vétérinaire polyglotte à la retraite, consacrait son temps libre à l’épistémologie.
Personne n’avait répondu la même chose à ma question. En à peine quelques minutes, la notion de philosophie avait perdu son centre de gravité pour s’ouvrir sur un bouquet de projets divergents, d’aspirations multiples et de passions mobiles. Comme si nous étions tous là pour des raisons qui n’avaient rien à voir les unes avec les autres, réunis par coïncidence autour d’un malentendu érigé en cursus universitaire : et si la « philosophie » n’était rien d’autre qu’une volière d’ascensions plurielles – un échangeur de trajectoires, d’itinéraires où chacun s’enfonce seul, en éclaireur de soi ?
Et pourtant, cette confusion était très cohérente. Derrière la variété de nos motifs, par-delà la singularité de nos visions respectives, nous regardions tous dans la même direction. À vrai dire, nous attendions de la philosophie quelque chose de simple, d’éternellement simple et de pourtant majeur : qu’elle donne du sens au mystère de la vie. Qu’elle nous permette de traverser autrement le phénomène de l’existence humaine. Qu’elle soit avant tout l’art d’une éternelle question. Une question infinie, qui trouverait en elle-même sa propre vérité. Une question vivante, déployée en spirale, et qu’aucun dogme, qu’aucune certitude, qu’aucune tradition ne pourra jamais clore. Une question à l’image de cette matinée de pré-automne, de cette rentrée universitaire, de cette nouvelle année : une question dont on ignore parfaitement ce qui en sortira. C’est avec ces pensées que j’entrai dans le tramway, ressentant un réel plaisir à l’idée que les cours reprennent. Quel bonheur, disait Stendhal, d’avoir pour métier sa passion.
Depuis le campus universitaire de Pessac jusqu’au centre-ville de Bordeaux, le trajet était d’environ vingt minutes. J’en profitai pour appeler Anaële, ma fiancée. Mais Anaële ne répondit pas. Je réessayai une deuxième fois. Toujours rien. Alors, je téléphonai à mon frère. Pas de tonalité. Je tapai le numéro de ma mère, puis de mon père. Silence radio. J’allais commencer à m’inquiéter quand un ami m’appela. Frédéric, photographe de son état, m’informait qu’il était à Bordeaux pour une prestation. Exceptionnellement, je devais justement y dormir, à cause d’une réunion de l’École doctorale qui aurait lieu le lendemain matin. Nous convînmes de nous retrouver à l’heure du petit-déjeuner, histoire de passer un peu de bon temps avant d’aller au travail.
Arrivé place de la Victoire, profitant du début de soirée, je me suis installé à une terrasse de café. Initialement, j’avais prévu d’aller directement à l’hôtel pour y poser mon sac. Mais c’est une disposition que je tiens de ma mère : le soleil crée en moi un étrange sentiment de culpabilité, m’obligeant à tout interrompre sur-le-champ pour profiter de lui. Sinon, j’ai la mauvaise conscience du tournesol à l’ombre. Aussi, en voyant le ciel se dégager, j’oubliai ma quasi-nuit blanche de la veille et m’assis à une table vide. J’en profitai pour descendre deux ou trois verres de rouge devant un texte de Heidegger, « Que veut dire penser ? », une conférence brève, d’une trentaine de pages, inspirée par un vers de Hölderlin : « Nous sommes un signe vide de sens ». C’est le premier écrit philosophique que j’aie lu, il y a bientôt dix ans. Depuis, je le relis assez régulièrement, en me réjouissant chaque fois que certains aspects, que certaines sentences, que certains reliefs me demeurent opaques. Comme si, à chaque redécouverte, les zones d’ombre de ces pages bougeaient d’une phrase à une autre. Comme si les difficultés et les évidences s’intervertissaient sans cesse. Une heure plus tard, le soleil se cacha entre deux immeubles et je demandai l’addition.
Mon hôtel était situé à quelques rues de l’opéra. J’avais choisi ce deux-étoiles sur un comparateur de prix, car il était le moins cher à cette date. Autant dire que je ne m’attendais pas à y découvrir une suite présidentielle. Et je ne fus pas déçu. Située au troisième étage d’un immeuble vétuste, ma chambre était presque aussi sale que chez moi, avec des draps froissés, de la poussière au sol et de l’humidité. Sa fenêtre donnait sur une cour intérieure. Je l’ouvris pour griller une cigarette et aérer la pièce. Dans l’immeuble d’en face, les appartements étaient éteints, à l’exception d’un seul, en vis-à-vis, où j’entrevoyais une silhouette furtive. Dans le carré de ciel que découpaient les toits, les nuages saignaient, c’était le crépuscule. Finalement, me dis-je en allumant ma clope, cet endroit me convenait à merveille. Rien de mieux qu’un lieu sale pour se vider la tête. Et puis, au moins, je n’aurais pas envie de m’y éterniser.
J’allais refermer la fenêtre quand j’entendis cette voix. Une voix de femme, la voix de la silhouette, qui se propageait à travers la cour. La femme chantait. Elle chantait en hébreu. Elle priait en hébreu. Et me revint alors une chose que j’avais parfaitement rayée de mon esprit, qu’Anaële, mon frère et mes parents m’avaient pourtant dite la veille : aujourd’hui, c’était Yom Kippour, le jour du Grand Pardon, la fête que les Juifs célèbrent au complet, incluant les athées convaincus et les provocateurs, les incroyants rigides et les bouffeurs de porc, les apostats sincères et les débauchés du dimanche, les amnésiques de Dieu et les renégats bourrés de haine de soi, les pires défroqués et autres aquabonistes – et ce jusqu’aux derniers marginaux de la communauté, tous rattrapés à l’occasion par un je-ne-sais-quoi de gêne ou de mélancolie.
C’était Yom Kippour et je fumais ma cigarette dans une chambre moite, digérant encore mon burger du déjeuner et mes verres de bordeaux. C’était Yom Kippour et je n’y avais pas songé une seule fois de toute la journée. C’était Yom Kippour et, dans ma vie, cette date ne signifiait plus rien. J’avais tellement oblitéré le judaïsme, mon judaïsme, que je ne me souvenais même plus de l’avoir déserté. C’était Yom Kippour et, à cette heure, il ne restait plus rien de religieux en moi.
La femme continuait de prier. Je n’avais pas entendu quelqu’un chanter en hébreu depuis une éternité. Cela faisait si longtemps, en cette soirée d’automne, que cette langue avait disparu de mon environnement. J’en avais expurgé chaque élément de son : chaque nom, chaque psaume, chaque verset, chaque verbe. L’hébreu était ma culture morte, remplacée par d’autres dictionnaires, d’autres livres, d’autres chemins de vie. Et pourtant, à présent que la voix de cette femme résonnait à travers le silence, je comprenais les mots qui sortaient de sa bouche, je connaissais par cœur la supplique qui la faisait vibrer. Il y était question d’un Dieu redoutable et puissant, qu’imploraient des humains assaillis de remords, faibles et miséreux, chargés de souvenirs honteux et de mauvaise conscience – qui, jusqu’au dernier moment, imploraient leur créateur, le rappelaient à l’éternelle noce qui l’unissait à eux.
Elle se rapprocha de la fenêtre, son corps s’immisça dans mon champ de vision. Elle avait la beauté des visages mystiques. Concentrée, perdue dans sa prière, elle ne se rendait même pas compte que je l’observais. Bientôt, ses joues s’inondèrent de larmes. Ces larmes, je les avais connues. Les larmes de l’extase, ces perles au goût de sel qui se mélangent aux mots, à la fatigue du jeûne, au sentiment étrange qui résulte de ce jeûne, à la joie d’avoir faim, de sentir son corps s’alléger, disparaître, appeler le Seigneur jusqu’à n’être plus rien. Le soleil se couchait et je ne pouvais quitter cette femme du regard, de plus en plus sublime, que sa voix transformait. Elle était là, à l’ombre d’un ciel où s’ébauchait la nuit, se dressant devant moi pour invoquer un Dieu dont l’absence régnait.
En l’espace d’une fraction de seconde, je fus tenté de croire que cette femme était une apparition biblique, semblable à ces fables talmudiques où la fiancée d’Israël se révèle aux âmes égarées pour leur montrer ce qu’elles ont perdu. Tous les symboles concordaient. Moi avec ma cigarette, respirant du feu dans une chambre terne. Elle dans sa robe noire, manifestation de toutes ces Juives qui, aux quatre coins de l’Histoire, avaient protégé l’alliance d’Abraham et la loi de Moïse. Voilà qu’elle tourna la tête. Son regard se planta dans le mien et ses pupilles, écarquillées comme des astres, dardaient des rayons de sanglots. En rivières, les larmes descendaient sur sa peau, irriguaient son semblant de sourire. Nous étions face à face, debout de chaque côté du vide. Et ses larmes la rendaient aveugle à l’absence des miennes. Et sa voix construisait un mur entre nos deux visages.
En cette micro-seconde, disais-je, j’eus l’impression que nous étions tous les deux suspendus à un fil. Il suffisait que j’ouvre la bouche pour chanter avec elle. Je retrouverais aussitôt ces paroles perdues. J’entrerais de nouveau dans le royaume des mots qui tournent autour du Nom. L’alliance reviendrait et, à la dernière minute, l’histoire connaîtrait une fin différente.
Mais non. J’ai fini par claquer la fenêtre et me suis allongé sur le lit. Alors, j’ai fermé les yeux et elle m’est apparue : je revis mon ombre, celle de l’autre Nathan. Le Nathan d’il y a presque dix ans. Je le reconnus tout de suite, même s’il avait vieilli. Orné d’une barbe fournie, il me dévisageait comme on contemple un spectre. Car ce Nathan revenait de la mort. Le Nathan que je devais devenir et que j’ai condamné. Un enfant envolé la kippa sur la tête, l’aspirant rabbin que j’ai assassiné.
PARTIE I
COMMENT S’ÉTEIGNENT LES COMMENCEMENTS
Chapitre 1
Tout avait pourtant débuté un jour de Kippour. Dans ma famille, Kippour était le seul jour où nous saisissions l’occasion d’être juifs à cent pour cent, du matin jusqu’au soir et de la tête aux pieds. En l’espace de vingt-cinq heures, nous avions carte blanche : plus d’école, plus de tables de multiplication ni de conjugaison, plus de cahier de texte, plus de cartable et de trafic de feuilles Diddl dans la cour de récréation, plus d’électricité à la maison, plus d’alimentation, plus d’eau, plus de douche ni de brossage de dents. C’est-à-dire plus rien. Kippour n’était pas seulement le festin de la religion juive ; c’était l’armistice de notre vie quotidienne, où toutes nos habitudes se voyaient annulées, mises entre parenthèses.
La fête commençait la veille au soir. Ma grand-mère, qui habitait en face de chez nous, rentrait de son magasin plus tôt que prévu et préparait un dîner aussi copieux que possible, histoire d’anticiper le jeûne. Autour d’une belle table, dressée à la va-vite et dans l’excitation – l’heure avançait, nous devions avoir fini le repas avant le coucher du soleil –, nous avalions des litres d’eau en nous goinfrant de poulet. Les cuisses du volatile disparaissaient une à une, broyées par nos mâchoires pressées. Nous avions l’appétit de ceux qui sentent la privation venir.
J’étais encore à l’école primaire. Religieusement, il n’était donc pas question que je me prive de nourriture à l’image des autres. Mais je tenais absolument à imiter l’exemple des adultes – au moins à essayer, histoire de battre mon record de l’année précédente. Alors, j’ingurgitais tout ce qui défilait sous mes yeux : d’immenses tranches de pain, des galettes de riz, une demi-bouteille d’Évian, des légumes, et même des bananes, fruit dont, en règle générale, je me méfiais comme de la peste. Ma grand-mère, décelant ce manège, semblait tiraillée entre deux sentiments contradictoires. D’un côté, je bouffais comme un porc – ce qui contrastait avec mes habitudes alimentaires, plutôt dignes d’un phasme anorexique. De l’autre, je m’apprêtais à défier mon corps, j’allais l’exposer à une épreuve dangereuse, réservée uniquement aux grands et aux bien-portants. Alors, elle se résignait à me laisser faire, tout en équilibrant sa tolérance d’une salve de sentences choisies : dans la vie, il ne faut pas être excessif… Il faut faire les choses étape par étape… Ce n’est pas une bonne idée, de jeûner à ton âge… Demain, au petit-déjeuner, si tu as faim, tu manges, ok… ? Non, ne te contente pas de répondre « Hum, hum »… Dis-moi : « Je te promets, mamie »… J’étais fourbe et gentil, je répondais oui et je pensais l’inverse.
Dix-huit minutes avant le crépuscule, Kippour commençait. Je me levais de table, lourd comme ces ballons de baudruche qu’on gonfle de liquide pour en faire des bombes, presque soulagé à l’idée que, désormais, mon ventre se viderait petit à petit mais inexorablement, semblable à un sablier où s’écoulerait une poudre invisible, la poudre de tous les fardeaux auxquels le corps était soumis le restant de l’année. Et, pour l’heure, à demi somnolents, nous marchions vers la synagogue le pas maladroit, tanguant comme des pendules, oscillant entre deux attentes incompatibles : la hâte d’avoir faim, la crainte des épreuves que cette hâte masquait.
Ce soir-là, les rues d’Auteuil étaient méconnaissables. Aux alentours de dix-neuf heures, elles se peuplaient soudain de petits groupes qui portaient une kippa et tenaient des livres de prières sur la couverture desquels trônaient des lettres hébraïques. Pour l’occasion, ils s’étaient endimanchés : costume noir et chemise blanche – ce qui, ajouté à leur pas chancelant, leur donnait de vagues airs de manchots empereurs. À mesure que nous remontions la rue Molitor, je m’étonnais auprès de mes parents de voir autant de Juifs autour de moi : mais où étaient-ils le reste de l’année ? C’était ça, Kippour, le seul jour où les Juifs existaient ? J’observais tous ces visages, sidéré d’en reconnaître certains : comment aurais-je pu deviner que le boulanger d’en bas était de notre peuple ? Lui qui vendait des jambon-beurre et des quiches lorraines ? Et ma maîtresse d’école, juive aussi ! Elle, Christine Lantier, qui nous racontait l’histoire de Vercingétorix comme s’il s’agissait de son ancêtre ! C’était à se demander si je ne rêvais pas… Mais non, aussi incroyable que cela puisse paraître, cette procession aux allures de parade Disney n’était pas une hallucination. Une fois par an, les Juifs d’Auteuil convergeaient en famille vers la synagogue, telles les fourmis regagnant leur cité souterraine après s’être éparpillées dehors, camouflées dans le monde comme des caméléons. Des fourmis-caméléons qui décidaient subitement de tomber le masque ensemble pour se déguiser en pingouins, voilà à quoi ressemblait le cortège des Juifs de Kippour dans le sud du XVIe arrondissement.
Car Auteuil n’était pas un quartier comme les autres : c’était un quartier profondément juif, mais secrètement juif – le quartier de Paris, et peut-être de France, où l’on comptait le plus de Juifs qui se comportaient comme des non-Juifs. À la différence de Passy et Neuilly, où les Juifs affirmaient davantage leur culture, du XIXe, où ils étaient plus pratiquants, et du Marais, où ils habitaient depuis des siècles, Auteuil était un quartier de Juifs de Kippour, c’est-à-dire de Juifs sans kippa, de Juifs sans accent, de Juifs sans hébreu, de Juifs sans Torah, de Juifs sans judaïsme – bref, de Juifs qui n’étaient jamais juifs. Auteuil, la Jérusalem des Juifs assimilés.
Notre synagogue, à Auteuil, n’était pas non plus une synagogue semblable aux autres synagogues. Elle s’appelait l’ENIO, l’École normale israélite orientale, et avait été fondée à la fin du XIXe siècle, à l’époque où, israélites jusqu’au bout des ongles, les Juifs de France se rêvaient normaliens. En apparence, d’ailleurs, l’ENIO n’avait rien d’un endroit religieux. Située dans un immeuble aussi banal que les autres, où s’était éteint le vénérable maréchal Foch, elle avait abrité pendant des décennies un collège-lycée dont le proviseur n’était autre qu’Emmanuel Levinas. Le philosophe avait passé sa vie à conjuguer les trésors de la pensée occidentale et ceux de la littérature juive ; il éduquait les pensionnaires de l’ENIO dans l’esprit de cette synthèse, les incitant à lire pêle-mêle Gogol et le Talmud, Descartes et le Cantique des cantiques. Dans ce lieu, la Bible côtoyait Victor Hugo depuis toujours ; il s’agissait des deux versants d’une même soif d’érudition. Pour cette raison, l’ENIO des années 1970 avait réussi un immense coup de force. Comme une parenthèse dans l’histoire des nations, elle avait conjugué deux recherches opposées : celle du grec ancien et celle de l’araméen. L’exigence d’Athènes et celle de Sion.
Depuis la mort de Levinas, et donc depuis ma naissance, les choses avaient un peu changé. Disons que l’école avait fermé, que l’exigence avait tari, que l’immeuble avait vieilli – et qu’il ne restait plus de l’ENIO qu’un sous-sol aux odeurs caverneuses, où s’improvisait une salle de prière peu fréquentée par les Juifs du quartier, sauf le jour de Kippour. Outre cette anomalie, l’ENIO était la seule synagogue de France où il n’y avait pas de rabbin. En théorie, l’ENIO fonctionnait comme une république, où chacun venait tel qu’il était, avec ses qualités et ses défauts, ses grandeurs et ses petitesses, et où personne ne se drapait dans la posture du prêtre. Dans les faits, bien sûr, cette absence de rabbin avait souvent l’effet inverse. Faute d’un chef unique, le pouvoir se répartissait entre trois ou quatre piliers de la communauté, qui avaient leurs affidés et leurs chouchous, leurs querelles permanentes et leurs tensions rivales. À cet égard, la liturgie suscitait sans cesse des luttes d’autorité, si bien que les offices se déroulaient comme des champs de bataille. Souvent, les rituels, aussi minimes fussent-ils, déclenchaient des tentatives de coup d’État plus ou moins maladroites : Choukroune essayait de psalmodier plus fort que Taieb, Benchetrit s’égosillait pour qu’on adopte ses mélodies tunisiennes, Guedj persiflait que les Juifs tunisiens ne savaient pas chanter, Touati et Sebbane prenaient un malin plaisir à corriger l’articulation approximative de Darmon, Cohen demandait à Lévi d’arrêter de bavarder avec Mamane, Larredo reprochait à Cohen de bavarder avec Lévi – et ainsi de suite jusqu’à ce que tout le monde s’en veuille. Arrivait toujours le moment fatidique. La goutte d’eau qui faisait déborder le vase. Le casus belli. Chaque année, c’était Benkemoun et Chétrit qui se chargeaient de transformer l’anarchie en guerre civile : ils se disputaient pour monter sur l’estrade au moment des bénédictions. Benkemoun disait à Chétrit qu’il se prenait pour une star de l’Eurovision. Chétrit répondait à Benkemoun qu’il chantait comme la Castafiore. Alors, Benkemoun prenait ses meilleurs airs de tragédien. Feignant de pleurer, il sortait de la synagogue accompagné de toute sa famille et poussait des hurlements outragés : « Plus jamais vous ne me verrez dans ce sous- sol miteux ! ». Dix minutes plus tard, mi-penaud mi-triomphant, il revenait s’asseoir sur son siège – et, après moult embrassades et réconciliations, Chétrit, magnanime comme un lion victorieux mais investi d’un zeste de culpabilité, le suppliait de bien vouloir chanter.
Bien sûr, quand nous allions à la synagogue pour Kippour, toutes ces intrigues m’échappaient. Moi qui savais à peine lire, je ne comprenais pas grand-chose aux coulisses de cette fourmilière. D’ailleurs, je ne connaissais même pas le nom des personnages que, d’année en année, je retrouvais identiques, assis à la même chaise, chantant les mêmes prières avec les mêmes intonations, exprimant les mêmes mimiques, vêtus du même costume et des mêmes rictus. Alors, fasciné par la manière dont ils ne changeaient pas, émerveillé par leur allure de statues éternelles, je m’amusais à leur donner des surnoms. Il y avait d’abord le Roseau, un homme d’une soixantaine d’années qui priait tantôt en se balançant d’avant en arrière, tantôt en chavirant de gauche à droite, tantôt en pivotant d’un côté et de l’autre. Comme si son corps ployait et se courbait sous l’effet d’un vent invisible. Et comme s’il se soumettait de bonne grâce aux élans de ce souffle. Car, malgré son déhanchement constant, le Roseau ne cessait jamais de tenir sagement son livre de prières ouvert entre ses mains, dont il récitait pourtant le contenu par cœur. À sa droite, un visage de cire au front dégarni, au sourire éclatant et carnassier ; je l’appelais l’Acide, tant ses mâchoires me paraissaient crispées. Devant lui, assis au premier rang, l’un des trois califes de l’ENIO : le Kiffeur. Je le désignais ainsi car, malgré le sérieux avec lequel il présidait l’office, je ne pouvais m’empêcher de l’imaginer allongé sur un transat à Juan-les-Pins, en train de draguer des mamies et de fumer des cigarettes fines. Ses cheveux, plaqués en arrière sous une kippa noire, étaient encore gris – ce qui, comparé aux autres familiers de l’ENIO, faisait de lui un pré-adolescent. Quand il priait, son visage était sans cesse traversé par des tics qui semblaient rythmer les accents de sa voix rêche. À côté de lui, le deuxième calife de la synagogue : Papa-Triste, un sosie de mon père en triste. Si mon père était un sosie du jeune Woody Allen, Papa-Triste était son sosie au deuxième degré, à ceci près qu’avec ses yeux de chien battu et les commissures de ses lèvres pendantes, il semblait abattu par la vie. Enfin, à droite de Papa-Triste, le troisième calife du sous-sol, le plus fascinant d’entre tous : un homme que j’hésitais à baptiser Baba ou Obélix. Pourquoi Baba ? Parce qu’il enlaçait les gens en ponctuant ses câlins d’une phrase mystérieuse : « Comment ça va, Baba ! » (J’insiste sur le point d’exclamation ; chez lui, « Comment ça va » n’était pas une question, mais une véritable apostrophe, un ordre tacite). Pourquoi Obélix ? Non seulement parce qu’il était physiquement enveloppé, mais surtout parce que ce monsieur semblait être tombé dans le chaudron du judaïsme quand il était petit. Je me souviens aussi qu’il était le plus hyperactif de tous. Il parlait toujours très fort, chantait l’hébreu avec une voix de muezzin et n’hésitait pas à tancer violemment les autres quand ils commettaient une erreur de prononciation. C’était le plus captivant de cette confrérie.
Mais le personnage principal de l’ENIO n’avait pas de visage, ni même de surnom. Il s’agissait de celui pour lequel nous étions tous là. À savoir Dieu lui-même, invisible et nommé du début à la fin. Oui, je ressentais, du plus profond de mon cœur, l’émergence de Dieu dans cette cave miteuse. Non qu’il fût présent en soi dans notre synagogue, incorporé au lieu, caché sous les meubles à la manière d’une ombre. Rien, parmi les chaises, les tapis et les meubles n’indiquait qu’y logeait l’Éternel. Il surgissait plutôt comme un don de la langue, l’habitant de nos mots. Car les prières de Kippour étaient d’une intensité rare : nous étions tous là à supplier le créateur de l’univers d’accepter que nous l’aimions. Nous criions de toutes nos forces, nous trémulions et chantions à tue-tête. Dieu ne répondait pas, mais nous continuions. Pour qu’il nous écoute, nous lui rappelions les épreuves de nos ancêtres. Le jour où Abraham faillit égorger son propre fils sur l’autel du mont Moriah… La constance avec laquelle Isaac n’avait jamais quitté la terre d’Israël… L’énergie folle que Jacob déploya pour rester fidèle à la plénitude de sa mission… Puis la servitude en Égypte. Le courage des Hébreux qui s’aventurèrent dans le désert… La force de David et de Salomon qui construisirent la ville de Jérusalem… L’exil… Les persécutions… Les massacres… L’attente… Le désespoir… La fidélité à l’alliance contractée… Nous ne demandions rien… Seulement qu’il nous entende… Depuis le 6 de la rue Michel-Ange, en cette aube du troisième millénaire, des centaines de Juifs se réunissaient pour Dieu. Collés comme des sardines dans les tréfonds d’un souterrain humide, nos prières s’élevaient jusqu’au ciel. Elles brûlaient jusqu’à l’être qui dépassait tous les cieux.
Enveloppé sous son châle, mon père m’expliquait comment fonctionnait la prière juive. En règle générale, les enfants ne traînaient pas dans la synagogue : ils s’y montraient dix minutes pour faire bonne figure et se rejoignaient ensuite au rez-de-chaussée pour discuter entre eux de la dernière Game-Boy, de leurs chaussures hors de prix et des conneries qu’ils faisaient à l’école. En ce qui me concernait, je ne voulais pas rater une seule seconde de ce qui se jouait là. Je restais à la synagogue jusqu’au dernier moment. Je sentais, sans me le formuler, que le jour de Kippour était le plus beau, le seul qui comptait vraiment dans ma naissante vie.
À vrai dire, il y avait bien une chose qui me gênait un peu : pourquoi demandions-nous pardon à Dieu alors que nous reprendrions le cours de notre vie normale dès le lendemain ? Je regardais tous ces Juifs qui respectaient Kippour. À mesure que s’écoulaient les heures, ils se déversaient à l’ENIO, de plus en plus nombreux, de plus en plus bruyants. Bientôt, un parfum de sueur s’emparait du sous-sol. À droite et à gauche, des centaines, des milliers de Juifs de Kippour se dressaient, tous plus endimanchés les uns que les autres, tous plus fiers d’avoir répondu à l’appel du Pardon. Ils jacassaient, ils piaillaient, ils racontaient leur vie, ils paradaient entre eux, ils se prenaient en photo avec les yeux. On aurait dit qu’ils étaient contents d’avoir l’occasion de retrouver leur judaïsme une fois par an, histoire de se sentir en paix avec eux-mêmes, de se rassurer à l’idée qu’ils perpétuaient des habitudes millénaires. Ils savaient pertinemment que, quand Kippour serait fini, ils rentreraient chez eux et retrouveraient leur train-train : ils mangeraient de la viande interdite, ils ne prieraient plus, ils ne porteraient pas leur kippa, ils ne respecteraient ni le shabbat ni aucune des lois juives. S’ils se repentaient, c’était pour mieux récidiver en toute bonne conscience. Un peu comme quand je jurais à mes parents de ne plus faire de bêtises, tout en prévoyant dans ma tête le moment où je recommencerais… Que valaient ces excuses exprimées par des gens qui ne les pensaient pas ? N’étaient-elles pas des mensonges ? Mais alors, à quoi ressemblait notre synagogue, sinon à un théâtre, un bal de conventions – un grand jeu pour adultes ?
C’est ainsi que, du haut de ma petite enfance, je me fis un serment. En ce qui me concernait, je ne serais pas juif au gré de mes caprices. Il me faudrait trancher : me lier à Dieu à cent pour cent ou à zéro pour cent, mais je ne tricherais pas.
Avec le recul, je n’ai pas vraiment changé d’avis : la religion, telle que je la conçois, est tout sauf un amas de traditions folkloriques, une occupation communautaire ou une identité. C’est une liaison avec Dieu, impliquant de s’y engager de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Je continue de penser qu’il est incohérent de se comporter trois cent soixante quatre jours sans obéir aux commandements religieux et d’utiliser la journée restante pour s’en faire excuser. On ne peut pas célébrer Kippour et rentrer chez soi comme si de rien n’était. On ne peut pas être juif à la carte, en sélectionnant ce qui séduit dedans. On ne peut pas être juif par pur automatisme, par désir mimétique de se sentir juif, sans savoir ce que ce vocable recouvre. Car l’alternative est simple : ou vous pénétrez dans la question de Dieu, en admettant la divinité de la loi de Moïse, et vous la reconnaissez comme vôtre, quelles que soient les épreuves. Ou vous n’y pénétrez pas, et vous la rejetez en bloc, quelle que soit votre culpabilité. Orthodoxe ou rien. En matière de religion, il ne saurait y avoir d’entre-deux ou de demi-mesure, à moins d’être un tartuffe doublé d’un paresseux. Comment pourrait-on prendre à la légère une chose aussi essentielle que le sens de la vie ?
Ce refus de composer ne m’a jamais quitté. Mon aversion pour la demi-mesure, les concessions et les conforts mentaux serait à l’origine de mon devenir-rabbin. Elle engendrerait aussi ma rupture avec cet univers. Flamme d’un rouge absolu, elle ferait de moi le dévoré de mon intransigeance : l’embrasé et l’éteint d’un incendie-éclair. D’un extrême à l’autre sans passer par le centre.
Chapitre 2
Un mot sur ma famille : le détour par la généalogie s’avère inévitable pour comprendre, comme dirait Sartre, ce que j’ai fait de ce que les autres ont fait de moi.
L’histoire de mes ancêtres n’avait été qu’une longue succession d’exils imprévus, de départs soudains et de pays perdus. Il n’y avait pas une seule nation du pourtour méditerranéen dont ils n’avaient pas été expulsés à une époque ou une autre : mes ancêtres étaient des ostracisés en chef, experts en valises et en déménagements, sans cesse chassés par leurs voisins à grands coups de pied dans le cul. Ils avaient les fesses dures et l’œil sentimental. D’un siècle à l’autre, ils construisaient des châteaux de sable et s’étonnaient de les voir s’effondrer. Éternels locataires, docteurs en nomadisme, ils traînaient avec eux leur destin d’algues déracinées. Comme des nénuphars, ils dérivaient sur le lac de l’Histoire. Aussi, ils parlaient un dialecte impossible, absurde et absent des encyclopédies : le judio. Prenez toutes les langues du monde, mélangez-les, faites-les cuire ensemble, secouez bien le résultat et vous obtiendrez ce sabir incroyable. Il y avait de tout, dans le judio : de l’espagnol travesti en arabe, des restes d’hébreu transformés en berbère, peut-être même du chinois ou de l’indonésien. C’était un concentré de la parole humaine.
Le dernier pays où les miens vécurent avant de s’installer en France se situait en face d’Alicante, à une nuit de bateau des côtes andalouses : l’Algérie, rivage où un aïeul dont j’ignore jusqu’au nom avait échoué au terme d’interminables pérégrinations. Entre lui et la région d’Oran, ce fut le coup de foudre. Non que cette terre fût plus sûre que les autres. Mais le désert s’y traduisait en criques. Mais le soleil y brûlait à l’ombre des montagnes. Mais la mer y nageait entre les plantations. Alors, mes aînés s’installèrent dans le pourtour d’Oran, les uns aux environs de Mostaganem, les autres du côté d’Arzew, les derniers en contrebas du fort de Santa-Cruz. Les saisons passèrent et, un jour, on entendit des canons et des instituteurs : la France débarquait. Quarante ans plus tard, les Juifs d’Algérie avaient opté pour un nouveau déguisement : Mahlouf s’appelait désormais Jean-Christophe et Mahloufa Jean-Christine. À Oran, les Juifs se regroupèrent dans un quartier dont il ne reste, aujourd’hui, que des ruines et des cendres. Ils s’établirent autour de l’opéra municipal et édifièrent, à quelques rues de là, une immense synagogue aux airs de cathédrale. Directement inspirée des monuments toscans, elle avait la réputation d’être la plus belle d’Afrique. Dans son style baroque, elle cristallisait toutes les civilisations dont ces Juifs se souvenaient encore. Semblable à un navire encalminé, sa façade gardait la cicatrice de Jérusalem et d’Istanbul, de Grenade et de Rome. Cette synagogue-paquebot était un Titanic sans mer à traverser et sans destination.
Mes ancêtres n’étaient pas riches. Vendeurs ambulants, ils avaient fini par acheter un bazar situé à l’autre bout de la ville, dans le quartier de Miramar, là où les artères commerçantes s’improvisaient impasses. Ils y écoulaient un peu de tout et de n’importe quoi : des poupées et des bâtons de bois, des oranges et des bouts de ficelle. Pas de quoi se payer des virées à l’autre bout du monde, mais ils se contentaient d’escapades dans la forêt de Canastel. Parfois, il leur arrivait même de partir en vacances du côté de la métropole. Je crois qu’ils s’y plaisaient déjà beaucoup : l’un d’entre eux, rasséréné par l’air de Verdun, y perdit ses poumons en 1917, laissant derrière lui une famille d’orphelins.
Quelque vingt ans plus tard, par un beau matin d’automne, ces orphelins eurent une drôle de surprise : tout Jean-Christophe et Jean-Christine qu’ils étaient, la France les traitait désormais comme des pestiférés. Mes arrière-grands-parents, Armand et Paulette, venaient de se marier. Les noces étaient à peine consommées qu’Armand se vit convoqué à un nouveau voyage : direction Bedeau, l’un des rares camps de concentration d’Algérie. Là-bas, le service laissait un peu à désirer, raison pour laquelle, jusqu’au soir de sa vie, Armand demeura muet à propos de cette période de captivité. Quand les Américains le rendirent à ses habits civils après avoir libéré l’Algérie, ils lui donnèrent un nouvel uniforme et l’envoyèrent sur la côte d’Azur où, en guise de touristes, il fut attendu par des Allemands fort peu vacanciers. C’est ainsi que, de retour à Oran en 1945, Armand était l’un des rares Juifs à avoir connu à la fois les pyjamas rayés et le Débarquement. Entre-temps, son sosie miniature avait appris quelques mots de judio : Gérald, un bébé de trois ans qu’il n’avait pas vu grandir.
Trois ans plus tard naquit Geneviève, ma grand-mère, une petite fille qui dansait sur les toits et retombait sur ses pattes quand elle dégringolait. Quand elle eut six ans, Armand dépensa douze mois d’économies pour acheter une caméra dernier cri. Pendant que Geneviève se pétait la gueule en souriant sur les rochers d’Aïn El Turk, pendant qu’elle grimpait aux arbres déguisée en princesse, pendant que Paulette accouchait d’Yves, Armand les regardait d’un œil. De l’autre, il réglait son appareil, veillant à immortaliser toutes ces scènes de vie. Car autour de lui, il sentait peu à peu le vent tourner et souffler vers le nord. Ses amis, qui n’avaient pas tous eu la chance de voyager entre 1942 et 1944, le prenaient pour un paranoïaque ou un oiseau de malheur. Il n’empêche qu’Armand s’entêta. Un jour, s’écriait-il à tout bout de champ, il faudrait déguerpir. Ce n’était pas la première fois, certes, qu’on colonisait le sol d’Algérie. Mais jamais les colons ne s’étaient autant pris pour des libérateurs.
Par une matinée radieuse, en 1961, Armand et Paulette décidèrent de reprendre le large. Cette fois, ils emmenèrent leurs trois enfants et deux petites valises. À sept heures du matin, ils s’habillèrent en vitesse et allèrent dire aux voisins qu’ils seraient de retour la semaine prochaine. Puis ils montèrent dans une voiture et, depuis la lucarne, Geneviève aperçut sa chambre s’éloigner. Alors que les côtes algériennes disparaissaient à l’horizon, l’écho d’une explosion fut camouflé par le tango des vagues : une bombe venait de faire sauter l’immeuble où ils avaient vécu.
Chapitre 3
Cela faisait deux mille ans que les Juifs passaient leur temps à déplacer Jérusalem partout dans leur exil. D’Alexandrie à Séville, de Vilnius à Tétouan, de Moscou à New York, ils s’évertuaient à construire une galaxie de micro-Jérusalem. Ils s’inventaient des capitales de substitution qui ne remplaçaient rien. Toutes plus fragiles les unes que les autres, ces Sion en trompe-l’œil finissaient toujours par retrouver leur vocation de ruines. Au bout d’un ou deux siècles, elles prenaient feu, disparaissaient des mémoires et du globe. Alors, les Juifs continuaient de voyager. De génération en génération, ils migraient de Jérusalem fictives en fausses Jérusalem. Si bien qu’au bout du compte ils multipliaient à l’infini l’image de leur Jérusalem. Jérusalem : ce nom finissait par désigner toutes les villes où ils avaient vécu.
Sur le bateau, Armand et Paulette refusèrent de se mêler aux autres passagers, qui s’agglutinaient sur le pont pour dire adieu aux rivages d’Algérie. Cette terre acide venait de les vomir, le passé était mort. Au lieu de se languir de ce rejet de greffe, ils se tournèrent ensemble du côté de la proue. Dans leur dos, l’Afrique disparaissait, et ses faubourgs qui les avaient chassés. Mais cela ne les regardait plus. L’avenir dans les yeux, ils observaient la mer. En cette aube spéciale, l’eau scintillait à perte de vue, pleine de cristaux de toutes les couleurs. Elle ressemblait à un ciel endurci, à un paradis de nuages liquides qui flottaient indécis. Ils ne s’y trompaient pas : ce ciel de flotte cotonneux et ductile était leur seul appui. La nuée que traversent ceux qui ne naîtront jamais sur leur terre natale.
Où aller ? Quels mirages épouser ? Quelles illusions choisir ? Où transporter, une fois de plus, leur capitale de souvenirs éteints et de chimères errantes ? Quelle énième Jérusalem faudrait-il romancer ? Telles furent les questions que leur voyage posait. Ils avaient trois enfants. Au fil des années, chacun d’entre eux y répondrait d’une façon différente. Dès lors, l’avenir de ma famille, c’est-à-dire de mes songes, se répartirait comme une constellation, autour de trois étoiles où se miraient des rêves.
Il y aurait d’abord Nice.
C’est à Nice, en effet, que glissait le bateau. Euphorie immédiate en arrivant au port, puis en déambulant de boulevards en ruelles. Contrairement à Oran, qui surplombait les flots sans jamais s’y pencher, Nice s’allongeait tout entière sur la mer, ouvrant grand les bras de ses immeubles aux rayons du soleil. Cette ville était nue : pleine de fleurs, elle s’offrait à une fête de lumière et d’écume. Aussi, en découvrant la Promenade des Anglais, au milieu des casinos clinquants et des palaces dorés, des plages lascives et des marchés italiens, Armand et Paulette se sentirent pousser des ailes. Cinquante ans était un âge pour tout recommencer. De plus en plus débrouillard, Armand ne tarda pas à rebondir : cet éternel déménageur se reconvertit dans la vente de meubles. Un jour, le négoce porterait ses fruits. En attendant, Gérald étudiait la pharmacie, Geneviève allait au lycée et Yves au collège. Tous exilés de l’exil, ils adoptèrent à merveille cette seconde vie. Les étés s’écoulaient, Nice devenait peu à peu une terre où s’aimer.
Ces extraits sont disponibles sur le site web Immateriel.fr
Au sujet de l’auteur
NATHAN DEVERS
Nathan Devers, pseudonyme de Nathan Naccache,
né le 8 décembre 1997, est un écrivain français.
Nathan Devers est né en 1997. Normalien et agrégé de philosophie, il a publié l’essai Espace fumeur (Grasset, 2021) et deux romans : Ciel et terre (Flammarion, 2020), Prix du Cercle interallié du premier roman, et Les liens artificiels (Albin Michel, 2022) qui a connu un grand succès. Avec Penser contre soi-même, il signe son deuxième essai.
Page Instagram de Nathan Devers
Page Wikipédia de Nathan Devers
Page Facebook de Nathan Devers
* * *
Page de Nathan Devers (Nathan Naccache) sur le site web de l’École Normale Supérieure
Conférence « Le livre à l’ère du tweet », 18 mai 2017 – Séance dans le cadre du séminaire Actualité Critique de l’ENS, introduite par Emmanuelle Sordet et Frédéric Worms , avec les interventions de Déborah Lévy-Bertherat (maître de conférence au LILA à l’ENS), Nathan Naccache (élève à l’ENS), Lénaïg Cariou (élève à l’ENS) et Sandra Lucbert (auteure de La Toile chez Gallimard).
Conférence « Le Louvre Abou Dhabi, musée miroir ? » Par Alexandre Kazerouni, chercheur à l’ENS, politologue, spécialiste du monde musulman contemporain et des pays du pourtour du golfe Persique en particulier. Séance introduite par Nathan Naccache, élève au département de philosophie de l’ENS.
Du même auteur

Beaux livres
Les Ruines de Paris
Nathan Devers
Photographe : Yves Marchand
Photographe : Romain Meffre
Extrait
Prix J’aime le livre d’art 2024 – Décerné par un jury de 400 libraires
» L’ouvrage à offrir à tous les fans inconditionnels d’Urbex. » Page des Libraires
» Un grand album d’images d’un Paris imaginaire. […]. Chaque image est maginifique dans sa désolation romantique. » Le Nouvel Obs
Sélection 15 pépites sous le sapin – Aujourd’hui en France-Le Parisien
Les photographes Yves Marchand et Romain Meffre, grands spécialistes de l’urbex, explorent les limites actuelles des possibilités offertes par l’intelligence artificielle pour fantasmer un Paris abandonné. Leurs images poétiques et spectaculaires incarnent, par leur réalisme, nos inquiétudes face à l’IA, tant on pourrait croire qu’elle permet en effet de « photographier l’avenir », comme le souligne l’écrivain philosophe Nathan Devers qui signe le texte de cet ouvrage unique.
« À la fois projection et incarnation de nos craintes apocalyptiques, au moment même de la généralisation majeure des intelligences artificielles, les ruines de Paris sont la métaphore visuelle de cette inquiétude. » Romain Meffre et Yves Marchand
« Les ruines dialoguent avec l’imaginaire. Ruines de toujours, bien sûr : Pompéi. Ruines fraîches, encore un peu saignantes : un bout de mur à Berlin. Ruines d’avenir, surtout : l’idée de notre mort, l’image de cette idée. À quoi cette image pourrait-elle ressembler ? Peut-être aux rues de Paris telles qu’elles seront demain, imaginées par Marchand et Meffre. » Nathan Devers
L’ouvrage est un objet original, imaginé à la manière d’un journal ancien (pour rappeler ceux de l’époque de la Commune où de nombreux monuments parisiens ont été en ruines), imprimé sur papier offset, avec une couverture souple et la couture de reliure apparente sur le dos.
Source : Éditions Albin Michel.
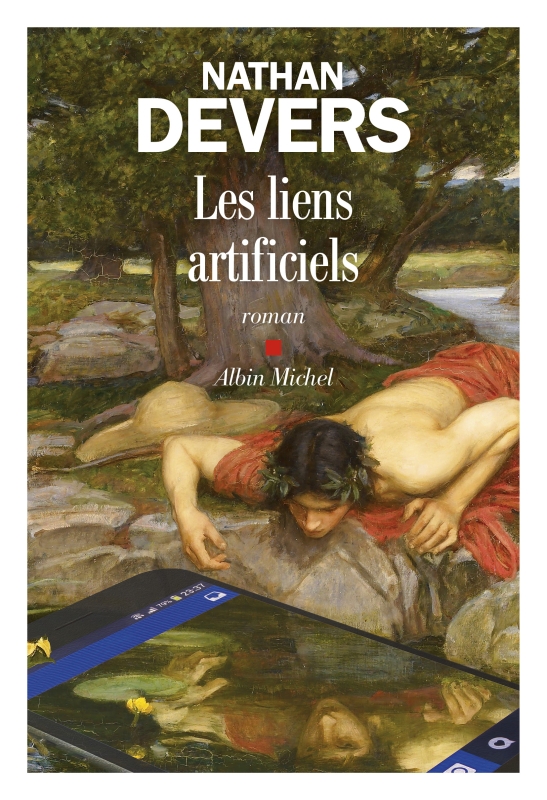
Romans français
Les Liens artificiels
Nathan Devers
Finaliste Goncourt des Lycéens
Sélectionné pour le Prix Goncourt
Extrait
« Il fallait la raconter, cette spirale. La spirale de ceux qui tournent en rond entre le virtuel et la réalité. Qui perdent pied à mesure que s’estompe la frontière entre les écrans et les choses, les mirages et le réel, le monde et les réseaux. Le cercle vicieux d’une génération qui se connecte à tout, excepté à la vie. » N.D.
Alors que Julien s’enlise dans son petit quotidien, il découvre en ligne un monde « miroir » d’une précision diabolique où tout est possible : une seconde chance pour devenir ce qu’il aurait rêvé être…
Bienvenue dans l’Antimonde.
» Si vous n’avez rien compris au métavers, ce roman est pour vous. » Le Point
Choix Goncourt de l’Orient 2022
Choix Goncourt de L’Italie 2022
Choix Goncourt de l’Algérie 2022
Source : Éditions Albin Michel.
CHEZ D’AUTRES ÉDITEURS
(Cliquez sur les couvertures)
Comment naît une religion ? Quelles épreuves doit-elle traverser pour transposer la foi d’un fondateur spirituel en une structure sociale orchestrée autour du sacré ? Par quels processus parvient-elle à faire fructifier son héritage et à s’imposer comme liaison des hommes avec Dieu ? À quel prix la religion peut-elle devenir l’affaire d’un peuple ?
Entreprendre une généalogie de la religion, c’est assigner à la philosophie la tâche d’une démarche démystifiante : il s’agit de considérer la religion non comme résultat d’une histoire, mais comme source de celle-ci et comme processus. Dans cet essai, Nathan Devers se propose de « relire la Bible, à travers elle et contre elle ». Il revisite la trajectoire qui mène de l’inspiration solitaire d’Abraham à la révélation universelle de Moïse – et il s’attache à montrer qu’à cet égard, la religion, symbiose de l’idolâtrie et de son propre refus, se déploie dans la nostalgie d’un rendez-vous manqué avec Dieu.
Élève à l’École Normale Supérieure, Nathan Devers, codirige le séminaire d’élèves « Lectures de Heidegger », et se destine à la philosophie ainsi qu’à l’écriture.
Généalogie de la religion, Cerf, 2019, 252 p. (ISBN 978-2-2041-3399-9).
« Il y a quelques mois, j’étais encore un graphiste comme on en trouve des milliers à Paris. Et voici que j’ai tout abandonné, mon travail, mes tableaux numériques, mes amis – et ce pour quelle raison ? J’ai tout simplement habité en face d’un cimetière et j’ai passé un an à vivre sous sa fascination. Si je racontais cette histoire à quelqu’un, qui me prendrait au sérieux ? »
Cette histoire, c’est celle de Léonard, qui, en emménageant dans cet appartement, arrêtera aussi de fumer, se mettra à la musculation et aux jeux de hasard, et tentera de retrouver Alma, son premier amour. Est-ce la présence de ces morts, tout proches, qui l’incite à bouleverser sa vie ?
Dans ce singulier premier roman aux allures de quête existentielle, Nathan Devers rapproche les vivants et les morts pour tenter de faire émerger un sens à cette agitation que peut constituer la vie – entre ciel et terre.
Littérature française
Paru le 03/06/2020
Genre : Littérature française
192 pages – 137 x 209 mm Broché EAN : 9782081504301 ISBN : 9782081504301
Ciel et terre, Flammarion, 2020, 190 p. (ISBN 978-2-0815-0430-1).
Ce n’est ni une apologie du tabac ni un traité hygiéniste, mais un hommage, teinté d’humour et de mélancolie, adressé à cette espèce en voie de disparition qu’incarnent les fumeurs.
Peut-on s’arrêter de fumer sans oublier le fumeur qu’on a été ?
Dans ce livre à mi-chemin entre l’essai et le récit, Nathan Devers raconte sa vie à la lumière de la relation qu’il a entretenue, pendant plus de dix ans, avec le tabac. Il revient sur des expériences qu’ont sans doute partagées la plupart des fumeurs : la première cigarette, l’apparition de la dépendance, ses effets bénéfiques et néfastes, l’incapacité de faire quoi que ce soit sans « en allumer une », les vaines tentatives de sevrage – et puis l’invention d’une méthode, résolument personnelle, pour en finir avec cette addiction.
Parallèlement à cette confession, Nathan Devers développe une réflexion sur l’histoire de la cigarette et son imaginaire. Qu’est-ce qui distingue le fumeur mondain du fumeur invétéré ? Comment expliquer que les écrivains, si loquaces lorsqu’il s’agit de parler des drogues ou de l’alcool, aient accordé si peu de place à la cigarette ? Existe-t-il pour autant un espace fumeur de la littérature ? C’est un tel espace que l’auteur s’emploie à construire, en faisant dialoguer quelques fumeurs mythiques, de Michel Houellebecq à Pierre Louÿs en passant par Italo Svevo, Roland Barthes et un certain Maurice de Fleury…
A l’heure où la cigarette fait l’objet d’une quasi-prohibition, ce livre n’est ni une apologie du tabac ni un traité hygiéniste, mais un hommage, teinté d’humour et de mélancolie, adressé à cette espèce en voie de disparition qu’incarnent les fumeurs.
Espace fumeur, Grasset, 2021, 220 p. (ISBN 978-2-2468-2244-8).
Revue de presse
AUTRES VIDÉOS
Nathan Devers pense contre lui-même – C à Vous – 11/01/2024
Brut Philo : penser contre soi-même
Autres vidéos référencés par Google
REVUE DE PRESSE
(Notez que les articles de presse réservés aux abonnés ne sont pas référencés)
Action nationale : Nathan Devers. Penser contre soi-même, par Carl Bergeron, 21 mars 2024
Nathan Devers : Tout quitter pour la philosophie – Juillet 19, 2024, Le contemporain.
Nathan DEVERS – PENSER CONTRE SOI-MEME – Albin Michel, Paris, 2024, François BALTA
Réflexion post-lecture de Nathan Devers. Par Gérard Kleczewski, 14 mars 2025, Tribune Juive.
Conscience et subjectivité avec Lionel Naccache et Nathan Devers, Radio France, 28 février 2025.
“Penser contre soi-même” avec Nathan Devers, Radio France, 13 janvier 2024.
Nathan Devers pense contre lui-même, Radio France, 12 février 2024.
Questionnaire de Proust à Nathan Devers, L’Orient – Littéraire, 3 janvier 2024.

Mon rapport de lecture
NATHAN DEVERS
Penser contre soi-même
Éditions Albin Michel
« Penser contre soi-même » de Nathan Devers m’a ravi autant par son écriture, son caractère autobiographique et les propos au sujet de la philosophie. Une écriture poétique, pleine de métaphores, à prendre au pied de la lettre, qui donnent des ailes à l’imagination, au récit de vie de cet auteur qui m’a pas encore trente ans. Je me range avec ceux et celles qui voient en Nathan Devers un auteur de grand talent. « Penser contre soi-même » est une prouesse littéraire autobiographique comme je les aime et beaucoup trop rare. Autobiographique de la vie quotidienne de l’âme et de l’esprit de l’auteur. Une histoire de ses pensées, de leur stagnation et de leur évolution, d’aboutissement en aboutissement, d’étonnement en étonnement, de détermination en détermination, d’hésitation en hésitation, de croyances, de doutes… et finalement de philosophie en philosophie.
Déterminé à devenir rabbin, le jeune Nathan Devers se plie à toutes les règles, y compris vestimentaire, quitte à liquider son anonymat et être pointé du doigt. Puis vint un « premier désir de “philosophie” ».
Mon premier désir de « philosophie » ne vint pas d’un événement spécial, ni d’une souffrance, ni d’un traumatisme, ni même d’un déclic, mais d’un pressentiment, d’un vertige angoissé : ma religion n’était-elle pas le simple phénomène de ma propre naissance ? Le buée de ma venue au monde ? Une constellation inventé par mon désir de croire ? Une monumentale et profonde vanité ? Mais alors où chercher le sens de la vie ?
Avais-je seulement besoin de lire l’Ecclésiaste pour éprouver ce vertige ? Ne l’avais-je pas rencontré en mon for intérieur ? Cela faisait un certain temps, en effet — depuis que j’étais tombé amoureux de la littérature, à vrai dire — que je n’écoutais plus le rav Kotmel de la même manière. Je tendais à ses paroles une oreille plus méfiante et sortais des séminaires avec un arrière-goût étrange, une sorte de déception.
DEVERS, Nathan, Penser contre soi-même, Partie V – Les choses sont des mots, Chapitre 4, Éditions Albin Michel, 2024, p. 231.
P.S.: rav = rabbin.
Lorsque Nathan Devers écrit « ma religion n’était-elle pas le simple phénomène de ma propre naissance », il nous rappelle et rappellera tout au long de son livre, qu’on ne choisit pas d’être, de naître, son lieu de naissance, ses parents… et qui nous déterminent unilatéralement sans demander notre avis.
Ma naissance, était-ce le bien-fondé de toute mon existence ? Si j’avais surgi chez des parents musulman, chrétiens, athées ou bouddhistes, si j’avais grandi en Grèce antique, dans l’Arabie du VIIe siècle, en Inde médiévale, en 1910 dans une famille marxiste ou dans mille ans, aurais-je accordé la moindre importance à la Torah ? Aurais-je puisé mes vérité dans le Talmud ? Aurais-je respecté la Loi juive pour guider mes actions ? La réponse crevait les yeux : non.
Non à cette illusion de tenir pour absolue une religion dont j’aurais ou, si le démon de la naissance en avait décidé autrement, ignoré jusqu’au nom.
Non à ce conditionnement résultat du hasard.
Non à ce confort d’espérer que la Vérité me fit livrée au berceau, sous mes yeux depuis la tendre enfance.
Non à cette facilité de tenir mon identité pour le centre du monde.
Il me fallait me retourner contre ce que j’avais pris pour le fondement de mon être. Me défusionner de mon « moi ».
DEVERS, Nathan, Penser contre soi-même, Partie V – Les choses sont des mots, Chapitre 4, Éditions Albin Michel, 2024, p. 230.
Des questions et des constats ouvrant la porte à la philosophie et générant le pressentiment de l’auteur dont il identifie la source.
D’où Qohelet. C’était lui qui avait mis des mots sur mon pressentiment. Du moins l’avais-lu ainsi : comme un texte qui ne trichait pas avec la vérité, Qui creusait jusqu’au au fond de la perplexité.
DEVERS, Nathan, Penser contre soi-même, Partie V – Les choses sont des mots, Chapitre 4, Éditions Albin Michel, 2024, p. 233.
« Qohelet » ? Il s’agit de l’auteur présumé de l’Ecclésiaste. Nathan Devers est invité à choisir à choisir ce texte pour son intervention lors d’un séminaire d’été organisé par son rabbin :
Que dirais-tu de commenter l’Ecclésiaste ? C’est un texte dense, à peine plus long que le Cantique des cantiques. Il compte douze chapitres, tu pourrais sectionner ton cours en autant de session d’une heure chacune. Et tu verras, tu auras de quoi faire : malgré sa simplicité apparente, ce livre est abyssal…
DEVERS, Nathan, Penser contre soi-même, Partie V – Les choses sont des mots, Chapitre 4, Éditions Albin Michel, 2024, p. 233.
La lecture et l’étude de l’Ecclésiaste poussera Nathan Devers à une conclusion étonnante, contraire à celles des rabbins : « (…) : ce livre dynamitait la Bible et avec lui toutes les bibles du monde. (…) »
On ne peut qu’imaginer le profond malaise accablant ce jeune juif orthodoxe à la suite de sa lecture de l’Ecclésiaste. Le texte le forçait , sans doute malgré lui, à une prise de recul qui s’avèrerait fatidique.
Au chapitre 5, Nathan Devers imagine que l’auteur de l’Ecclésiaste lui parle :
Et toi, tu peux monter et tu pourras descendre, mais rien ne réparera la cassure que j’ai dévoilée en toi. J’eus certes des lecteurs qui se remirent de ma méditation et continuèrent leur vie comme si de rien n’était. Mais je sens qu’en vacillant, ta foi n’aura pas le confort de nier sa faiblesse. Le Talmud a raison : tel que tu m’as lu, avec ta rage et ta naïveté, je contredis la Bible. Au milieu de son corpus, je surgis à tes yeux comme le texte en trop. Moi qui dialogue avec l’esprit de la lucidité, j’ai frayé dans ton âme un sentier vers l’ailleurs, vers un voyage sans but. Je t’ai vidé de toute ta naissance.
DEVERS, Nathan, Penser contre soi-même, Partie V – Les choses sont des mots, Chapitre 5, Éditions Albin Michel, 2024, p. 237.
En écrivant « (…) mais rien ne réparera la cassure que j’ai dévoilée en toi » l’auteur me rejoint dans ce que je répète depuis mon adolescence : « La lumière entre par les failles ». Autour de moi, à cette époque tout aujourd’hui d’ailleurs, des gens qui se donnent raison et qui se précipitent pour colmater toute faille laissant pénétrer la lumière, aveuglés qu’ils sont par toute lumière parce qu’il y a trop longtemps qu’ils vivent dans le noir. La « cassure » dont parle Nathan Devers est une « faille » qui laisse entrer la lumière.
« L’Ecclésiaste, écrit l’auteur, avait tout dévasté sur son passage pour ne rien me donner ». Il ajoutera : « Qu’ils sont rares, les livres de cette trempe, ceux qu’on brûle de refermer pour en découvrir d’autres ».
La littérature ne me suffisait plus, il me fallait une alternative au cours du rav Kotmel, au commentaire biblique : découvrir une pensée aussi riche, aussi féconde que celle du Talmud, mais qui consente à faire sauter ses propres verrous. Qui se départisse de ses préjugés inconscients. De ses entraves secrètes. Qui fonctionne sans dogme et sans credo. Sans sacré et sans loi. Une pensée qui refuse d’être l’otage de ses impensés.
Où la trouver ? Il y avait bien ces personnes auxquelles rav Kotmel faisait parfois allusion dans ses cours : les philosophes… Ceux qui, comme lui, cherchaient à découvrir le sens de la vie. Mais qui, contrairement à lui, ne le cherchaient pas en commentant un texte sacré, eux qui préféraient s’appuyer sur le livre intérieur de leurs méditations, ceux qui posaient de grandes questions. Ceux qui ne feignaient pas de posséder la sagesse, mais se contentaient de la convoiter, en amis et en explorateurs.
N’étais-il pas là, le chemin : aller à la rencontre de cette pensée sans socle, qui paraissait incarner le trou noir des cours du rav Kotmel ? Tel fut le premier rapport que j’entretins avec la philosophie : un désir lointain et cependant vital. Une appétence d’ignorant assoiffé de connaître. Je ne savais rien de cette discipline mais j’avais la vague certitude qu’elle m’aiderait à m’orienter dans mes doutes. Bien que mystérieuse, elle m’apparut avec l’évidence des étrangetés. Il me semblait que ce mot, ce simple nom de « philosophie », résumait tout ce qui m’animait. Un besoin brûlant de comprendre ce que je foutais là, dans ce monde, dans cette vie, une ardeur de poser des milliards de questions — et de ne jamais me mentir à moi-même en prétendant avoir conquis l’ultime vérité. Découvrir ces auteurs dangereux dont parlait Kotmel. Renoncer à l’illusion de détenir des réponses. M’interroger et apprendre à penser.
DEVERS, Nathan, Penser contre soi-même, Partie V – Les choses sont des mots, Chapitre 6, Éditions Albin Michel, 2024, pp. 240-241.
En écrivant au sujet de la philosophie « j’avais la vague certitude qu’elle m’aiderait à m’orienter dans mes doutes », Nathan Devers met le doigt sur un mot essentiel : « doute ». Dans mon livre à moi, le doute est le nom de faille qui laisse entrer la lumière en notre esprit.
Un jour, tandis que je traînais dans une bibliothèque, mon regard se porta sur un ouvrage blanc, ni petit ni volumineux, qui dégageait un je-ne-sais-quoi de non attirant : Essais et conférences, de Martin Heidegger. Furetant dans le sommaire, je fus aussitôt magnétisé par le titre d’une entrée : « Que veut dire penser ? ».
Ce texte semblait avoir été écrit pour répondre à ma situation. Dès la première page, il allait au vif su sujet qui m’animait : nous voulons, écrivait-il, apprendre à penser. Mais une telle ambition n’est possible que si nous commençons par reconnaître que nous ne pensons pas encore. Nous réfléchissons, nous lisons, nous blablatons, nous calculons, nous commentons, mais nous ne pensons pas. Car qu’est-ce qui occupe notre esprit ? Des ouvrages, l’actualité, l’état du monde, la culture, des décisions à prendre, des discussions entre amis : mille choses dispersées, éparpillées au vent de notre tête. Si bien que notre intellect est sans cesse affairé par l’illusion d’œuvrer.
Si. Il y a bien, relevait Heidegger, une discipline, une seule, qui prétend contenir le travail de penser : elle s’appelle philosophie et s’échine à convoiter une sagesse qui se montre de loin. Mais attention ! Ce n’est pas en fréquentant la philosophie qu’on réussira à entrer dans la pensée. Car la philosophie n’a pas à nous intéresser : inter-esse, ce terme veut dire « être entre et parmi les choses ». Une chose intéressante nous intér-esse toujours dans son indifférence. Elle nous captive un jour et nous ennuie demain. C’est un attachement futile, une ardeur passagère. Or, la philosophie ne doit pas être quelque chose qu’on « étudie » : il ne suffit pas de passer en revue les traités et écrits des grands penseurs pour penser par soi-même. Il faut échapper, avant tout, à l’illusion de philosopher.
DEVERS, Nathan, Penser contre soi-même, Partie V – Les choses sont des mots, Chapitre 6, Éditions Albin Michel, 2024, pp. 241-242.
Je ne comprends pas qu’« Une chose intéressante nous intér-esse toujours dans son indifférence. ».
« L’indifférence, c’est un état sans douleur ni plaisir, sans crainte ni désir vis-à-vis de tous ou vis-à-vis d’une ou de plusieurs choses en particulier. L’indifférence, si elle n’est pas une pose, une affectation, n’a évidemment rien à voir avec la tolérance. Dans la mesure où la tolérance, c’est l’acceptation de la différence, celui qui affiche l’indifférence n’a aucunement besoin de pratiquer la tolérance envers qui que ce soit ou quoi que ce soit. Si tant est que l’indifférence soit un trait de la vieillesse Maurois pouvait écrire: «Le vrai mal de la vieillesse n’est pas l’affaiblissement du corps c’est l’indifférence de l’âme.» »
Jean-Paul Desbiens
Lorsque nous entendons le mot « indifférence » et l’expression « indifférence à autrui », les images suivantes nous viennent à l’esprit. Tout d’abord, des gens qui meurent dans la solitude la plus extrême et qu’on ne retrouve que des jours, des mois, voire des années après, alors qu’ils vivent en ville, dans des appartements ou dans leur maison, entourés d’une multitude de gens. Ensuite, cette autre image, liée à nos origines : ces cultivateurs d’Europe de l’Est, de Pologne et d’Ukraine, qui font pousser, comme si de rien n’était, leurs choux et leurs patates sur des charniers, non identifiés comme tels, où furent massacrés au total plus d’un million de Juifs vers 1941, dans le cadre de ce qu’on a appelé la « Shoah par balles ». Dans un tout autre ordre d’esprit, nous pensons au sage stoïcien, qui vit « dans une disposition de libre indifférence à l’égard de toutes les choses qui ne sont pas directement associées à sa fin ultime ou à sa vie morale et vertueuse.»
Cette variété du champ d’application d’un même terme nous amène à nous pencher sur sa définition. Alors que nous nous apprêtons à en préciser le sens, une certaine perplexité monte en nous. En effet, comme l’écrit le philosophe Louis Dugal, « De prime abord, il semble y avoir autant de conceptions de l’indifférence que d’auteurs qui en traitent. […] Dans la bouche des uns, l’indifférence sera une apathie destructrice, une résistance au changement ou un refus d’engagement, alors que dans celle des autres elle sera la condition de l’objectivité du chercheur, de la liberté du sujet ou de l’égalité de tous devant la société ou Dieu.» (1)
____________
(1) Louis Dugal, Éthique et indifférence. Questions pour Levinas. Mémoire de maîtrise en philosophie. Faculté de philosophie, Université Laval, Québec, 2009, p. 2.
Il y a toujours le pouvoir de la « chose », de l’objet qui, par ses stimulus, appelle notre subjectivité. Un objet, quel qu’il soit, n’est jamais neutre en soi :
Nous aimons croire que nous sommes objectifs, que nous nous intéressons à des informations objectives. En réalité, si l’on ne devient pas subjectif face à une nouvelle information objective, on ne s’y intéresse pas et on n’est pas motivé par elle. Nous disons que nous jugeons objectivement, mais en réalité nous réagissons subjectivement.
Nous faisons continuellement des choix dans la vie quotidienne. Nous choisissons les « choses » qui nous attirent subjectivement, mais nous considérons ces choix comme objectifs.
« Le comportement d’un individu se base sur son schéma de références. Le schéma de références d’un individu détermine ses attitudes. Consciemment et inconsciemment, un individu acquiert des concepts qui deviennent une partie de lui-même et qui sont la base de toutes ses attitudes. Le schéma de références est acquis des parents, des enseignants, des relations et des amis, du type d’émissions de radio que nous entendons, des émissions de télévision que nous regardons et du type de livres, magazines et journaux que nous lisons. La plupart d’entre nous croyons tirer des faits de ces sources, non pas des attitudes. Nous pensons que nous avons accumulé des informations objectives, non pas un schéma de références. »
TEXTE ORIGINAL EN ANGLAIS
We like to believe that we are objective, that we are interested in objective information. Actually, unless one becomes subjective about a new objective information, he is not interested in it and is not motivated by it. We say we judge objectively, but actually we react subjectively.
We continually make choices in daily life. We choose the « things » which appeal to us subjectively, but we consider the choices objective. »
An individual’s behavior is based on his frame of refer-ence. A person’s frame of reference determines his attitudes. Consciously and unconsciously one acquires concepts that become part of him and are the basis of all his attitudes. The frame of reference is acquired from parents, teachers, relatives and friends, from the type of radio pro-grams we hear, the T.V. programs we watch and from the kind of books, magazines and newspapers we read. Most of us believe we acquire facts from these sources, not attitudes. We think we have accumulated objective information, not a frame of reference.
Source : Cheskin, Louis, Basis For marketing Decision, Liveright, New York, 1961, p. 82.
Nathan Devers écrit :
J’avais fait le deuil des vérités toutes faites. Mais ce deuil était un merveilleux printemps. Si rien n’était certain, alors chaque question s’ouvrait comme une croisée de voyages anarchiques : on pouvait penser dans toutes les directions. (…) pour la première fois, je pouvais réfléchir sans aucune limite. Ma quête du sens de la vie se décloisonnait enfin. Jusqu’alors elle avait toujours été close par quelque chose : par l’idée de Dieu, par mon désir de confirmer mes croyances, par un amas de socles spirituels et de barrières mentales. Et voilà, d’un coup, qu’elle n’avait plus de fondement. La vie n’avait pas de sens en soi. Il fallait le chercher.
DEVERS, Nathan, Penser contre soi-même, Partie V – Les choses sont des mots, Chapitre 7, Éditions Albin Michel, 2024, pp. 245-246.
À « La vie n’avait pas de sens en soi. Il fallait le chercher. », je réponds que si la vie n’a pas de sens en soi, il faut, non pas le chercher, mais lui en donner un ou discerner celui qu’on lui donne inconsciemment et/ou involontairement au cours de notre vie. Et ce sens de la vie, de notre vie, n’est pas coulé dans le béton; il se transforme, voyage, se perd et meurt et, parfois, naît un nouveau sens. Je ne crois que la vie a un sens universel puisqu’il naît dans l’individualité.
Nathan Devers témoigne de sa quête philosophique où il court dans toutes les directions avec une panoplie de philosophes.
(…) Au hasard, je me mis à frapper aux portes des autres philosophes et voici qu’ils me répondaient. En parfait amateur, je les mettais tous sur le même plan : Lucrèce et Stirner, Montaigne ou bien Sénèque. Ils m’apparaissaient comme des rabbins sans Bible, des écrivains sans littérature. Pêle-mêle, ils traitaient de causes et de plaisirs, d’atomes et de mensonges, du mal et de la vie. Trompé par l’impression qu’ils dialoguaient ensemble, j’assimilais leurs concepts dans le plus grand chaos. C’était un pot-pourri de clinamens et de structures du signe, de moi absolu et de ceci-cela, je pataugeais en plein brouillard mentale. Pour me repérer, j’empruntais à la bibliothèque des manuels absurdes, résumant toute l’histoire de la philosophie en cent soixante-seize pages. D’Anaximandre à Derrida, chaque personnage avait le droit à deux ou trois extraits décontextualisés et à une fiche qui résumait leurs « thèses ». Sur internet, j’écoutais des podcasts, les voix de France Culture avaient cette alchimie de rendre intelligent n’importe quel sujet, même le plus prosaïque. Bientôt, le mirage s’empara de moi : j’eus l’illusion d’apprendre.
DEVERS, Nathan, Penser contre soi-même, Partie V – Les choses sont des mots, Chapitre 7, Éditions Albin Michel, 2024, p. 246.
Je ne sais ni pourquoi ni comment, je n’ai jamais eu l’idée de me lancer dans la lecture des différentes œuvres philosophiques des grands penseurs. Il ne m’est jamais venu à l’esprit que ces grands penseurs pouvaient créer en mon esprit d’adolescent une faille laissant ainsi pénétrer la lumière. Mon premier contact formel avec la philosophie, identifiée comme telle, constituée en discipline, fut lors de mes cours obligatoires en philosophie au collège et ce ne fut pas du tout le coup de foudre. J’écrivais dans mes rédactions ce que me donnais à penser les thèmes des devoirs imposés par le professeur et ce ne fut pas là non plus un succès. Je n’eus pas l’illusion d’apprendre quoi que ce soit. J’ai laissé tombé la philosophie à la fin de ces cours imposés au cursus de l’enseignement collégial au Québec.
On entre toujours dans la philosophie par la mauvaise porte. Si c’était à refaire, se dit-on après-coup, je n’aurais pas perdu tout ce temps à vouloir en gagner : j’aurais évité ces digressions que je prenais pour des raccourcis ; je n’aurais pas lu Y, mais directement X ; je n’aurais pas écouté le vulgarisateur W, mais le professeur Z ; je ne me saurais pas posé la question A, mais le problème B. Avec le recul, on se reproche de ne pas avoir avancé plus sûrement. Conscient de l’infinité des connaissances qu’il fallait englober, on s’est jeté à bras ouverts dans le syndrome de l’imposteur : par vergogne, on a sombré dans une boulimie de lecture, s’empêchant par là même de ruminer les textes. On a forcé les serrures qui étaient grandes ouvertes. On s’est cassé la tête en souhaitant l’ordonner. On s’est choisi des boussoles qui indiquaient le sud. Mais regrets sont des affects faux. En philosophie, il n’y a pas de bonne porte. Ni de porte tout court. Seulement des voies de garages. Des conduits dérobés. Des passages secrets. Rien n’a jamais introduit à la philosophie, elle n’est qu’extroduction : il s’agit, avec elle, de sortir de soi-même. Comment s’initierait-on à l’art de s’évader ?
DEVERS, Nathan, Penser contre soi-même, Partie V – Les choses sont des mots, Chapitre 7, Éditions Albin Michel, 2024, p. 247.
P.S. : Le soulignement est de nous et remplace l’italique dans le texte original.
« En philosophie, nous dit Nathan Devers, il n’y a pas de bonne porte. Ni de porte tout court. » Je n’adhère pas à cette conclusion. J’y vois une généralisation à outrance, c’est-à-dire un biais cognitif, de son expérience à tous vents des philosophies plutôt que de LA philosophie. Aucune philosophie avancée par un grand ou un petit penseur ne constitue une porte de LA philosophie.
Nathan Devers écrit « Conscient de l’infinité des connaissances qu’il fallait englober (…) ». Il faut un arrêt sur image sur le mot « connaissances ». Peut-on parler des philosophies comme rapportant des connaissances vraies, conforme à la réalité ? Certainement pas. Les philosophes proposent et proposent uniquement. Il est probable que certaines propositions vous semblent évidentes mais l’évidence ne fait pas le vrai, la vérité.
Maurice Lagueux
Professeur de philosophie, Université de Montréal
“Peut-on parler de connaissance philosophique ?” *
Un article publié dans la revue DIALOGUE, no XXIX, 1990, pp. 415-440. Rubrique : Critical Notices/Études critiques.
Introduction
C’est bien à la question de savoir s’il est légitime de parler d’une connaissance philosophique, que Gilles-Gaston Granger a voulu répondre, et répondre par l’affirmative, en publiant son dernier livre intitulé Pour la connaissance philosophique [1]. À en juger pourtant par les réactions agacées que provoque souvent cette enquête constamment réouverte sur la nature de la philosophie, il se pourrait bien que nombre de philosophes trouvent un peu excessif de consacrer encore un ouvrage de près de trois cents pages à justifier la portée cognitive d’une discipline qui, au cours de sa longue histoire, a produit autant d’œuvres dont le moins qu’on puisse dire est qu’elles ont hautement contribué à enrichir le bagage culturel de l’humanité. Qui, parmi ceux qui vouent l’essentiel de leur vie à l’enseignement de la philosophie, accepterait de se voir refuser le droit de prétendre transmettre une connaissance authentique ? Pourtant, je voudrais soutenir ici que, compte tenu de son contexte, non seulement l’intervention de Granger n’était pas superflue mais qu’elle n’aura pas été suffisante pour établir de façon convaincante qu’il existe telle chose qu’une connaissance proprement philosophique.
Une question plus embarrassante qu’il ne semble
Si cette question méritait toute l’attention que Granger lui a portée, c’est que, pour ce philosophe, il n’est pas question de considérer la philosophie [416] comme une science et que, si elle n’en est pas moins une connaissance, elle ne saurait être qu’une connaissance sans objets. S’il fallait, en effet, voir dans la connaissance philosophique une connaissance d’objets particuliers, il serait assez normal de considérer cette connaissance comme la science de ces objets, au même titre que les autres sciences sont sciences de leurs objets respectifs, ce qui équivaudrait à passer à côté de ce qui fait de la philosophie une activité profondément originale. Si toutefois on reconnaît que cette discipline n’a pas d’objets, la réponse à la question de savoir en quel sens elle peut néanmoins être considérée comme une connaissance authentique est loin d’aller de soi. La tentation est même assez grande alors – et Granger en est fort conscient – de voir dans cette philosophie qui refuse d’être une science, soit une sorte de jeu de la pensée qui n’a pas à s’embarrasser des contraintes qu’impose à une connaissance le fait d’être justement connaissance de quelque chose, soit une activité qui se veut beaucoup plus sérieuse mais qui, se situant à un tout autre niveau que celui de la connaissance, s’apparente davantage à un art, voire à quelque forme de mysticisme.
Or, comme, pour Granger, une connaissance authentique doit être à la fois sérieuse et rigoureuse, il s’agira pour lui de montrer que la philosophie est bel et bien une connaissance authentique, même si on ne peut nullement lui attribuer les caractères de la connaissance scientifique. Plus précisément, il s’agira pour lui de montrer que la philosophie est bel et bien une connaissance authentique, même si, faute de renvoyer à des objets particuliers dont elle aurait alors pu rendre compte avec toute la rigueur désirée, elle renvoie plutôt à un univers de « significations » et à ce qui sera désigné par l’expression « totalité de l’expérience vécue ». La rigueur, on en conviendra, étant loin d’aller de soi dans un tel contexte, une réponse satisfaisante à la question de savoir si la philosophie constitue vraiment une connaissance authentique se révèle beaucoup plus difficile à fournir qu’on aurait pu le penser à première vue.
____________
* L’auteur tient à remercier Pierre Bellemare, Jocelyne Couture, Gérald Lafieur et Robert Nadeau, dont les remarques à propos d’une première version du présent texte ont été pour lui d’une très grande utilité.
[1] G.-G. Granger, Pour la connaissance philosophique, Paris, Éditions Odile Jacob, 1988, 286 p.
Source et lire la suite : LAGUEUX, Maurice, “Peut-on parler de connaissance philosophique ?”, revue DIALOGUE, no XXIX, 1990, pp. 415-440. Rubrique : Critical Notices/Études critiques, Les classiques des sciences sociales.
Fasciné à l’idée que chacun cherche constamment à se donner raison et à l’idée que l’on puisse prendre pour vrai ce que l’on pense uniquement parce qu’on le pense, c’est par un questionnement sur la connaissance que je me suis introduit en philosophie et, plus spécifiquement, par l’épistémologie, notamment son apport à la compréhension de la construction de la connaissance scientifique. La porte ouverte, je me suis dirigé vers la « Théorie de la connaissance ».
 La théorie de la connaissance (Erkenntnistheorie en allemand), ou philosophie de la connaissance ou encore gnoséologie, est la branche de la philosophie qui se propose d’étudier la connaissance. Le terme « épistémologie » est parfois utilisé comme synonyme, bien qu’en français les deux concepts soient généralement distincts.
La théorie de la connaissance (Erkenntnistheorie en allemand), ou philosophie de la connaissance ou encore gnoséologie, est la branche de la philosophie qui se propose d’étudier la connaissance. Le terme « épistémologie » est parfois utilisé comme synonyme, bien qu’en français les deux concepts soient généralement distincts.
La théorie de la connaissance est un domaine majeur de la philosophie qui englobe les questions relatives aux conditions de la connaissance, à l’émergence de la connaissance et à d’autres formes de croyances. Elle étudie la nature, l’origine et la justification de nos connaissances, en questionnant la nature des idées et si nos sens en sont la source principale. Elle examine également ce qui constitue la certitude et la justification, ainsi que le type de doute qui peut objectivement exister à propos de tel ou tel type de croyance.[1], [2]
La théorie de la connaissance est devenue transdisciplinaire et n’est plus uniquement incluse dans le champ de la philosophie.
____________
- Lalande 2010, entrée : « Théorie de la connaissance », p. 1129. « On appelle théorie de la connaissance un ensemble de spéculations qui ont pour but d’assigner la valeur et les limites de nos connaissances »
- Nadeau 2016, p. 10-11. « qu’est-ce qu’une idée, un concept? Toutes nos connaissances viennent-elles obligatoirement de nos sens? Comment peut-on justifier une prétention à la connaissance? La connaissance peut-elle être définie comme une « croyance vraie et justifiée » ? La vérité concerne-t-elle la cohérence systématique des propositions entre elles ou plutôt la correspondance des énoncés avec les faits ? Un ensemble de questions hautement techniques s’est ainsi mis peu à peu en place dès le début de l’histoire de la philosophie et s’est graduellement enrichi et transformé à travers le temps : cet ensemble d’interrogations philosophiques s’est progres- sivement complexifié avec les médiévaux et avec les rationalistes classiques, il a connu un développement spectaculaire avec les empiristes anglais et avec Kant, qui s’émerveillait pour sa part du progrès de la connaissance accompli dans les travaux de Newton et se demandait comment une telle connaissance parfaite était possible. C’est à l’examen de cet ensemble de questions formant maintenant système que se consacrent les spécialistes de la «théorie de la connaissance » si on entend cette expression dans son sens strict. »
Source : La théorie de la connaissance, Wikipédia.
Définition de l’épistémologie
 Lorsque l’on aborde l’épistémologie pour la première fois, il faut se montrer prudent car le sens du terme varie. Par epistemology, un anglophone réfère en général à une branche spécialisée de la philosophie, la théorie de la connaissance. Les francophones pour leur part se servent plutôt du terme pour désigner l’étude des théories scientifiques. En fait, comme le note avec justesse Pierre Jacob, les deux acceptions sont étymologiquement justifiées, car le « mot grec épistèmê (qui s’oppose au mot doxa qui signifie « opinion ») peut être tantôt traduit par le mot « science », tantôt par le mot « savoir » »1. On peut réconcilier ces deux acceptions en parlant, de manière très générale, de l’épistémologie comme de la théorie de la connaissance scientifique. Dans l’ensemble des textes que l’on trouvera sur ce site, on utilisera d’abord et avant tout ce sens, plus proche du versant français du terme.
Lorsque l’on aborde l’épistémologie pour la première fois, il faut se montrer prudent car le sens du terme varie. Par epistemology, un anglophone réfère en général à une branche spécialisée de la philosophie, la théorie de la connaissance. Les francophones pour leur part se servent plutôt du terme pour désigner l’étude des théories scientifiques. En fait, comme le note avec justesse Pierre Jacob, les deux acceptions sont étymologiquement justifiées, car le « mot grec épistèmê (qui s’oppose au mot doxa qui signifie « opinion ») peut être tantôt traduit par le mot « science », tantôt par le mot « savoir » »1. On peut réconcilier ces deux acceptions en parlant, de manière très générale, de l’épistémologie comme de la théorie de la connaissance scientifique. Dans l’ensemble des textes que l’on trouvera sur ce site, on utilisera d’abord et avant tout ce sens, plus proche du versant français du terme.
____________
1 JACOB, P., L’épistémologie — L’âge de la science, Paris, Odile Jacob, 1989, p. 9.
Source et lire la suite : L’épistémologie, Université de Sherbrooke, Québec, Canada.
Voir aussi
Évidemment, je dois reconnaître qu’il y a un escalier à gravir avant de frapper à la porte de LA philosophie. À chaque marche, un étonnement.
Adolescent, j’écrivais de la poésie. J’ai publié deux recueils : Lueur de solitude et La conscience aux heures et pointe. Mes professeurs me pressaient pour que je m’adonne à la lecture des grands poètes, notamment, Baudelaire et Nelligan. Mais je m’y refusais catégoriquement, Me sachant influençable — hypersensible —, je craignais de perdre mon originalité et ma naïveté. Il valait mieux que ma solitude me soit réservée en exclusivité. J’ai échappé de près à un destin aussi tragique que celui de Baudelaire et Nelligan.
C’est avec cette même crainte que j’aborde LES philosophies au profit de LA philosophie dont la base demeure la formation de l’esprit critique, nécessaire avant de se lancer dans la lecture des œuvres des grands penseurs. J’ai lu volontiers « Comment choisir son philosophe ? Guide de première urgence à l’usage des angoissés métaphysiques » d’Oreste Saint-Drôme » dont j’ai rapporté ma lecture sur ce site web. Il en va de même du livre « Comment nous pensons » de John Dewey dont j’ai aussi fait un rapport de ma lecture ici même, du livre « Penser par soi-même – Initiation à la philosophie » de Michel Tozzi (voir mon rapport de lecture) et plusieurs autres. Mais je me refuse toujours à la lecture des œuvres des grands penseurs ; je ne suis pas prêt à me lancer dans ce labyrinthe et qui sait si je serai prêt un jour.
Se lancer dans la lecture des œuvres des grands penseurs, c’est comme entrer dans le rez-de-chaussée bondé à craquer d’un hôtel en proie à une cacophonie insoutenable. On ne parvient pas au comptoir d’enregistrement telle la foule est dense. Alors, on jase avec tout un chacun, chacun ayant sa philosophie. On finit par avoir le tournis. Et si, de plus, on mène une double vie, on ne sait plus trop ce qu’on fait là au milieu de toutes ces philosophies.
Parfois je me demandais où me mènerait toute cette aventure. Pour l’instant, les changements n’étaient perceptibles qu’aux de ma conscience. Autour de moi, personne n’y voyait que du feu : je continuais à porter ma kippa, de prier trois fois par jour, d’aller à la synagogue — sans compter qu’en mon for intérieur je désirais encore devenir rabbin. Mais tiendrais-je longtemps le fil de cette double vie ? N’était-ce pas, en m’accrochant à la Torah autant qu’ à mes manuels, en train de vouloir conserver à tout prix mon petit bonheur intime ? Pourrais-je longtemps le beurre et l’argent du beurre, poursuivre de font ma vie religieuse et cette nouvelle aspiration à la lucidité ?
DEVERS, Nathan, Penser contre soi-même, Partie V – Les choses sont des mots, Chapitre 7, Éditions Albin Michel, 2024, pp. 247-248.
En un pareil contexte, les questions fussent de toutes parts et constitue en soi une démarche philosophique.
D’un autre côté, avais-je vraiment besoin de la philosophie pour m’éprendre de sagesse ? Cette discipline n’était-elle pas, au même titre que n’importe quelle religion, le fruit d’un contexte précis, d’une culture parmi d’autres ? Ne constituait-elle pas, elle aussi, la conséquence d’un particularisme ? Loin de désigner la pensée humaine, ne renvoyait-elle pas à une configuration historique fondamentalement relative, née en Grèce sept siècles avant notre ère ? N’étais-elle pas la réponse inventée par l’Europe pour répondre à l’absurdité du monde ? À quoi non, en ce cas, délaisser Jérusalem pour Athènes — quitter mon cocon pour son frère jumeau ? Ne fût-ce pas une vanité supplémentaires ?
DEVERS, Nathan, Penser contre soi-même, Partie V – Les choses sont des mots, Chapitre 7, Éditions Albin Michel, 2024, pp. 247-248.
Mais quand Nathan Devers fait référence à « LA » philosophie, en fait, il nous parle « DES » philosophies, des œuvres dans grands penseurs qu’il a lues. Qui plus est, il utilise le mot « discipline » comme si elle se constituait uniquement des différentes philosophies. Or, ces différentes philosophies sont les feuilles des branches attachées au tronc de l’arbre, lui-même attaché à ses racines cachées dans le sol. J’ai l’impression que notre cher Nathan a découvert l’arbre de LA philosophie par ses feuilles plutôt que par ses racines et son tronc qui doivent leur existence aux nutriments de l’esprit critique. Avait-il cet esprit critique avant même de se lancer dans LES philosophies ? A-t-il confondu ces dernières avec LA philosophie ?
Toujours est-il qu’un critique de l’un de ses discours à la synagogue conseilla à Nathan de lire Platon :
— Tiens je viens de citer Platon. Voilà quelqu’un que tu devrais lire sérieusement, en commençant par la lettre VII, un texte autobiographique où il revient sur les principaux dangers qui guettent les aspirant à la philosophie…
DEVERS, Nathan, Penser contre soi-même, Partie V – Les choses sont des mots, Chapitre 8, Éditions Albin Michel, 2024, pp. 253-254.
Ce critique, Jean-Pierre, devenu un nouvel ami qu’il prend désormais comme son « Maître », lui propose aussi de lire Nietzsche, La Naissance de la tragédie, chapitre 13 à 15.
Et voilà notre Nathan en plein débat sur la littérature et la philosophie.
Réconcilier la littérature et la philosophie, moi qui étais amoureux de l’une et religieux : n’était-elle pas là, la clé ? Ne plus voir des différence entre ces deux continents. Abolir le schisme séparant théorie et pratique. Conformer ses actions à ses idées, mais ne pas réduire celle-ci à la pure conceptualité. Élargir le spectre des instincts qu’on mobilise pour questionner le monde. Penser non seulement avec son cerveau, mais dans la plénitude de soi. Penser avec ses souvenirs et ses appréhensions, avec ses émotions, penser avec ses tripes et son imaginaire, ses lectures et ses divertissements, ses rires et ses ennuis, ses doutes et ses plaisirs. Penser en s’y engageant dans sa chair et sa raison mêlées, sans créer de rupture entre la philosophie et le restant de la vie. Penser par l’existence, penser de tout son être.
DEVERS, Nathan, Penser contre soi-même, Partie V – Les choses sont des mots, Chapitre 8, Éditions Albin Michel, 2024, p. 261.
Eh ! Oui, la philosophie ne se limite pas un exercice intellectuel, elle déborde dans un exercice spirituel, dans une manière de vivre, un mode de vie.
Voir ces trois rapports de lecture sur ce site web
Le onzième chapitre de la cinquième partie du livre commence avec une question : « Qui avait raison par les philosophes ? »
Plus je lisais, et plus cette question me travaillait. Quand je prenais du recul par rapports aux ouvrages que Jean-Pierre me recommandait, quand je levais les yeux de la page et réfléchissais par moi-même, je me rendais compte que ces textes pourtant clairs remplissaient mon esprit d’une épaisse confusion. Tel philosophe démontrait par A + B que l’être humain était doté d’un libre arbitre ; tel autre établissait, avec autant de lucidité, que nous étions entièrement déterminés. Les déduction de X étaient implacables quand il montrait que l’univers était harmonieux, mais celles de Y, qui aboutissaient à la thèse contraire, ne souffraient d’aucune faille. Sur certains manuels, la page de gauche présentait une certaine théorie et celle de droit restituait la théories opposée : les deux s’équivalaient avec la même rigueur. J’étais bien incapable de dire laquelle me paraissait plus solide que l’autre. J’éprouvais ce syndrome que connaît quiconque s’engage dans la philosophie : le vertige du relativisme. J’avais beau me demander de quelle école je me sentais plus proche, la réponse était « aucune ». Personne, dans la pensée, ne résistait à l’armada de ses contradicteurs.
La philosophie, dans ces instants, me semblait n’être qu’un dialogue sans fin. Un drapeau d’idées contradictoires et de doctrine adverses. Un grand hémicycle rempli de partis pris où se jouaient de grands débats impossibles à trancher. (…)
DEVERS, Nathan, Penser contre soi-même, Partie V – Les choses sont des mots, Chapitre 11, Éditions Albin Michel, 2024, pp. 271-272.
Personnellement, je n’ai pas de philosophe préféré. Je vois Nathan, tombé du ciel, pris dans les branches et le feuillage de l’arbre tandis que je me barre les pieds sur ses racines au sol. Comment Nathan pouvait-il voir l’arbre dans son entier, avoir du recul, alors qu’il peinait à l’analyse de chacune des feuilles ? Au Québec, la seule province francophone du Canada, on n’aime pas les chicanes (Chicane : En France, une chicane est un obstacle volontairement mise en place sur la route afin de faire diminuer la vitesse des conducteurs. Au Québec, rien à voir, une chicane est synonyme de querelle ou de chamaille, Je parle québécois). L’ordre général des mamans, du moins à l’époque de mon enfance, était : « Ne vous chicanez pas ! ». Et si jamais des personnes se chicanaient sous leur toit, elles disaient « Pas d’chicane dans ma cabane (ma maison) ». Et c’est peut-être pourquoi les débats de toute nature, y compris philosophiques, n’ont que très peu de prise ici comparativement à la France.
Dans ce contexte, si vous parlez d’un dialogue sans fin, d’un drapeau d’idées contradictoires et de doctrine adverses, d’un grand hémicycle rempli de partis pris où se jouent de grands débats impossibles à trancher, le Québec n’est pas partant.
Nathan ne savais plus par où commencer : « (…) Quelle boussole donnerais-je à ma quête ? J’étais paralysé : non seulement j’ignorais quelles vérités je finirais bien par rencontrer au cours de mon chemin, vers quelle certitude me mèneraient mes interrogations, mais je ne savais surtout pas quel point de départ assigner à mes pérégrinations. (…) »
L’analytique a ce défaut d’avoir besoin de beaucoup d’information pour analyser toutes les facettes d’un sujet avant prendre une décision mais il se trouve souvent paralysé par son analyse, ne pouvant ainsi décider de quoi que ce soit. (Voir : Article # 30 – Les styles interpersonnels selon Larry Wilson).
Quoi de moins étonnant de voir Nathan, écartelé entre toutes les philosophies, trouver la lumière dans le scepticisme.
Je me souviens de la joie profonde qui m’assaillit lorsque je découvris qu’il existait une voie, une seule, qui ne levait en moi aucun doute, aucune hésitation, mais suscitait dans mon être une adhésion immédiate. J’étais au CDI de Betham où je feuilletais depuis une heure un volume poussiéreux de l’Encyclopaedia universalis, je tournais ces pages fines à la recherche d’un thème intéressant quand je tombai sur l’entrée « Scepticisme », rédigée par Jean-Paul Dumont. Ce fut une lumière.
Qui furent les septiques ? L’universitaire les décrivait comme des « philosophes de l’embarras, de la perplexité et de l’issue non-trouvée ». Des âmes qui ne prétendaient pas avoir conquis la vérité. Des esprit qui examinaient. comparaient, doutaient des choses autant que des idées. Qui refusaient d’ériger ces dernières en axiomes, en concepts tout faits. Les gardiens d’une bien étrange parole : la langue du « comprends pas », du «peut-être que oui mais peut-être aussi que non », du « pas plus ceci que cela » ; le verbe de l’indéterminé, du « je m’abstiens de juger », du « à toute affirmation est opposée une affirmation une affirmation égale » — la voix qui commence ses phrases par « il me semble que » et les achève par « pour moi ».
DEVERS, Nathan, Penser contre soi-même, Partie V – Les choses sont des mots, Chapitre 11, Éditions Albin Michel, 2024, p. 273.
____________
P.S. : lien vers l’entrée « Scepticisme » par Jean-Paul Dumont de l’Encyclopaedia universalis.
Nathan devers nous réfère ensuite à sa lecture de « Esquisses pyrrhoniennes » de Sextus Empiricus, « l’oeuvre-somme de la pensée sceptique ».
J’en sortis avec la conviction que Jean-Pierre avait raison : en philosophie, il est toit bonnement impossible de fonder ses propos. Comment se fier à la conscience commune alors qu’elle est l’expression d’un amas de particularités, de contingences, de perspectives étroites ? Comment écrire la moindre phrase qui ne procède pas d’un arrêt dogmatique, qui ne repose pas sur un axiome non prouvé, qui ne contienne pas de cercle logique ou qui ne conduise pas, si on veut la démontrer, à une régression vers l’infini ? Comment émettre la moindre pensée qui ne masque pas l’insuffisance de la pensée humaine ?
Si. Il y avait un moyen, un seul : se poser des questions. Faire en sorte que des points d’interrogations puissent être apposés à toutes ses sentences, à toutes ses décisions, à tous ses choix de vie, y compris le plus résolus. Exister en sceptique ?
DEVERS, Nathan, Penser contre soi-même, Partie V – Les choses sont des mots, Chapitre 11, Éditions Albin Michel, 2024, p. 275.
____________
P.S.: Voir aussi ce site web pour les écrits de SEXTUS EMPIRICUS.
Puis, durant ses temps libres lors d’un séminaire religieux au cours d’un été, il lu également « Husserl (L’Idée de la phénoménologie, une conférence dense sous une couverture rouge), Descartes (les Méditations, le Discours de la méthode), Platon (l’Apologie, la Lettre VII) et bien sûr Heidegger (les Essais et conférences) ».
Ces œuvres m’apparaissaient aussi cryptées que le Talmud jadis. Je n’y comprenais rien. Les raisonnements se mélangeaient dans ma tête, les concepts b avaient les uns sur les autres, les phrases résistaient : elles semblaient rédigées dans une langue étrangère. D’une page à l’autre, les réflexions se succédaient en chaos sous mes yeux embrouillés. Mais je persévérais. Une seule étincelle m’animait : il se jouait, dans ces textes dont le sens m,échappait, quelque chose d’absolument fondamental.
Parallèlement à cette lueurs, j’acquis la certitude que la philosophie n’était pas compatible avec la vie religieuse. Que m’apprenaient en effet ces livres dont les nuances me demeuraient opaques ? Que, pour s’engager dans la philosophie, il faut renoncer aux illusions de sa naissance : rompre avec ses préjugés, déchirer le rideau des traditions, renoncer aux bonheurs immédiats. (…)
(…)
(…) Tous ces penseurs témoignaient d’une quête identique. Pour s’aventurer vers la philosophie, clamaient-ils d’une seule voix, il fallait commencer par en payer le prix. Il importait, au préalable, de sacrifier tout ce qui, au sein de son esprit, entravait le travail de la vérité : refuser non seulement les tromperies des sens mais aussi les mirages spirituels, c’est-à-dire les évidences accumulées en soi depuis le tout début. Cette tâche est douloureuse. Elle suppose de reprendre son existence à zéro, De renier ses convictions, ses systèmes de valeurs, ses croyances, peut-être même ses doutes. De porter sur le choses – et sur les idées où se mirent les choses – un regard sempiternelle3ment naïf mais fort d’une candeur méfiante : la naïveté de celui qui est trop sincère pour voir des images à la place des ombres. À la mener jusqu’au bout, cette démarche implique de mettre sa vie sens dessus dessous, de couper en deux sa propre identité, d’assassiner l’«être normal » qu’on était jusqu’alors. En un mot : il s’agit d’un suicide intérieur.
DEVERS, Nathan, Penser contre soi-même, Partie V – Les choses sont des mots, Chapitre 12, Éditions Albin Michel, 2024, pp. 279-280.
En écrivant qu’il faut « sacrifier tout ce qui, au sein de son esprit, entravait le travail de la vérité », Nathan Devers suppose et propose un lien entre la philosophie et la vérité, ce qui ne m’apparaît pas utile. Est-ce qu’il lisait toutes ces œuvres de philosophie en prétendant que leurs auteurs prétendaient à la vérité ? À mon humble avis, aucune philosophie ne peut prétendre à la vérité. La philosophie peut à peine prétendre à une connaissance dûment constituée et sujette au doute.
Si je m’accorde avec l’idée que la connaissance se construit sur la destruction du déjà-su, je ne réfute l’idée qu’il faille aller jusqu’au « suicide intérieur » car cela implique, selon moi, un suicide de la conscience elle-même, de l’esprit lui-même. Il n’en demeure pas moins que l’expression « suicide intérieur » présente une belle image de la table rase nécessaire pour se vider de toutes croyances, de tout ce que l’on prend pour la vérité, d’autant plus, que pour plusieurs « La vérité est ce en quoi vous croyez ».
Assassiner le Nathan que j’étais et que j’aurais dû devenir : voilà la condition pour m’insinuer sur les sentiers de la philosophie.
Tel fut mon premier point de vérité dans la philosophie. Un soir, vers les derniers jours du séminaire, je ne me suis pas présenté au réfectoire pour dîner, préférant rester dans ma chambre devant une bière et mon ordinateur. Toute la nuit durant, je n’ai pas bougé de mon bureau, écrivant jusqu’à l’aube. Sincère et maladroit, mon texte tournait autour d’une intuition unique : le suicide est la seule porte d’entrée vers l’aventure de la philosophie. Par cette affirmation, je ne visais pas le suicide physique, où l’individu porte atteinte à sa vie biologique, mais bel et bien ce que je nommais le suicide existentiel, consistant à détruire toutes les données de son identité (celle de la conscience autant que des actions) afin de la reconfigurer depuis le point de départ. Seul le second recevait, à mes yeux, la valeur de la renaissance spirituelle, lui qui permettait de penser contre son âme — c’est-à-dire précisément à la racine de la pensée ouverte.
DEVERS, Nathan, Penser contre soi-même, Partie V – Les choses sont des mots, Chapitre 12, Éditions Albin Michel, 2024, p. 280.
P.S.: Le soulignement remplace l’italique dans le texte original.
Butant sur la définition de la philosophie, Nathan Devers écrit :
Mais cette impossibilité de savoir ce qu’est la philosophie n’empêche nullement de se demander qui est le philosophe. C’est quelqu’un qui pense contre lui-même. Penser contre soi-même : cette exigence inhumaine, je la définissais dans mon texte comme une envolée soudaine, un saut brusque, un bond vers l’absolu. Son objet ? Délier l’âme des rouages qui la déterminent du début à la fin. Accomplir la transition qui mène de la pensée naturelle vers la pensée philosophique.
DEVERS, Nathan, Penser contre soi-même, Partie V – Les choses sont des mots, Chapitre 12, Éditions Albin Michel, 2024, p. 282.
« Penser par moi-même » et « Penser contre soi-même », implique une conscience libre de conditionnement. Mais est-ce réellement possible ? Est-ce souhaitable de se déconscientiser ainsi pour ensuite se reconscientiser ? Est-ce sage de croire en une conscience entièrement libérée de conditionnement à force de raison ?
J’accorde au livre « Penser contre soi-même » de Nathan Devers cinq étoiles sur cinq parce qu’il m’a donné à penser… librement.

Cliquez ici pour acheter ce livre sur le site web leslibraires.ca
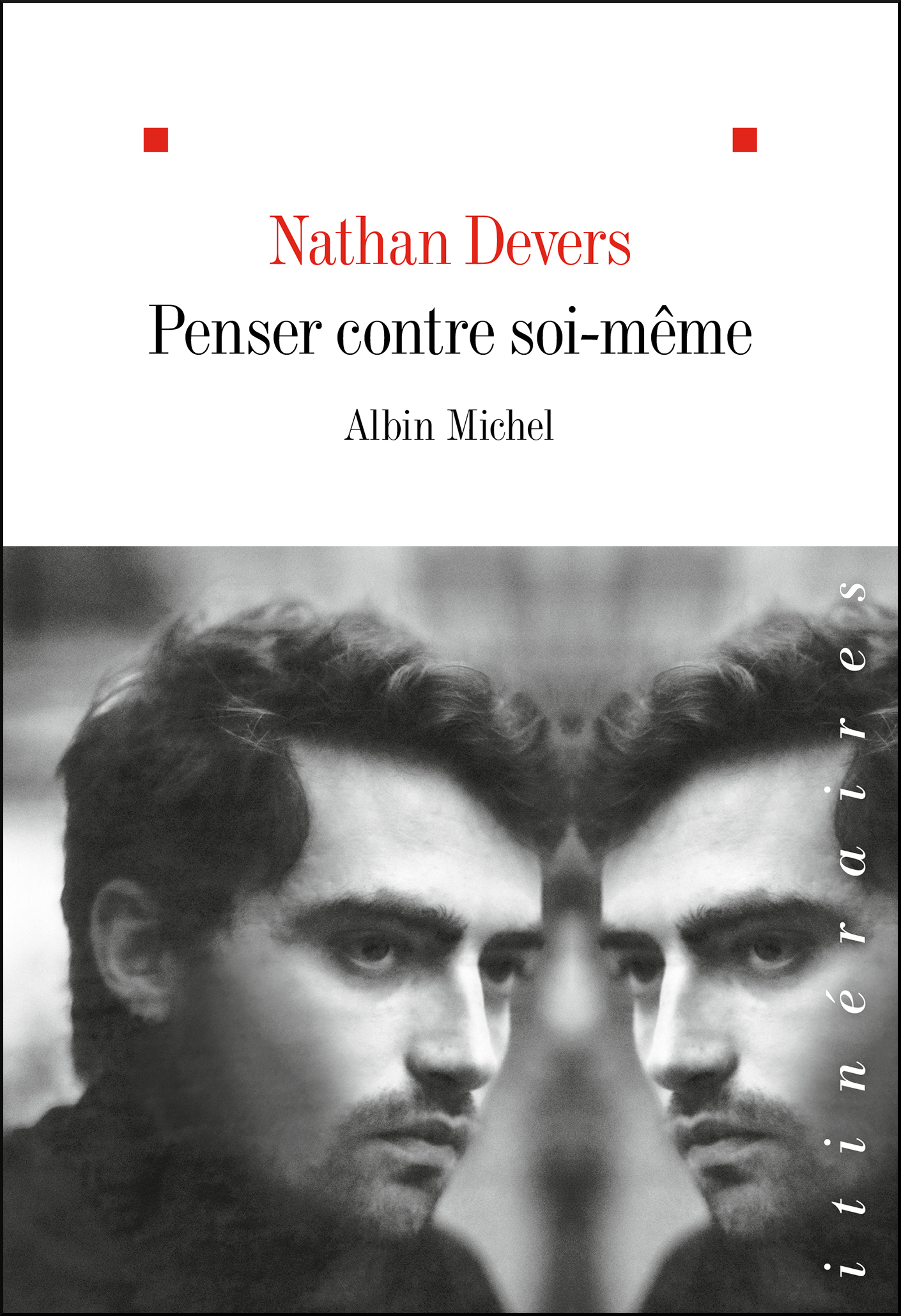
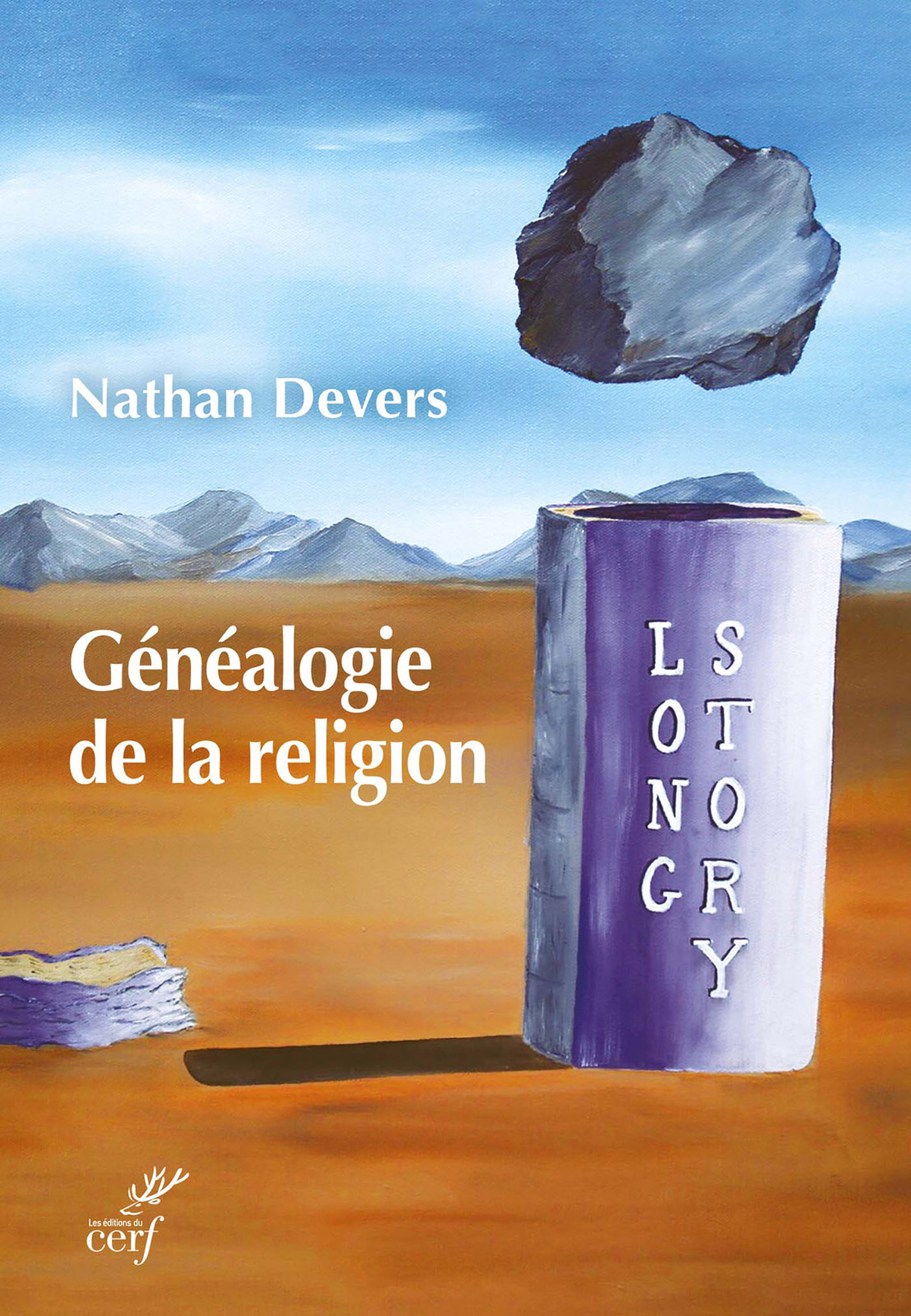
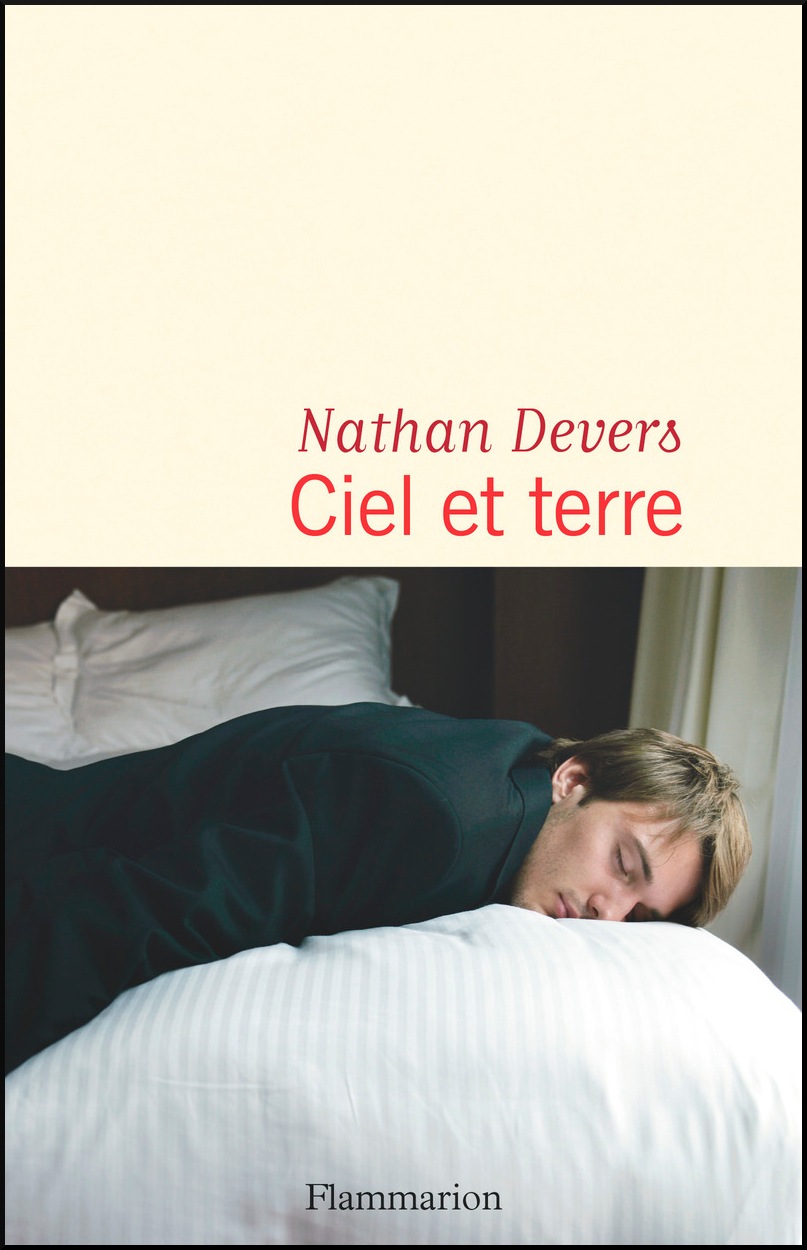
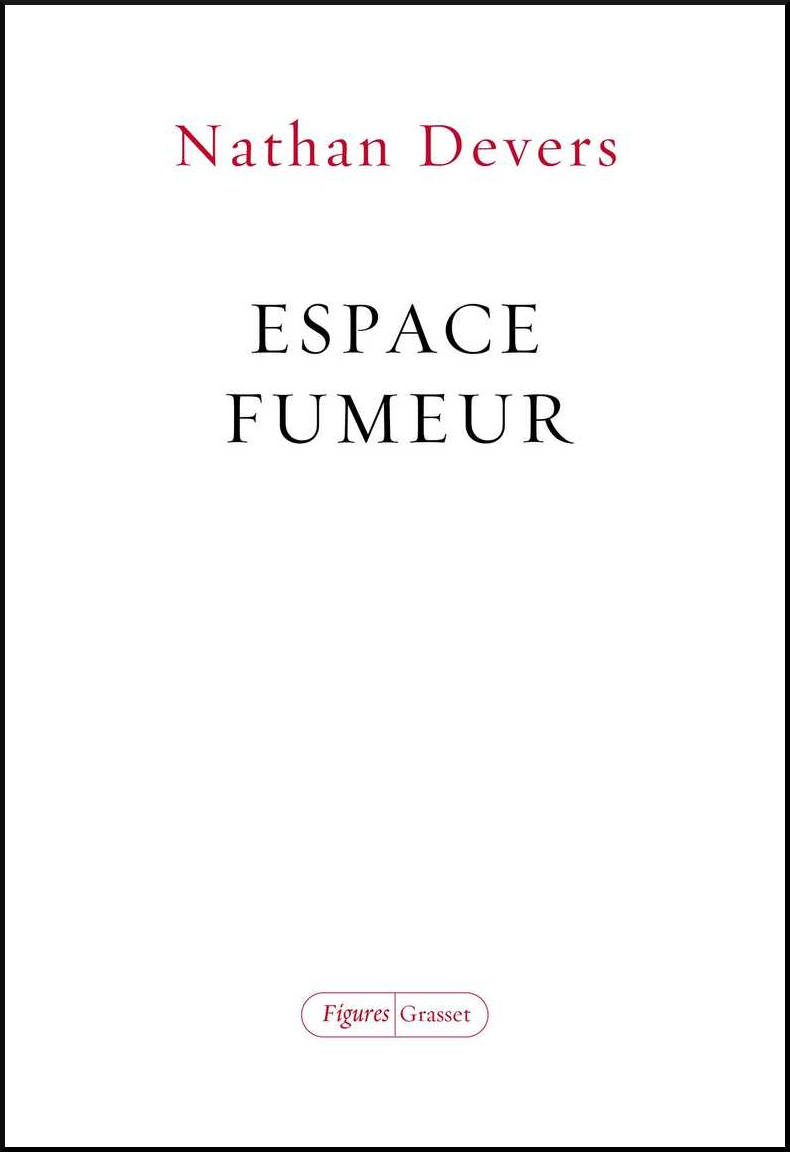

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.