
DOSSIER
Philothérapie
Consulter un philosophe
Quand la philosophie nous aide
Article # 44
Consultation philosophique : s’attarder à l’opinion ou au système de pensée ?
Dans cet article, je m’interroge à savoir la consultation philosophique doit s’attarder à l’opinion ou au système pensée du client.
OPINION
Le philosophe praticien cible l’opinion de son client en vue de démontrer l’ignorance sur laquelle elle repose et, par conséquent, l’absence de valeur de vérité qu’elle recèle. Cette pratique repose sur le « questionnement philosophique » :
Le questionnement philosophique demande d’entrer dans une démarche en combinant la problématisation, la conceptualisation et l’argumentation et d’adopter une attitude d’humilité en relativisant les opinions pour entrer dans une recherche du vrai.
Problématisation
La problématisation, c’est la capacité à interroger ses opinions et à relativiser leur évidence pour moi par le doute (ce qui permet la confrontation à l’autre différent), à analyser leurs présupposés et leurs conséquences ; à questionner les préjugés ; à comprendre en quoi une question pose problème, à entrer dans une attitude de recherche, portée par un souci de vérité.
Conceptualiser
Conceptualiser, c’est tenter de définir une notion, lui donner un contenu de signification. C’est préciser les notions portées par le langage qui nous permet de penser : savoir de quoi on parle exactement, quels sens ont les « grands mots » (amitié, vérité, justice…) pour leur donner par la réflexion une définition, un contenu délimité. Conceptualiser, c’est :
- Définir une notion, en fonction de ma propre expérience, de ma vision du monde et de la confrontation aux autres
- Donner des caractéristiques importantes d’un concept, donner des attributs de sa
définition.- Comparer des notions voisines, associées, proches ou opposées, opérer des distinctions et des rapprochements conceptuels.
Argumenter
Argumenter, c’est fonder ce que l’on affirme sur des arguments rationnels, c’est se donner des raisons convaincantes de douter ou d’affirmer.
Il existe différents types d’arguments : l’argument d’efficacité, de rentabilité, l’argument éthique, l’argument logique, esthétique, historiques, sociologiques, psychologiques.
Ces trois exigences intellectuelles permettent le passage du « dire ce qu’on pense » au « penser ce qu’on dit ».
Source : Outil 4) Le questionnement philosophique – Enseignement Catholique (lenseignement.catholique.be). http://lenseignement.catholique.be/segec/fileadmin/DocsFede/FESeC/religion/Outil_4_Le_questionnement_philosophique.pdf
La méthode « problématiser- conceptualiser – argumenter » est attribué à Michel Tozzy.
À la base de la problématisation se retrouve l’identification et l’analyse des présupposés (suppositions préalables) de l’opinion ou de la question posé par le client. Le but est de démonter ces présupposés.
Un présupposé est « une affirmation impliquée par une proposition, et sans laquelle elle ne pourrait être valide. Il faut l’expliciter, car il est généralement contenu implicitement dans la proposition » (TOZZI, M., 1996).
Voici des exemples de présupposés :
A-t-on le droit de refuser la vérité?
présupposé = la vérité existe.Doit-on renoncer aux passions ?
présupposé = on est capable de porter un jugement sur les passions et de s’en dégager.A noter que toutes les questions en « doit-on » ou « faut-il » présuppose qu’on peut le faire.
A quelles conditions est-on un homme libre ?
présupposé = on peut être libre et il y a des conditions à la liberté.Faut-il aimer la vérité?
présupposé = on peut aimer la vérité.
Le présupposé n’est pas exprimé dans l’opinion ou la question. La définition des Dictionnaires Le Robert est : « Ce qui est supposé et non exposé dans un énoncé. »
Système de pensée
Si une opinion se définit comme « Idée ou ensemble des idées que l’on a, dans un domaine déterminé » (Dictionnaires Le Robert), elle est aussi « Manière de penser, de juger » (Dictionnaires Le Robert). À mon humble avis, une « manière de penser » implique à la base un « système de pensée » et son fonctionnement.
Je me demande pourquoi le philosophe praticien se casse la tête en fondant son dialogue avec son client sur une opinion ou une question existentielle pour finalement aboutir au développement de l’esprit critique.
Je reconnais l’aspect pratique de l’opinion ou de la question du client parce qu’il se trouvera concerné plus directement dans ce qu’il pense. Mais l’important n’est-il pas comment il pense ? Non pas comment il pense l’opinion ou la question qu’il soumet au philosophe praticien mais plutôt comment toute pensée se forme en son esprit. Et si l’objectif est justement de développer l’esprit critique du client, pourquoi ne pas en faire le principal sujet du dialogue ?
Discutant de l’opinion ou de la question existentielle posée par son client, le philosophe praticien se réfère à d’autres philosophes s’étant déjà pencher sur la question et leurs réponses. Tel que mentionné plus haut, le philosophe praticien aura d’abord soumis l’opinion ou la question existentielle aux différentes étapes du questionnement philosophique pour dégager le vrai sujet à l’origine de la démarche du client.
Dans le cas de ces références à d’autres philosophes, on parle alors des différentes philosophies passées et actuelles dans l’espoir que le client repèrera une réponse qui lui convient. Le but ultime est de permettre à son client de se débarrasser du mal-être que sa question lui pose ou du mauvais chemin que lui fait prendre son opinion.
Nous sommes alors dans « les philosophies » à la différence de « la Philosophie », celle avec un grand « P ». Je considère la philosophie comme étant la science des profondeurs permettant de plonger jusqu’à la source première. Alors, ne vaut-il pas mieux s’attarder en priorité au système de pensées du client pour jeter les bases de l’esprit critique ?
Mon idée est simple : créer une faille dans le système de pensée du client pour permettre à la lumière d’entrer et ainsi l’éclairer. Comprenez moi bien : je ne parle pas ici de créer une faille dans l’opinion du client ou dans la question existentielle qui le turlupine. Je parle du système de pensée à l’origine, la source première de son opinion ou de sa question existentielle.
Clé de voute de la consultation philosophique, le doute sera cette faille qui permettra à la lumière d’entrer. Non pas le doute des détails de l’opinion ou de la questions existentielle, mais plutôt le doute systématique face à toutes les opinions et toutes les grandes questions de l’existence.
Très souvent, nous prenons pour vrai ce que l’on pense uniquement parce qu’on le pense, uniquement parce qu’elle nous vient l’esprit. Ainsi, nous nous donnons raison. Cette pratique de notre esprit nous pousse à asseoir notre bien-être sur la confiance en nos pensées. À contrario, nous ne sommes pas heureux lorsque nous n’avons pas raison, lorsque que nous sommes contrariés par les opinions des autres personnes. Dans ce cas, si débat d’opinions il y a, il se terminera trop souvent sur un « À chacun son opinion » avant de passer par un « C’est mon opinion et je la partage ».
Le problème du client n’est pas tant son opinion sur un sujet donné mais le statut qu’il accorde à toutes ses opinions, un statut de vérité ou de croyance. Et le problème se complique lorsque le client fonde, consciemment ou inconsciemment, sa valeur et même celle de son existence sur ses vérités et ses croyances, bref, sur ses opinions, ainsi devenues des jugements définitifs voire dogmatiques.
Il y a rien de moins solide qu’une opinion. Elle demeure un produit dérivé de piètre qualité du savoir et de la connaissance. Pour plusieurs individus, ce n’est pas la connaissance qui est acquise mais plutôt l’opinion qu’ils en ont. Ils ne peuvent parler de leurs connaissances qu’en exprimant l’opinion qu’ils en ont. Ils ne mettent pas en pratique leurs connaissances tirées su savoir mais plutôt l’opinion qu’ils en ont. La confusion entre le statut de l’un et de l’autre est généralement inconsciente et totale. Il exprime une opinion avec l’impression d’exprimer une connaissance, vraie et objective. Il prenne pour vrai ce qu’il pense uniquement parce qu’il le pense. En fin de compte, ils prennent connaissance que pour se faire opinion. La connaissance elle-même a peu d’importance ou elle n’a d’importance que si elle permet de se faire une opinion.
L’opinion est souvent adoptée sans même être précédée de l’acquisition d’une connaissance tirée d’un savoir. Il ne s’agit pas de se faire une opinion mais d’en adopter une. Ainsi, la très grandes majorité des opinions en circulation dans notre monde sont très rarement inédites.
Pour certaines personnes, il suffit d’avoir une opinion pour connaître. Dans un monde submergé d’opinions de toutes sortes, le choix est presque infini. Et les critères du choix d’une opinion plutôt qu’une autre varient passablement. Pour les uns, c’est la crédibilité de celui ou celle qui avance son opinion qui prime. Pour les autres, c’est la ressemblance de l’opinion avec ce que l’on pense déjà ou croit penser qui guide le choix.
Dans tous les cas, la décision en faveur d’une opinion plutôt qu’une autre repose sur des critères subjectifs. Dans le cas où la personne confond « opinion » et « connaissance », cette dernière étant associée à une certaine objectivité, on croit décider objectivement. Mais ce n’est qu’une illusion. Louis Cheskin, un chercheur américain en études des motivations, écrit :
Traduction libre
« Nous aimons croire que nous sommes objectifs, que nous sommes intéressés par l’information objective. En fait, à moins qu’une personne devienne subjective au sujet d’une information objective, elle ne s’y intéressera pas et elle ne sera pas motivée par cette information. Nous disons juger objectivement, mais en réalité nous réagissons subjectivement.
Nous faisons continuellement des choix dans notre vie quotidienne. Nous choisissons des « choses » qui nous apparaissent subjectivement, mais nous considérons nos choix comme étant objectifs. »
Texte original
« We like to believe that we are ob-jective, that we are interested in objective information. Actually, unless one becomes subjective about a new objective information, he is not interested in it and is not motivated by it.
We say we judge objectively, but actually we react subjectively. We continually make choices in daily life. We choose the « things » which appeal to us subjectively, but we consider the choices objective. »
Cheskin, Louis, Basis For marketing Decision, Liveright, New York, 1961, p. 82.
L’opinion permet d’apercevoir quelques éléments du système de pensée qui la supporte. Si toutes les opinions se valent, question de liberté de pensée et d’expression, elles ont les qualités et les défauts du système de pensée de la personne. C’est le cas des biais cognitifs.
Parmi toutes listes de biais cognitifs disponibles, je vous propose celle de « David D Burns, psychiatre américain et professeur émérite adjoint au Département de psychiatrie et des sciences du comportement de la Stanford University School of Medicine » (Wikipédia – En anglais seulement) (Site web) et auteur du livre Être bien dans sa peau. Cette liste a été établie d’après les erreurs de jugement communes aux personnes dépressives. Le psychiatre David D Burns cherchait alors un moyen de traiter la dépression sans médicament. Il a observé que ses patients parvenaient a sortir de la dépression en corrigeant leurs biais cognitifs.
Liste de biais cognitifs du psychiatre David D Burns
- Le tout-ou-rien : votre pensée n’est pas nuancée. Vous classez les choses en deux seules catégories : les bonnes et les mauvaises. En conséquence, si votre performance laisse à désirer, vous considérez votre vie comme un échec total.
- La généralisation à outrance : un seul événement malheureux vous apparaît comme faisant partie d’un cycle sans fin d’échecs.
- Le filtre : vous choisissez un aspect négatif et vous vous attardez à un tel point à ce petit détail que toute votre vision de la réalité en est faussée, tout comme une goutte d’encre qui vient teinter un plein contenant d’eau.
- Le rejet du positif : pour toutes sortes de raisons, en affirmant qu’elles ne comptent pas, vous rejetez toutes vos expériences positives. De cette façon, vous préservez votre image négative des choses, même si elle entre en contradiction avec votre expérience de tous les jours.
- Les conclusions hâtives : vous arrivez à une conclusion négative, même si aucun fait précis ne peut confirmer votre interprétation.
- L’interprétation indue. Vous décidez arbitrairement que quelqu’un a une attitude négative à votre égard, et vous ne prenez pas la peine de voir si c’est vrai.
- L’erreur de prévision. Vous prévoyez le pire, et vous êtes convaincu que votre prédiction est déjà confirmée par les faits.
- L’exagération (la dramatisation) et la minimisation : vous amplifiez l’importance de certaines choses (comme vos bévues ou le succès de quelqu’un d’autre) et vous minimisez l’importance d’autres choses jusqu’à ce qu’elles vous semblent toutes petites (vos qualités ou les imperfections de votre voisin, par exemple). Cette distorsion s’appelle aussi « le phénomène de la lorgnette ».
- Les raisonnements émotifs : vous présumez que vos sentiments les plus sombres reflètent nécessairement la réalité des choses : « C’est ce que je ressens, cela doit donc correspondre à une réalité.
- Les « dois » et les « devrais » : vous essayez de vous motiver par des « je devrais… » ou des « je ne devrais pas… » comme si, pour vous convaincre de faire quelque chose, il fallait vous battre ou vous punir. Ou par des « je dois ». Et cela suscite chez vous un sentiment de culpabilité. Quand vous attribuez des « ils doivent » ou « ils devraient » aux autres, vous éveillez chez vous des sentiments de colère, de frustration et de ressentiment.
- L’étiquetage et les erreurs d’étiquetage : il s’agit là d’une forme extrême de généralisation à outrance. Au lieu de qualifier votre erreur, vous vous apposez une étiquette négative : « Je suis un perdant ». Et quand le comportement de quelqu’un d’autre vous déplaît, vous lui accolez une étiquette négative : « C’est un maudit pouilleux ». Les erreurs d’étiquetage consistent à décrire les choses à l’aide de mots très colorés et chargés d’émotion.
- La personnalisation : vous vous considérez responsable d’un événement fâcheux dont, en fait, vous n’êtes pas le principal responsable.
Source : Burns, David D, Être bien dans sa peau, Héritage, 2005.
Il suffit d’un seul biais cognitif pour démontrer la faiblesse d’une opinion. Plus encore, le et les biais cognitifs agissent non seulement sur une seule opinion mais sur l’ensemble des opinions, Un biais cognitif est « une tendance à… ». Sa source n’est autre que le système de pensée lui-même.
Permettre au client d’une consultation philosophique de prendre conscience de son système de pensée, de comment il pense, y compris de ses biais cognitifs, permet de remonter à la cause première de son mal-être.
Il ne s’agit plus ici du questionnement philosophique décrit plus haut, mais plutôt de faire du système de pensée du client le seul et unique sujet de la consultation. Le dialogue sur ce sujet doit permettre des prises consciences et l’acquisition de connaissances qui lui serviront de boîte à outils pour son bien-être. Il faut aller sans détour à la cause première du mal-être, le système de pensée lui-même. L’opinion ou la question existentielle soumise par le client ne sera utile, non pas que si on creuse cette opinion ou cette question sous tous les angles philosophique, mais comme porte d’entrée vers le système de pensée du client.
Pour atteindre son but, développer l’esprit critique de son client, le philosophe praticien doit transmettre des connaissances à la conscience au sujet de l’esprit critique.
Je comprends le philosophe praticien puisse se donner le même objectif par le questionnement philosophique en prenant comme sujet l’opinion ou la question existentielle du client. Il espère que l’expérience du questionnement philosophique vécu par le client contribuera au développement de son esprit critique. Cependant, la connaissance acquise par le client ne concerne que l’expérience vécue, c’est-à-dire le questionnement philosophique, l’opinion qu’il en aura et les quelques citations des philosophes se rapportant à sa situation.
Le client apprendra peut-être l’utilité du doute mais il ne saura pas nécessairement comment en tirer le bénéfice de façon générale, en toute connaissance de cause, à moins de devenir lui-même un expert du questionnement philosophique et un exégète des philosophies.
Si le questionnement philosophique n’a pas de limite en soi, l’expérience vécue par le client est d’abord psychologique, davantage psychologique qu’intellectuelle. Même si le client témoigne de son ouverture à l’expérience philosophique puisqu’il a lui-même pris rendez-vous, il ne faut pas minimiser l’appréhension naturelle de l’Homme face à l’inconnu, sa fébrilité face à une première rencontre, bref son état psychologique. Le questionnement philosophique ne laisse que peu ou pas du tout d’espace au psychologique. Or, douter est d’abord et avant tout un acte psychologique qui requiert la plus grande attention de la part de celui ou celle qui le soulève.
En résumé, l’expérience du questionnement philosophique, avec son impact psychologique, ne facilite pas la transmission des connaissance utiles à la naissance et au fonctionnement de l’esprit critique.
Il m’apparaît plus sage de précéder l’expérience d’un esprit critique d’une connaissance de ce qu’est un esprit critique et comment le développer.
Évidemment, on peut toujours apprendre sur le tas mais le client n’est pas un apprenti lors de la consultation philosophique. La démonstration orchestrée par le philosophe praticien et ayant pour sujet la question existentielle de son client demeure une démonstration et non pas un enseignement proprement dit. Il est espéré du client une analyse de cette démonstration de laquelle il tirera un apprentissage du questionnement philosophique pour son propre profit. Or, le client ne dispose pas de la base théorique pour une telle analyse. Le client porte son attention sur les questions du philosophe praticien et les réponses qu’il lui donne. Il ne s’arrête pas nécessairement à la fois au contenu et au contenant. Lors d’une consultation philosophique, le client participe (contenu) davantage qu’il observe (contenant).
Système de penser – Lutter contre ses opinions
Tous s’entendent sur l’importance d’apprendre à douter de ses opinions pour développer son esprit critique. Un client prisonnier de ses opinions doit être libéré (voir : Article # 27 – Êtes-vous prisonnier de vos opinions ?). Plus le client se donne raison sur la base de ses opinions, plus il démontre que son bien-être repose sur le fait d’avoir raison. Peu importe la théorie et ses propres expériences, l’important est qu’elles lui donnent raison. Ce client n’est pas heureux lorsqu’il n’a pas raison. Il déteste l’incertitude, cette dernière étant vécu comme un vide dont sa nature à horreur, un vide à combler. Le lien du client à ses opinions est (très) émotif, aussi émotif que peut l’être son bien-être.
Dans ce contexte, le client accorde une valeur fondamentale à ses opinions et, par conséquent, il fonde sa propre valeur sur ses opinions. Lui dire « qu’il n’est pas important d’avoir raison et qu’il vaut mieux mise sur un esprit critique » ne le servira pas. Déplacer la valeur fondamentale d’une personne de ses opinions vers sa faculté de penser, du fruit à l’arbre puis au racine de cet arbre, demande doigtée et empathie parce que l’opération implique aussi un changement d’attitude.
Or, on n’abandonne pas une attitude pour la remplacer par une autre. À lui seul le temps de remplacement d’une attitude est insupportable en raison de l’incertitude. Une attitude est toujours détrônée par une autre, sans aucun temps mort. Il n’y a pas d’incertitude mais victoire d’une attitude sur une autre.
Et puisque l’attitude est le dernier maillon de la chaîne du traitement des sensations, juste avant le comportement, c’est l’attitude qui dicte finalement le comportement à adopter. Aussi, on sait que les changement de comportement interviennent à la suite d’une révélation ou d’un traumatisme.
Traduction libre
Le comportement d’un individu se base sur son schéma de références. Le schéma de références d’un individu détermine ses attitudes. Consciemment et inconsciemment, un individu acquiert des concepts qui deviennent une partie de lui-même et qui sont la base de toutes ses attitudes. Le schéma de références est acquis des parents, des enseignants, des relations et des amis, du type d’émissions de radio que nous entendons, des émissions de télévision que nous regardons et du type de livres, magazines et journaux que nous lisons. La plupart d’entre nous croyons tirer des faits de ces sources, non pas des attitudes. Nous pensons que nous avons accumulé des informations objectives, non pas un schéma de références.
Texte original en anglais
An individual’s behavior is based on his frame of refer-ence. A person’s frame of reference determines his attitudes. Consciously and unconsciously one acquires concepts that become part of him and are the basis of all his attitudes. The frame of reference is acquired from parents, teachers, relatives and friends, from the type of radio pro-grams we hear, the T.V. programs we watch and from the kind of books, magazines and newspapers we read. Most of us believe we acquire facts from these sources, not attitudes. We think we have accumulated objective information, not a frame of reference.
Cheskin, Louis, Basis For marketing Decision, Liveright, New York, 1961, p. 82.
La sensation donne lieu à une perception et une question se pose à savoir qu’elle attitude (comportement) à adopter face à cette perception. Pour ce faire, la perception sera évaluée en relation avec le schéma de références de la personne pour déboucher sur l’attitude à adopter qui sera traduite par le comportement. Exemple :
J’ai été élevé dans une famille très politisée en raison de la présence d’un politicien dans la grande famille de l’un de mes parents. Lorsque mon père parlait, il avançait telle ou telle opinion et il se donnait raison avec une très grande force de conviction. Il en allait de même d’autres membres de cette grande famille. Jeune adolescent, je croyais qu’être adulte procurait le pouvoir de se donner raison sur les autres. Cette idée fut inscrite dans mon schéma de référence et dictait ma conduite avec les jeunes de ma génération voire même quelques adultes. Puis, un dimanche soir, un animateur à la radio m’a révélé que les gens qui se donnent raison vivre dans un système de pensées sans faille et que c’est justement par les failles que la lumière entre. Ces failles, c’étaient le doute. Mon schéma de référence a enregistré cette révélation et mon attitude et mon comportement ont changé face aux personnes qui se donnent raison pour tout et pour rien, et j’ai moi-même abandonné l’idée de me donner raison.
C’est dans ce contexte que je me suis donné comme maxime : « Si vous avez une meilleure idée que la mienne, n’hésitez pas à me la donner que je ne perde pas de temps ».
Ma valeur repose donc sur mon esprit critique et la capacité de ce dernier à douter, bref, à la base, sur ma faculté de penser. En amont, ma faculté de penser tire sa valeur ultime de la vie qui m’habite et du fait d’Être. Que j’ai on non raison n’a aucune importance.
Je me rallie au propos du neuropsychologue Antonio Damasio : « J’existe, donc je pense », par opposition au « Je pense, donc j’existe » du philosophe et mathématicien René Descartes. Ma valeur ne repose plus sur mes opinions, avis, jugements… mais sur le fait incontestable que j’existe et que cela me permet de vivre et ainsi de penser.
C’est là, à mon avis, qu’il faut amener le client d’une consultation philosophique. Mettre en lumière une valeur fondamentale stable et incontestable, peu importe ce qu’il pense, de par son existence (son Être), sa vie et sa faculté de penser. Personne ne peut remettre en question le fait de son existence, son Être, à moins d’un défaut de compréhension de ces concepts. Il se trouve ainsi libéré de la prison de ses opinions et de l’oppression de l’incertitude. Il peut douter librement de tout son Être, raisonné et sensible.
Un esprit critique en exercice sera à la fois rationnel et émotif
parce que la raison n’est rien sans les émotions.
Voir : Article # 42 – L’erreur de Descartes, Antonio Damasio, Odile Jacob, 1995.
Le bénéfice du doute
Pour plusieurs personnes, le doute est synonyme d’incertitude et celle dernière d’inconfort souvent insupportable tant par la raison et les émotions. S’exprime ici un préjugé face au doute alors associé à une certaine faiblesse d’esprit.
Nous évoluons dans un monde où la crédibilité d’une connaissance augmente avec la force de conviction de celui qui l’avance. Cette force de conviction laisse peu de place au doute. Nous ne sommes pas invités à réfléchir à cette connaissance pour en douter ou la remettre en question mais y croire, hors de tout doute. Nous pensons et nous agissons, consciemment et/ou inconsciemment selon cette référence négative au doute. Nous n’aimons pas douter ou nous doutons que si cela nous permet de remettre en cause une connaissance qui nous indispose, c’est-à-dire contraire à nos valeurs, et, le cas échéant, nous diagnostiquons une faiblesse d’esprit chez soi ou chez l’autre. Dans ce cas, je qualifierais ce doute de pervers.
Ainsi pratiquer, le doute ne nous apparaît pas comme porteur d’un bénéfice. L’expression « savoir tirer le bénéfice du doute » soutient que nous pouvons apprendre à tirer un bénéfice du doute, qui ne soit pas négatif, par exemple, autre chose que l’inconfort.
Quel est le bénéfice du doute ?
Permettez-moi de vous surprendre : le bénéfice du doute, c’est la certitude. Concernant une connaissance, il ne s’agit pas d’une certitude définitive mais plutôt admissible comme une vérité. Et il est permis de douter cette vérité.
Pour l’esprit critique, toute vérité n’a de valeur que si elle est remise en question, admise pour un temps, sujette au doute, à la destruction par une vérité meilleure. Cette approche provient de la science. La connaissance scientifique se bâtit sur la destruction du déjà-su. Ainsi, la connaissance scientifique suit obligatoirement une évolution; seule une meilleure connaissance peut en détruire une autre et prendre sa place.
Pourquoi notre esprit critique ne pourrait-t-il pas adopter ce processus de la pensée scientifique ?
« Si vous avez une meilleure idée que la mienne, n’hésitez pas à me la donner que je ne perde pas de temps ».
Le doute est avant tout une affaire de philosophie. Douter de ses opinions. Douter des vérités admises. Douter de nos certitudes. Douter de la vie que nous menons. Douter de nos émotions. Douter du diagnostique que nous posons sur nous et les autres. Douter de nos valeurs. Douter de notre esprit critique. Douter de nos attitudes. Et ainsi de suite.
La valeur suprême : l’Existence
On peut douter de tout à l’exception de notre valeur fondamentale, ultime, car elle repose sur le fait d’Être ou l’Existence. On ne parle pas ici de quelque chose qui existe mais de l’existence elle-même. On l’explique aux lycéens en ces mots : « L’être n’est pas quelque chose qui existe, mais l’existence elle-même (…) » (source : Kidsvacances).
Cette valeur ne peut pas être remise en question. Elle est donc la plus sûre et la plus solide qui soit. Personne ne peut douter de votre Existence, pas même vous. Cette valeur n’implique aucun jugement.
La reconnaissance de la valeur fondamentale de l’Existence doit être au cours de la consultation philosophique parce qu’elle permet à l’esprit critique de prendre librement son envol et ainsi, par exemple, de remettre en question les autres valeurs que nous avons adoptées, et ce, sans nous déstabiliser ou nous dévaloriser. L’attachement par la raison et les émotions à ces autres valeurs peut aveugler l’Existence ou, si vous préférez, on peut Être inconscient de sa valeur.
Conclusion : valoriser le savoir et la connaissance
Dans ce texte, je me demande si le philosophe praticien doit porter son attention sur les opinions et les questions existentielles ou le système de pensée du client. Je mets de l’avant une réponse : le système de pensée. C’est le système de pensée qui formate les opinions et les questions du client. Ainsi, un système de pensée défectueux ne saurait déboucher sur des formulations en adéquation avec la réalité perçue et vécue. Il faut corriger les défauts de pensée et de logique à la source.
Lutter contre ses opinions les unes après les autres ne m’apparaît pas comme une solution durable. S’il faut que le client entretienne un doute face à chacune de ses opinions, il n’est pas sorti du bois. D’où l’importance d’aller à la source même de l’opinion, là où elle est pensée, c’est-à-dire le système de pensée. La question essentielle est : « Comment je pense ? »
Enfin, le savoir et la connaissance que j’en tire sont plus importants que les opinions que j’en ai. Lutter contre ses opinions, c’est aussi lutter contre les liens émotif et subjectifs que nous entretenons avec elles, contre le statut et la valeur de vérité que nous leurs accordons.
La consultation philosophique doit permettre de valoriser le savoir et la connaissance auprès du client, notamment de son système de pensée.
EN COMPLÉMENT
Vous trouverez ci-dessous les chapitres LA PENSÉE CERTAINE et LA PENSÉE PROFONDE tiré de mon essai et témoignage de gouvernement personnelle, J’AIME PENSER – Comment prendre plaisir à penser dans un monde où tout un chacun se donne raison.
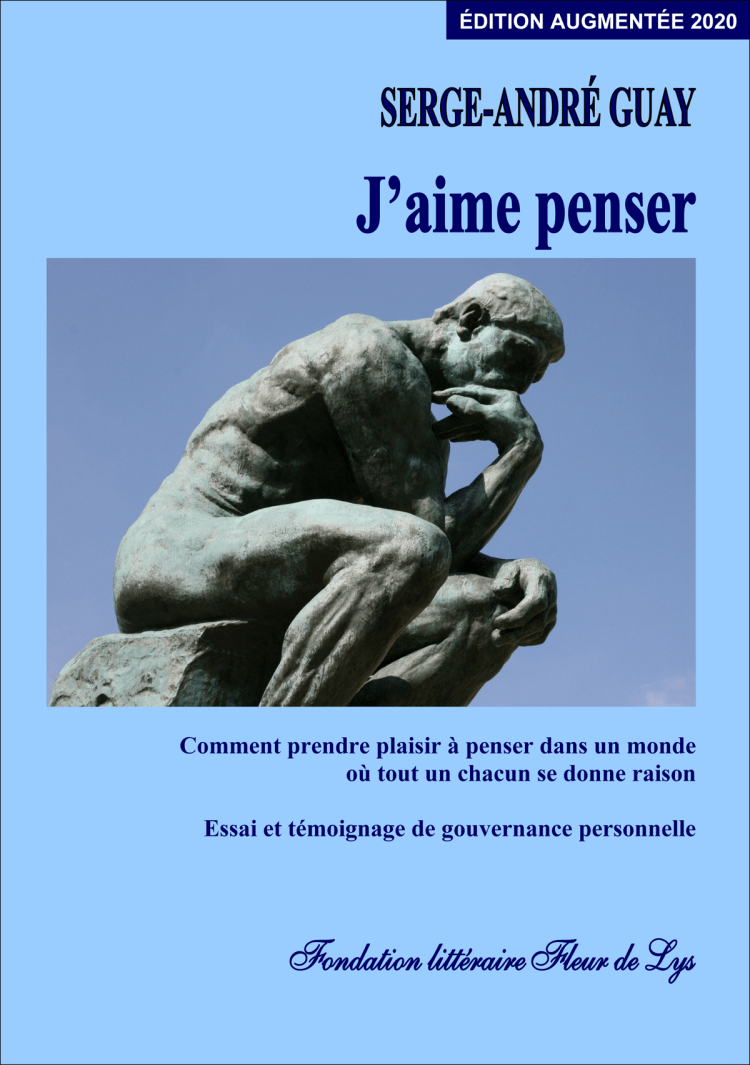
La pensée certaine
Pour tirer le bénéfice du doute – Il fut un temps où la pensée était certaine uniquement si les autorités religieuses la cautionnaient. Nous sommes au Moyen Age. À cette époque, un homme avait raison que si l’église lui donnait raison. Les autorités religieuses s’étaient attribuées le monopole de toute certitude en se donnant le titre de représentantes suprêmes de Dieu sur Terre.
Parlons-en de la Terre. Un homme avait beau se lever et démontrer que la Terre n’était pas au centre de l’univers d’après de savantes observations, si les autorités religieuses ne lui donnaient pas raison, il avait tort et la Terre demeurait au centre de l’univers. Un autre pouvait bien prouver que la Terre était ronde comme une orange et non pas plate comme une assiette, selon de savants calculs, si l’église préférait ses raisons de croire la Terre plate, l’homme avait tort et devait se taire.
Aussi, un homme ne s’est pas levé de bon matin avec la ferme intention d’avoir raison et de donner tort à l’église. Ce n’est pas comme cela que l’homme de cette époque en est venu à se donner raison. Mais un homme s’est effectivement levé un matin en se demandant, sans doute pour la ixième fois, pourquoi la raison toute puissante de l’église, au lieu d’engendrer le bien et l’Amour, conduisait à des guerres de religions plongeant les hommes, les femmes et les enfants de l’Europe dans les douleurs les plus terribles. Faire le mal pour faire le bien ne parut sans doute pas tout à fait logique à cet homme, d’autant plus que le bien se faisait attendre, toujours repoussé un peu plus loin. Bref, cet homme doutait de l’efficacité de la raison de l’église.
Il ne fut pas le premier à entretenir un tel doute, mais la mise à mort imposait le secret et limitait ainsi très sérieusement les discussions sur le sujet.
Cependant, cet homme médiéval fit un pas de plus que les autres : il se questionna à savoir s’il n’y avait pas une autre source que l’église pour donner raison à la connaissance. Il se mit donc silencieusement à la recherche d’une autre source de certitude. Et s’il ne fut ni le premier à douter dans l’histoire de l’Homme, ni le premier à en tirer profit, il fut le premier à y voir le bénéfice de la certitude.
Voici comment je comprends le raisonnement de cet homme, certes, modestement mais suffisamment pour m’éclairer. La vérité se manifeste quand je ne puis plus douter mais pour ce faire je dois douter de tout de peur de me tromper dans une fausse vérité.
Ainsi, la première certitude acquise par cet homme est celle de son existence: je doute mais tandis que je doute, je ne puis douter que je pense et si je pense je suis au moins en tant que je pense. Conclusion: Je pense donc je suis ou j’existe.1 Les penseurs parmi nous auront reconnu notre homme, René Descartes, philosophe, mathématicien et physicien français ayant vécu de 1596 à 1650.
Cette première certitude revient à dire que je ne peux pas douter de mon existence tant et aussi longtemps que je pense. Dans l’affirmative, cela nous donne : j’ai la certitude de mon existence tant et aussi longtemps que je pense. Pas besoin de l’église pour me confirmer que j’ai raison d’admettre ainsi mon existence. Je peux donc produire une connaissance certaine, avoir raison, par moi-même, indépendamment des autorités religieuses. À partir de ce moment-là, la certitude de la pensée humaine s’ajoute définitivement à la certitude de la pensée divine, que prétend posséder l’église.
Descartes va ensuite chercher à savoir s’il peut étendre cette première certitude à d’autres sujets, en dehors de son existence. Le chemin à suivre est le même : tant qu’un doute subsiste dans mon esprit, je ne puis me permettre d’être certain de quoi que ce soit. Ce faisant, je ne peux plus prendre pour vrai tout ce qui vient à ma pensée, seules mes pensées dont je ne pourrai plus douter seront certaines.
Mais la certitude ne viendra pas de n’importe quel doute qui hante mon esprit; il faut un doute systématique, « qui procède avec méthode, dans un ordre défini, pour un but déterminé »2. Descartes fera donc du doute systématique la première règle de sa méthode qu’on peut résumer ainsi : le doute systématique de tout ce que je sais, de toutes les évidences apparentes pour qu’ensuite je produise systématiquement ma connaissance à partir d’un contrôle, d’une maîtrise de chacune des opérations de pensée que j’effectue lorsque je connais. Autrement dit, douter uniquement de ce que je veux et uniquement quand cela me tente ne sera pas utile. Le risque d’erreurs demeure le même.
Pour être certain, je dois donc soumettre tout ce que je sais à un doute intentionnel et organisé. Descartes nous invite à douter de toutes les évidences apparentes, de tout ce qui apparaît à notre esprit comme une vérité. Notre esprit a le défaut de prendre pour vrai ce qu’il pense. C’est pourquoi un doute systématique de tout ce que nous pensons s’impose.
Tant et aussi longtemps que je crois penser une vérité, mon esprit ne remettra pas en cause cette vérité. Si une autre vérité se présente, plus certaine, je risque de la rejeter parce que je crois déjà détenir la vérité, parce que je ne doute pas de la vérité que je détiens. Comment éviter de passer à côté d’une vérité ou découvrir si je suis dans l’erreur ? En laissant planer un doute sur toutes les vérités que j’ai déjà acquises, sur tout ce que je sais.
Dans les faits, la certitude d’une connaissance grandit toujours en repoussant la certitude d’une autre connaissance, d’une connaissance jusque-là prise pour vraie. La certitude que la Terre est plate a cédé sa place à la certitude que la Terre est ronde. Mais pour cela, il fallut que l’homme puisse douter que la Terre était plate. Si je doute, dès le départ, de tout ce que je sais, je m’expose à la possibilité d’une plus grande certitude. Je m’accorde la possibilité d’être induit en erreur par une fausse vérité. Pour ce doute général, je n’ai besoin d’aucune raison, si ce n’est mon souci d’éviter l’erreur par une trop grande certitude. Notre affirmation « Je pense que… » devrait être reformulée en « Jusqu’ici, je pense que…. », pour exprimer le doute garant de notre ouverture d’esprit à une plus grande certitude.
Et tant et aussi longtemps que nous n’exprimons pas notre doute, nous donnons à l’autre l’impression de prendre pour vrai tout ce que nous pensons. Nous cachons notre ouverture d’esprit à l’autre et nous l’incitons à faire de même. Lorsque notre esprit constate cette absence apparente d’ouverture d’esprit chez l’autre, son attitude est différente que s’il constatait le contraire, ne serait-ce qu’une toute petite ouverture d’esprit. Cette attitude incite notre esprit à « affirmer » plutôt qu’à « proposer », c’est-à-dire à « donner (une chose) pour vraie, énoncer (un jugement) comme vrai » plutôt que de « soumettre », de « faire connaître » à l’autre une connaissance sans la prétendre nécessairement vraie dès le départ. En termes imagés, notre esprit a tendance à mettre le point sur la table plutôt qu’à tendre la main lorsque les apparences lui laissent croire que l’autre n’a aucun doute, aucune ouverture d’esprit. Il en va de même de l’autre lorsque son esprit dresse le même constat à notre égard.
Alors, ce qui est dit n’est pas vraiment discutable puisque chacun avance ce qu’il considère comme une vérité. On peut discuter uniquement lorsque la valeur de la connaissance n’est pas certaine. Comprenez-moi bien : il y a vraiment discussion uniquement dans le cas où c’est la vérité d’une connaissance qui est l’enjeu. En d’autres temps, nous devons parler d’un débat d’opinions où des vérités s’affrontent.
Nous pouvons attribuer au moins quatre grandes différences entre la discussion et le débat d’opinions :
1. Dans une discussion, on cherche avec la vérité d’une connaissance. Dans un débat d’opinion, on cherche à imposer sa vérité.
2. Dans une discussion, je m’adonne avec l’autre à l’étude de la vérité sans rien prendre pour acquis. Dans un débat d’opinions, je m’oppose à l’autre en prenant pour acquis que je détiens la vérité.
3. Dans une discussion, chacun s’enrichit de la recherche de la vérité. Dans un débat d’opinions, chacun se contente de défendre sa propre vérité.
4. Dans une discussion, l’autre peut me donner raison et je peux donner raison à l’autre. Dans un débat d’opinions, l’autre ne peut pas me donner raison et je ne peux pas donner raison à l’autre, si ce n’est pour le piéger en vue de faire triompher ma vérité sur la sienne.
Seule l’ouverture d’esprit, entretenue par le doute, détermine si nous discutons de la vérité ou si nous débattons de nos opinions.
Aussi, j’ai passablement cherché à discuter de la vérité pour conclure que la plupart des gens ont davantage l’habitude des débats d’opinions que de la discussion. Celui qui doute a tout le recul nécessaire pour s’apercevoir que la plupart des gens ont le nez collé à « leurs » vérités. Nous vivons dans un monde d’opinions ou très peu de vérités sont réellement discutées, même dans nos relations intimes. L’enfant apprend vite à défendre son opinion, très peu à en discuter. Il imite les adultes.
Dès qu’on laisse voir qu’on a un doute sur ce qu’on pense, l’esprit de l’autre y voit une faiblesse, une occasion d’imposer sa vérité toute faite. Dans un monde aussi vantard d’être certain à chaque fois qu’il ouvre la bouche, il n’est pas étonnant que le doute soit perçu comme une faiblesse. Le plus fort est certain et le plus faible doute. Ainsi, la plupart des gens apprennent vite à cacher au monde leur moindre doute, de peur de voir le loup entrer dans la bergerie.
Certaines personnes sont si profondément convaincues de la nécessité d’être certaines, face aux autres et à elles-mêmes, que le plus petit doute les rend mal à l’aise, inconfortables. Si jamais le doute persiste, la déprime les gagne. Elles perdent leur assurance, leur confiance en soi et leurs certitudes, sans différenciation. Cette indifférenciation généralise la déprime jusqu’à la dépression.
Or, l’assurance se rapporte à nos convictions, la confiance en soi à nos capacités et la certitude aux connaissances accumulées. Une pensée responsable doit faire ces différenciations (différences de fonctions) sans quoi l’assurance, la confiance et la certitude sont soumises à l’effet domino (la chute de la première entraîne celle de la deuxième et cette dernière entraîne la chute de la troisième).
Dans la pensée responsable, douter de la certitude de ses connaissances n’est pas associé à une faiblesse ou à un manque de confiance en soi mais à une force. La force de déceler ses erreurs de connaissance et ainsi de pouvoir prendre de l’expérience puisque cette dernière, après tout, est la somme de nos erreurs. La personne qui ne doute pas ne peut pas relever ses erreurs et prendre de l’expérience. Aussi, la pensée responsable limite la pratique du doute à la raison, au cerveau pensant, bref, à la conscience.
La pensée responsable peut étendre le doute à la connaissance de soi, y compris, à nos capacités en tant que personne, et à nos convictions mais uniquement sous une perspective rationnelle. Le doute recommandé par Descartes est celui organisé par la pensée rationnelle, à distinguer de la pensée émotionnelle (sous l’emprise des émotions et des passions), de la pensée spirituelle (qui sous-tend les croyances), de la pensée initiatique (qui modèle la vision de soi et du monde). Qu’importe l’objet du doute, il ne peut pas porter sur un autre aspect que l’aspect rationnel de cet objet.
Par exemple, je peux douter de l’existence de Dieu avec ma raison, c’est-à-dire examiner s’il m’apparaît raisonnable de croire en l’existence de Dieu, mais je ne peux pas douter de l’existence de Dieu avec mes émotions et mes convictions. En fait, l’existence de Dieu relève des croyances, fondées sur des connaissances révélées plutôt que rationnelles. Autrement dit, la croyance en l’existence de Dieu ne peut pas être fondée sur la raison seule, les connaissances et la compréhension raisonnable. Ainsi, je peux entretenir un doute raisonnable quant à l’existence de Dieu mais une profonde conviction (révélation personnelle) peut m’en convaincre au-delà de ce doute de la raison.
La pensée responsable est respectueuse de tout mon être dans toutes ses composantes et n’accorde pas la permission de douter de tout et de rien, à tort et à travers. Seul le doute raisonnable de ce qui est raisonnable est permis et elle sait que tout n’est pas raisonnable. Aussi, elle sépare la raison des émotions, le cerveau pensant du cerveau émotionnel, tout comme elle sépare le cœur de la raison. Et si jamais des liens sont reconnus entre le cerveau pensant et le cerveau émotionnel, la pensée responsable les respectera. Nous verrons d’ailleurs que ces liens existent.
Ainsi, je peux douter de mes convictions mais je ne peux pas permettre à la raison seule de réduire mes croyances à néant. Je peux douter de mes capacités mais je ne peux pas permettre à ma conscience de prétendre connaître et comprendre toutes mes capacités et de poser un jugement définitif sur ma personne. Il y a aussi les capacités fournies à ma personne par mon cerveau émotionnel, généralement inconscientes ou hors de portée de l’analyse de la raison.
La personne abattue au moindre doute demeure dans l’ignorance de ces différenciations. Son doute n’est pas raisonnable et ne peut que l’entraîner dans la déprime voire la dépression. Seul un doute raisonnable est utile car il permet une pensée certaine tout aussi raisonnable.
Non contrôlé par la raison, le doute devient maladif. Il court partout où il n’a pas raison (et ce n’est pas une figure de style), partout où la raison n’a pas juridiction et il fout librement le trouble, comme un virus mortel. La pensée certaine doit s’obliger à être raisonnable, autrement, elle produit l’incertitude plutôt que la certitude et les connaissances s’emballent et font chavirer le navire.
Personnellement, je doute de mes connaissances sans que cela n’enlève de la valeur à ma raison, au contraire, pour moi, la raison sans le doute n’a pas de valeur. Je doute aussi de mes capacités en tant que personne mais raisonnablement, c’est-à-dire sans jamais prétendre que toutes mes capacités sont réduites ou que mon jugement porte sur toutes mes capacités. Il y a des capacités cachées à ma conscience, souvent, insoupçonnables. Et pour que ma conscience ne puisse plus me jouer des tours de logique en me rendant incapable de tout, je lui reconnais une capacité intelligente qu’elle ne peut pas attaquer : la capacité de douter. Tant que je doute, je suis intelligent. Enfin, je doute de mes convictions mais jamais je ne laisse ma raison seule fonder mes convictions, mes croyances. Certains événements ébranlent très sérieusement mes convictions, parfois même je perds une conviction profonde dans la tourmente, mais j’ai trouvé ici encore un moyen de m’en tenir à un doute raisonnable. Je reconnais à mon cœur une capacité immuable, inattaquable par la raison : la capacité de croire en quelque chose. Ainsi, même lorsque je ne crois plus en rien, j’ai tout de même la capacité de croire en d’autres choses, d’acquérir de nouvelles croyances voire de nouvelles valeurs.
Ainsi organisé, impossible d’admettre raisonnablement : « Je n’ai plus confiance en moi ». Car mon moi s’étend bien au-delà des limites de ma raison. Si j’existe parce que je pense, la qualité de mon existence est loin de dépendre uniquement de mes pensées raisonnables, de mon cerveau pensant. Lorsqu’on a perdu confiance en soi, il faut savoir qui pense, son cœur ou sa raison.
Absolument certains de ne plus pouvoir se faire confiance, de cœur et d’esprit, certains tombent dans la pensée malheureuse.3
Revenons à l’inconfort du doute. Certaines personnes mal à leur aise refoulent leurs doutes au plus profond d’elles-mêmes dans l’espoir de ne plus jamais les voir ressurgir, convaincues qu’il faille être certain, même aveuglément. Ces personnes se privent ainsi de la possibilité de tirer le bénéfice du doute. Ainsi, parmi elles, se retrouvent les gens conservant les mêmes vérités toute leur vie. Ces gens resteront sensiblement sur les mêmes positions, souvent avec la même attitude de certitude, de l’adolescence ou du début de leur vie adulte à la vieillesse. Plus une personne est certaine, moins elle a l’opportunité d’évoluer, à tout le moins, en changeant ses idées actuelles pour de meilleures.
Dans le secret de son intimité, la personne privée de doute considère ses idées comme étant les meilleures qu’elles puissent adopter. Dans le public, deux choix s’offrent à elle pour faire bonne figure, soit elle reconnaît ses idées n’étant peut-être pas les meilleures mais que ce sont les siennes, soit elle soutient adopter une meilleure idée mais uniquement si elle la juge personnellement vraiment meilleure. Dans tous les cas et qu’importent ses dires, la personne privée de doute conserve « ses » idées. Elle en fait une affaire strictement personnelle. Nous approfondirons le sujet au chapitre de la pensée universelle à laquelle nous opposerons la pensée personnelle car il y a des gens prêts à tout pour préserver la certitude de leurs pensées personnelles même si ces dernières sont contredites par des vérités universelles, des vérités vraies pour tous les êtres humains.
La difficulté de douter apparaît dans la « simple conscience » et disparaît dans la « double conscience », reste l’effort. Oui. Je m’explique. Lorsque je dis « Je sais », c’est une question de simple conscience. Lorsque je dis « Je sais que je sais », c’est la double conscience qui intervient. Dans « Je sais que je sais », il y a une vérification de ce que je sais. Dans la simple conscience, il n’y a pas de vérification, je ne me questionne pas à savoir si je sais vraiment. Dans la simple conscience, je me réfère aux évidences apparentes ou à l’expérience immédiate, d’où que je puisse rapidement conclure « Je sais » ou « Je ne sais pas ».
L’expérience immédiate se réduit généralement à la connaissance accumulée à l’aide des sens (goût, odorat, ouïe, toucher et vue). Elle n’est pas inutile, au contraire, elle nous permet de combler nos besoins de base et de vivre en toute sécurité. Par exemple, c’est par l’expérience immédiate de l’odeur d’un aliment mauvais au goût que je garderai cette odeur en mémoire. Si jamais je fais à nouveau l’expérience immédiate de cette odeur, le souvenir aidant, je n’aurai pas besoin d’y goûter pour savoir qu’il est mauvais. Autre exemple, c’est l’expérience immédiate connue qui m’évitera de me brûler à nouveau en passant ma main dans la vapeur s’échappant d’un chaudron d’eau bouillante sur le feu de la cuisinière. C’est aussi l’expérience immédiate vécue à l’audition des crissements de pneus d’une automobile qui me fera remonter sur le trottoir sans prendre le temps de réfléchir si jamais la même expérience immédiate se présente. Somme toute, l’expérience immédiate est à toutes fines pratiques essentiellement sensorielles.
Mais nos sens peuvent nous tromper. « J’étais certain que mon camion passait aisément sous ce viaduc », dira le conducteur. « Je n’ai pas vu la marche », dira le visiteur. « J’avais pas l’impression d’écouter cette musique à un volume aussi élevé », dira le colocataire. Ce sont là des exemples terre-à-terre mais nos sens peuvent aussi induire en erreur notre appréciation d’une personne, d’un événement de grande importance voire d’un objet dangereux.
J’ai ajouté « connue » et « vécue » après « expérience immédiate » car certaines expériences immédiates semblent échapper à notre mémoire, du moins, ne pas s’y inscrire dès la première fois. En effet, il nous faut parfois plusieurs expériences immédiates similaires, par exemple, de déshydratation avant de prendre l’habitude de boire suffisamment lors d’un effort physique soutenu. Certaines personnes oublient toujours de faire le plein du réservoir d’essence de leur automobile malgré l’expérience immédiate de plusieurs pannes sèches.
Bref, nos sens peuvent nous trahir et l’expérience immédiate est loin d’être toujours suffisante pour engendrer une pensée certaine. Autrement dit, une simple conscience ne fournit pas toute la connaissance et la compréhension nécessaire pour prendre du recul et maîtriser la certitude.
Il faut une double conscience, c’est-à-dire, une conscience de la conscience. Disons-le avec d’autres mots. La simple conscience est une conscience spontanée tandis que la double conscience est une conscience réfléchie. Le professeur L. Meynar 4 parle aussi de la conscience réfléchissante et de la conscience réfléchie. La première se limite au reflet de la réalité, la seconde se veut une réflexion au sujet de ce reflet. « (…), mais au fond la conscience et la conscience de la conscience sont deux opérations de l’esprit qui ne diffèrent que par le degré d’intériorisation et de réflexion », écrit le professeur.
Par intériorisation, entendons simplement l’« aptitude mentale à s’isoler du monde extérieur » (Le Petit Robert), ce qui implique, pour nous, la capacité à nous soustraire à l’influence de nos sens, ces derniers étant responsables de nous relier au monde extérieur. Autrement dit, une fois que nous avons acquis toute la connaissance possible avec nos sens au sujet de ce à quoi nous voulons réfléchir, on ferme la porte; on ne laisse plus les sens se mêler de nos affaires.
L’opération est difficile à celui ou celle qui se demande : « Oui. Mais ne ressent-on pas toujours quelque chose ? Comment soustraire complètement ma réflexion à mes sens ? ». Évidemment, il ne s’agit pas de « débrancher » les nerfs; nous mourrions. Blague à part, nos sens alimentent constamment notre cerveau et c’est très bien ainsi. Mais il ne faut pas être comme l’élève à la merci de tout ce qu’il voit et entend au point de perdre le fil de sa propre réflexion, ce qui fait référence à un premier aspect de l’intériorisation : la capacité de concentration dans l’ambiance du monde extérieur.
Le deuxième aspect se rapporte à la capacité de contrôler la connaissance par les sens, comme s’il fallait à un moment donné la fixer, décider qu’on a la connaissance de base nécessaire pour réfléchir. Autrement, on se retrouve à réfléchir à une connaissance qui change constamment parce que toujours alimentée par les sens. En fait, il s’agit de considérer que la conscience et la conscience de la conscience ne peuvent pas travailler en même temps. Comparez-vous au chercheur en laboratoire tentant de réfléchir à un virus tout en gardant les yeux rivés sur ce virus à l’aide de son microscope. L’exercice est toujours possible, l’image du virus peut stimuler l’imagination, mais le chercheur sait fort bien que son travail au microscope (le recours à ses sens) consiste à prendre des connaissances auxquelles il réfléchira plus tard, dans un deuxième temps, à son bureau, par exemple. Ce faisant, il intériorise la connaissance, il ne lui reste plus que des notes. Il amène la connaissance sensorielle de la simple conscience dans la double conscience. Par le fait même, il s’isole lui-même et isole la connaissance du monde. Le travail de la simple conscience est terminé et celui de la double conscience commence.
Personnellement, il me semble plus aisé de différencier la simple de la double conscience en les qualifiant de conscience spontanée et de conscience réfléchie. Pour en finir avec cette différenciation, comparons l’exercice de conscience à celui de la photographie. La conscience spontanée fournit la photographie et la conscience réfléchie l’analyse. L’objet photographié, c’est le monde extérieur. L’appareil photographique représente mes sens (en tant qu’il les prolonge, comme le fait un microscope). La photographie, c’est la connaissance produite par la conscience spontanée à l’aide de mes sens. Je dispose en mon esprit d’une représentation du monde extérieur. Je n’ai plus besoin de l’appareil ou de mes sens pour me représenter le monde extérieur puisque j’en ai une représentation indépendante en mon esprit. Je puis donc me couper du monde extérieur pour réfléchir à cette représentation.
Dans cet exercice, la photographie ou la représentation du monde extérieur en mon esprit est une première connaissance, la connaissance spontanée. Ma réflexion sera une connaissance réfléchie de la connaissance spontanée, une « connaissance de la connaissance » à l’image d’une « conscience de la conscience ».
Dans ce contexte, vous comprendrez peut-être mieux que jamais la réflexion : « Retour de la pensée sur elle-même en vue d’examiner plus à fond une idée, une situation, un problème » (Le Petit Robert). Ce retour de la pensée sur elle-même est nécessaire parce que la conscience spontanée peut m’induire en erreur, produire une pensée d’une fausse certitude :
« La conscience naïve ne connaît que des choses et s’ignore elle-même comme conscience. Par exemple, je dis spontanément : « Devant moi il y a une lampe, sous mes pieds il y a un tapis, sur le balcon il y a des fleurs ». Je ne pense pas d’abord à l’acte de mon esprit par lequel j’affirme tout cela; mais ma pensée s’oublie, s’efface devant les choses qu’elle affirme. (…). Elle affirme les choses, l’être, le « il y a ».
Cependant, je fais bien vite l’expérience de l’erreur. Par exemple, je me dis : « Il y a un moineau sur le balcon »; je m’approche et ce n’est qu’un petit papier gris. Donc il n’y avait pas de moineau, mais j’avais cru voir un moineau. J’avais cru… Ici ma pensée, d’abord tournée vers les choses, revient sur elle-même; je réfléchis sur ma connaissance, je me demande quelle est sa valeur. (…). » 5
Si la conscience naïve (spontanée) se limite à « affirmer », on comprend encore mieux pourquoi les débats d’opinions ont tout pour nous induire en erreur, contrairement à la discussion qui force la réflexion sur chaque affirmation.
Cela dit, l’exemple du moineau sur le balcon est une certitude banale sans trop de conséquences. Vous n’êtes sûrement pas sans penser à des exemples plus dramatiques où de fausses certitudes peuvent conduire à des erreurs fatales. « Je peux éprouver un sentiment très fort et très sincère de certitude et pourtant être dans l’erreur », soulignent messieurs Huiman et Vergez.6 La chose sur le balcon apparaissait « de toute évidence » comme un moineau et j’accorde sur-le-champ le statut de vérité à cette évidence; j’affirme « Il y a un moineau sur le balcon ». Je ne me dis pas : « Il y a peut-être un oiseau sur le balcon » car, pour moi, il n’y a pas de doute que je vois un oiseau.
L’erreur commune de la conscience spontanée est de prendre les évidences comme des vérités sans en douter. La conscience spontanée nous donne souvent un sentiment d’évidence, une impression d’évidence. Les mots « sentiment » et « impression » sont justes parce que la conscience spontanée est directement en relation avec les sens dont l’activité débouche précisément sur des sentiments et des impressions. Or, un simple sentiment ou une simple impression ne suffit pas pour fonder une pensée certaine. Bref, il faut se méfier de toutes les évidences, en douter systématiquement, comme nous le recommande Descartes.
Plus une personne est sensible à ses sentiments et à ses impressions, plus elle devrait se méfier des évidences qui lui viennent à l’esprit. Et c’est justement parce que nous sommes tous sujets à une telle sensibilité que nous devrions tous douter systématiquement des évidences. Même lorsque nous nous vantons d’avoir réfléchi, il arrive que notre réflexion ait été induite en erreur par notre première impression, généralement la plus influente de toutes. En fait, notre réflexion consiste souvent à expliquer et à justifier notre première impression parce que nous la prenons pour vraie, du début à la fin. Or, pour découvrir si une première impression est vraie, il faut en douter. Seul un doute systématique peut produire la certitude et confirme si la première impression est vraie ou fausse. On peut être certain d’une première impression que si plus aucun doute ne persiste en notre esprit, non pas en rejetant le doute pour uniquement en justifier l’évidence.
Pour déceler si une personne n’a pas été bernée par sa première impression dans sa réflexion, il faudrait la forcer à nous exposer tous les doutes qu’elle a levés pour en arriver à être certaine. J’imagine la surprise de cette personne à la question : « Avez-vous eu des doutes ? ». Une réponse du genre « Je suis comme tout le monde, j’ai eu des doutes mais maintenant je suis certain », ne serait que de la poudre aux yeux. Il ne fut pas demandé si la personne doutait comme tout le monde mais si elle, elle avait eu des doutes. Il nous faudrait insister : « Quels ont été vos doutes ? ». Une réponse du genre « Je ne suis pas ici pour faire état de mes doutes mais pour partager ce que je sais » démontrerait définitivement que la personne est uniquement capable d’une conscience de la conscience, d’une réflexion, dont le seul but est d’imposer ses évidences, à elle-même et aux autres. Elle ne peut que nous montrer jusqu’à quel point elle a le sentiment d’être certaine de posséder la vérité. C’est comme si elle nous lançait : « Ne doutez plus, j’arrive ! » ou « Me voilà, il n’y a plus de raison de douter ». En fait, cette personne nous dit : « Je connais la vérité et j’ai la certitude de la connaître ». Or, sa fuite devant le doute prouve tout à fait le contraire. Car qui n’a pas douté, connaît mais il ne peut pas en être certain.
Descartes écrit : « L’acte par lequel on connaît une chose est différent de celui par lequel on connaît qu’on la croit ». Je connais avec ma conscience spontanée, je connais que j’y crois avec ma conscience réfléchie ou, si vous préférez, je sais, avec ma conscience spontanée, je sais que je peux y croire ou non avec ma conscience réfléchie.
Le doute systématique enseigné par Descartes deviendra la première règle de la méthode scientifique. Toute la certitude accumulée en science fut et est possible grâce à l’application, à l’exercice, du doute systématique. La première caractéristique de l’esprit scientifique est de douter systématiquement.
C’est à partir du moment où l’homme s’est mis à douter systématiquement de ses connaissances qu’il a pu qualifier ses connaissances d’exactes et d’approfondies et les réunir dans différents « corps de connaissances ayant chacun un objet déterminé et reconnu, et une méthode propre » ou, différents « ensembles de connaissances, d’études d’une valeur universelle, caractérisés chacun par un objet (domaine) et une méthode déterminés, et fondés sur des relations objectives fiables » (Le Petit Robert). Il s’agit là de la définition d’une science, des sciences. Pour le moment, retenons uniquement (nous verrons les autres aspects plus tard) que la référence à la méthode est obligée pour définir une science et que cette méthode peut varier d’une science à l’autre mais toutes ont en commun la pratique du doute systématique.
On peut donc mettre un peu de science dans sa pensée, profiter de la certitude scientifique dans sa vie, en nous prêtant au doute systématique. Et cela n’est pas aussi compliqué qu’il y paraît. Ne vous imaginez pas bloqué par le doute systématique chaque fois que vous cherchez à connaître, que vous pensez à quelque chose et chaque fois que vous vivez quelque chose, la tête en train d’exploser, dans la position du penseur de Rodin. Même le scientifique qui a fait profession de douter systématiquement des connaissances dans un domaine ou sur un objet déterminé ne s’imagine pas chercher et penser ses doutes jusqu’à la surchauffe de son cerveau au point d’en brûler des neurones et en devenir fou. Le doute systématique n’est pas paralysant, à preuve, les sciences avancent sans cesse depuis qu’elles le pratiquent. Lorsqu’un problème demeure incompréhensible et irrésolu, c’est que le doute systématique n’a pas encore produit une pensée suffisamment certaine pour comprendre et résoudre le problème.
Mais il n’est pas nécessaire de faire du doute systématique une profession pour en tirer le bénéfice d’une pensée certaine profitable à tout un chacun. Le scientifique passera des années sur les bancs d’école qu’il ne quittera pas vraiment puisqu’il est en formation toute sa vie. Il choisit un objet d’étude déterminé et passera en revue tous les doutes levés par ses prédécesseurs dans son domaine. Il se mettra au parfum des doutes et des problèmes actuels et il commencera sa recherche. Nous ne disposons pas d’autant de temps pour étudier chacun de nos problèmes. Impossible d’imaginer nous concentrer sur un seul problème toute notre vie.
En revanche, nous pouvons former quelque peu notre esprit à la pensée scientifique. Nous pouvons importer de la science les principales règles de sa méthode d’être certaine. Bien comprises, ces règles deviennent quasiment une seconde nature, si je puis dire. L’effort nous paraîtra naturel, ne serait-ce que l’effort du doute, la règle suprême. Il faut bien peser les mots « seconde nature » et « effort naturel » car, en fait, l’esprit scientifique va à l’encontre de notre nature qui, nous l’avons souligné, nous pousse à prendre pour vraie la moindre évidence. Ne pas prendre pour vrai ce que nous pensons n’est pas dans notre nature et c’est ce en quoi consiste principalement l’esprit scientifique.
J’aime bien la définition de la science donnée par l’historien philosophe des sciences et professeur de chimie et de physique, Gaston Bachelard, dont le livre La Formation de l’esprit scientifique7 fait autorité en la matière. « Il définit la science comme un combat, un refus de ses propres opinions »8, pour moi, un refus de ce qu’on prend d’emblée pour vrai, puisqu’une opinion est par définition prise pour vraie.
Aussi, la réflexion sur la connaissance proposée par Descartes est d’ordre critique plutôt que dogmatique, fondée sur un doute systématique plutôt que sur un dogme, sur des « vérités fondamentales incontestables » ou des « opinions émises comme des certitudes » (Le Petit Robert), comme on en trouve plusieurs au sein de l’église.
On peut qualifier une réflexion de critique que si elle met en doute systématiquement les connaissances acquises. Pas de doute, pas de qualité critique, pas de certitude, uniquement des dogmes. C’est la qualité critique de la démarche de mes professeurs lors de ma troisième session en sciences humaines au collège que j’ai remise en cause en demandant pourquoi leurs sources disaient sensiblement toutes la même chose sur les sujets à l’étude. « Cet auteur affirme le contraire de l’auteur que vous avez choisi. Que fait-on avec son point de vue? » demandais-je à répétition sans obtenir de réponses intelligentes pour me convaincre de poursuivre plus loin mes études avec eux.
Selon le professeur et sociologue des sciences Olivier Clain, non seulement le premier geste de la démarche critique est une mise en doute des connaissances acquises, mais la connaissance elle-même apparaît dès lors comme une réflexion critique, c’est-à-dire, comme « une démarche qui rend possible une avancée continuelle du savoir par destruction du déjà su, des évidences déjà accumulées ».9
Le professeur Nicolle formule en ces mots la démarche : « La connaissance est une lutte à la fois contre la nature et contre soi-même. On connaît contre une connaissance antérieure. La connaissance n’est pas une simple acquisition; elle est une remise en question de ce que l’on croyait savoir et qu’on savait mal ».10
N’y a-t-il pas là un nouvel élément ? Qu’est-ce que vous inspire : « par destruction du déjà su » et « contre une connaissance antérieure » ? La réponse doit préciser qu’est-ce qui peut détruire le déjà su. Seul un doute au sujet d’une connaissance déjà établie (pour vrai) peut détrôner cette dernière. Si je ne doute pas de la connaissance établie, il n’est aucune raison de croire que je sais mal. Si je doute d’une connaissance établie, mon doute détruit cette connaissance et c’est sur ces ruines que s’installera une nouvelle connaissance, plus certaine, jusqu’à ce qu’un doute vienne la détruire à son tour, pour une connaissance encore plus certaine. Lorsque je crois en une connaissance, j’accepte l’éventualité de devoir l’abandonner si un doute survient. Le bénéfice du doute, c’est la certitude… jusqu’au prochain doute !
Mais notre habitude de prendre pour vraies les évidences se pose comme un obstacle au doute assurant le développement de la connaissance. Gaston Bachelard introduit la notion d’« obstacles épistémologiques », de épistémè, savoir.
« La nouveauté de sa réflexion tient à la découverte des obstacles épistémologiques. Ce ne sont pas des obstacles extérieurs, comme la difficulté d’observer les phénomènes, de les mesurer, d’expérimenter sur eux; ni des obstacles techniques liées à la mise au point d’instruments au service de la science; ce sont des phénomènes internes à l’esprit même du chercheur. G. Bachelard a emprunté à la psychanalyse le concept de résistance. Une résistance est tout ce qui, dans les actions et les paroles d’un patient, s’oppose à l’exploration, par celui-ci, de son inconscient (ex. : fatigue, oublis, refus d’une interprétation, impatience, etc.)
L’obstacle épistémologique est une résistance au développement de la connaissance, interne à l’acte de connaître. C’est dans l’esprit du chercheur, dans sa démarche intellectuelle elle-même que l’on trouve des barrières, des obstacles au progrès de la connaissance. Ces obstacles sont bien entendu involontaires. »11
Laissons à Gaston Bachelard le soin de replacer nos dires dans la version originale de son texte :
« Quand on recherche les conditions psychologiques des progrès de la science, on arrive bientôt à cette conviction que c’est en termes d’obstacles qu’il faut poser le problème de la connaissance scientifique. Et il ne s’agit pas de considérer des obstacles externes comme la complexité et la fugacité des phénomènes, ni d’incriminer la faiblesse des sens et de l’esprit humain : c’est dans l’acte même de connaître, intimement, qu’apparaissent, par une sorte de nécessité fonctionnelle, des lenteurs et des troubles. C’est là que nous montrerons des causes de stagnation et même de régression, c’est là que nous décèlerons des causes d’inertie que nous appellerons des obstacles épistémologiques. La connaissance du réel est une lumière qui projette toujours quelque part des ombres. Elle n’est jamais immédiate et pleine. Les révélations du réel sont toujours récurrentes. Le réel n’est jamais « ce qu’on pourrait croire », mais il est toujours ce qu’on aurait dû penser. La pensée empirique est claire, après coup, quand l’appareil des raisons a été mis au point. En revenant sur un passé d’erreurs, on trouve la vérité en un véritable repentir intellectuel. En fait, on connaît contre une connaissance antérieure, en détruisant des connaissances mal faites, en surmontant ce qui, dans l’esprit même, fait obstacle à la spiritualisation.
L’idée de partir de zéro pour fonder et accroître son bien ne peut venir que dans des cultures de simple juxtaposition où un fait connu est immédiatement une richesse. Mais devant le mystère du réel, l’âme ne peut se faire, par décret, ingénue. Il est alors impossible de faire d’un seul coup table rase des connaissances usuelles. Face au réel, ce qu’on croit savoir clairement offusque ce qu’on devrait savoir. Quand il se présente à la culture scientifique, l’esprit n’est jamais jeune. Il est même très vieux, car il a l’âge de ses préjugés. Accéder à la science, c’est, spirituellement rajeunir, c’est accepter une mutation brusque que doit contredire un passé.
La science, dans son besoin d’achèvement comme dans son principe, s’oppose absolument à l’opinion. S’il lui arrive, sur un point particulier, de légitimer l’opinion, c’est pour d’autres raisons que celles qui fondent l’opinion; de sorte que l’opinion a, en droit, toujours tort. L’opinion pense mal; elle ne pense pas : elle traduit des besoins en connaissances. En désignant les objets par leur utilité, elle s’interdit de les connaître. On ne peut rien fonder sur l’opinion : il faut d’abord la détruire. Elle est le premier obstacle à surmonter. Il ne suffirait pas, par exemple, de la rectifier sur des points particuliers, en maintenant, comme une sorte de morale provisoire, une connaissance vulgaire provisoire. L’esprit scientifique nous interdit d’avoir une opinion sur des questions que nous ne comprenons pas, sur des questions que nous ne savons pas formuler clairement. Avant tout, il faut savoir poser des problèmes. Et quoi qu’on dise, dans la vie scientifique, les problèmes ne se posent pas d’eux-mêmes. C’est précisément ce sens du problème qui donne la marque du véritable esprit scientifique. Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une question. S’il n’y a pas eu de question, il ne peut y avoir de connaissance scientifique. Rien ne va de soi. Rien n’est donné. Tout est construit.
Une connaissance acquise par un effort scientifique peut elle-même décliner. La question abstraite et franche s’use : la réponse concrète reste. Dès lors, l’activité spirituelle s’invertit et se bloque. Un obstacle épistémologique s’incruste sur la connaissance non questionnée. Des habitudes intellectuelles qui furent utiles et saines peuvent, à la longue, entraver la recherche. « Notre esprit, dit justement M. Bergson, a une irrésistible tendance à considérer comme plus claire l’idée qui lui sert le plus souvent ». L’idée gagne ainsi une clarté intrinsèque abusive. À l’usage, les idées se valorisent indûment. Une valeur en soi s’oppose à la circulation des valeurs. C’est un facteur d’inertie pour l’esprit. Parfois une idée dominante polarise un esprit dans sa totalité. Un épistémologue irrévérencieux disait, il y a quelque vingt ans, que les grands hommes sont utiles à la science dans la première moitié de leur vie, nuisibles dans la seconde moitié. L’instinct formatif est si persistant chez certains hommes de pensée qu’on ne doit pas s’alarmer de cette boutade. Mais enfin l’instinct formatif finit par céder devant l’instinct conservatif. Il vient un temps où l’esprit aime mieux ce qui confirme son savoir que ce qui le contredit, où il aime mieux les réponses que les questions. Alors l’instinct conservatif domine, la croissance spirituelle s’arrête. » 12
Gaston Bachelard nous propose ces quatre exercices disciplinaires pour conduire notre intelligence avec rigueur13 :
1. La catharsis intellectuelle : toute culture scientifique doit commencer (…) par une catharsis intellectuelle et affective, c’est-à-dire par une véritable purification des préjugés, des idées toutes faites, des opinions admises. C’est une condition préalable pour qui veut vraiment entreprendre une recherche intellectuelle. Bachelard reprend ici la tradition philosophique, qui, depuis Socrate en passant par Descartes, exige la rupture avec la doxa (l’opinion) pour penser librement par soi-même.
2. La réforme de l’esprit : il faut éduquer convenablement son esprit, c’est-à-dire non pas le remplir de connaissances jusqu’à saturation, mais le former avec méthode. Plus précisément, il faut apprendre à son esprit à se réformer sans cesse, à ne jamais s’installer dans des habitudes intellectuelles qui deviennent vite des carcans; il doit être capable de renoncer à une théorie à laquelle il était attaché, il doit être capable de refondre totalement le système de son savoir chaque fois que c’est nécessaire. Il faut avoir un esprit souple
3. Le refus de l’argument d’autorité : comme nous l’ont appris les savants de la Renaissance, il faut savoir rompre avec le respect pour les autorités intellectuelles, quel que soit leur prestige. Un épistémologue irrévérencieux disait, il y a quelque vingt ans, que les grands hommes sont utiles à la science dans la première moitié de leur vie, nuisibles dans la seconde moitié. Effectivement, dès qu’un chercheur devient célèbre, il acquiert une autorité intellectuelle et morale qui peut gêner ses étudiants. Pour progresser, ceux-ci doivent souvent rompre avec les idées de leur maître, ce qui n’est pas toujours facile lorsque celui-ci détient le pouvoir d’orienter les travaux de recherche, les thèses, les carrières, etc. À ceux qui veulent apprendre, c’est souvent une gêne que l’autorité de ceux qui leur donnent leur enseignement, écrivait Cicéron.14
4. L’inquiétude de la raison : il ne faut jamais laisser sa raison en repos (quies); il faut l’inquiéter, la déranger. Il ne faut pas s’installer dans la sympathie avec une doctrine. La sympathie enlève l’esprit critique, la liberté de jugement. Il ne faut jamais se sentir à l’aise avec ses propres idées, il faut se remettre toujours en question. Celui qui ne s’interroge plus se sclérose. L’esprit qui finit toujours par dire oui s’endort. Penser, c’est dire non, pensait Alain. »15
Ces exercices prolongent fort bien notre propos. Il faudrait nous les enseigner dès notre plus jeune âge pour plus de rigueur dans l’ensemble des réflexions de tous les gens.
Pour le moment, les critères de vérité diffèrent tellement d’un individu à l’autre que le développement de la connaissance s’en trouve réduit, autant dans nos vies personnelles que publiques. Il y a prolifération de connaissances sans pour autant qu’elles soient certaines car on peut justement douter des critères de vérité retenus. Bref, il y a une multitude de raisons de croire de certitude très inégale.
« Lorsque quiconque avance une affirmation qu’il prétend être une vérité, lorsqu’il veut la faire reconnaître et partager comme telle (comme une vérité), on est toujours en droit de lui demander « pourquoi devrais-je vous croire? ». Selon les domaines et les circonstances, les réponses peuvent être très diverses : on peut invoquer l’expérience quotidienne, la pratique, un témoignage, l’autorité de quelqu’un de reconnu comme compétent, la tradition, une révélation, l’intime conviction, l’intuition, le raisonnement, le sentiment d’évidence, et encore bien d’autres raisons de croire. »16
La science procède autrement :
« Les affirmations scientifiques, elles, devraient en principe appuyer leur validité sur des arguments à la fois empiriques, rationnels, et publics. À la question ci-dessus, le scientifique devrait pouvoir répondre : « voilà l’expérience ou l’observation que j’ai réalisée et les raisonnements que j’ai faits pour en tirer mes conclusions. Vous pouvez les refaire, je vous donne toutes les indications nécessaires pour cela, vous verrez que vous aboutirez au même point que moi ». »17
Quelle différence remarquez-vous? Lorsqu’un scientifique avance une affirmation qu’il prétend être vraie, il doit la soumettre à l’approbation publique. Dans notre vie privée, nous nous contentons souvent de nous approuver nous-mêmes. Nous jugeons nous-mêmes si nous pouvons être certains ou non, par conséquent, notre capacité à reconnaître nos erreurs est réduite uniquement à notre propre expérience.
Le scientifique ne saurait se contenter d’une preuve personnelle, il la soumettra aux d’autres :
« Une preuve scientifique doit pouvoir s’imposer à toute personne suffisamment informée; obtenir le consensus est donc une visée de tout effort de recherche. La connaissance scientifique est, par sa nature même, partageable. (Un chimiste anglais, Ziman (1968), a forgé pour cela l’adjectif ‘ consensible ’, c’est-à-dire susceptible d’être l’objet d’un consensus, pour exprimer la même idée ».18
Les mots-clés : « à toute personne suffisamment informée ». La personne qui nous propose une vérité est-elle suffisamment informée ? Et nous, sommes-nous suffisamment informés pour juger cette vérité vraie ou fausse ? La plupart du temps, non seulement nous ne prenons pas le temps de vérifier les informations disponibles, nous n’avons pas le temps. Plus encore, la surabondance d’informations nous démotive. Même lorsqu’on se donne quelque peu la peine de fouiller un sujet, de consulter différentes sources d’informations, on a l’impression de piger au hasard.
Il faut que les informations soient loin, en dehors de la science, de former un ensemble de connaissances ordonnées, faciles à consulter. La pagaille voire l’anarchie caractérise l’autoroute de l’information et on trouve difficilement ce que l’on cherche. Or, le fouillis sur l’autoroute de l’information est à l’image de l’esprit de l’homme. L’informatique est une science, le contenu véhiculé est loin d’être soumis à la même organisation de pensée, une grave erreur qui nous laisse dans l’erreur. Si l’autoroute de l’information avait été conçue comme une gigantesque encyclopédie, le problème serait réglé mais cela ne se produira pas car les penseurs des moteurs de recherche manquent eux-mêmes de conscience de la conscience. Pressés de passer à l’action avec les évidences du bord, ils ne doutent pas suffisamment voire correctement, bref, ils manquent de réflexions.
Dans ce contexte de fouillis général, débordant amplement l’autoroute de l’information, nous ne pouvons avoir qu’une seule qualité : rester ouverts à l’idée de douter de nos pensées certaines si jamais nous en croisons une autre qui n’y corresponde pas, en tout ou en partie. N’est-ce pas la moindre des choses au lieu de rejeter instantanément toutes connaissances contredisant nos pensées certaines ?
Parler avec certitude m’apparaît prétentieux et arrogant, très peu raisonnable. Ajoutez à cela l’assurance et la confiance en soi avec lesquelles les gens renforcent l’impression de dire la vérité et vous pouvez conclure que la plupart des gens exagèrent. Il suffit d’y prêter attention lors des réunions de famille, des séances de travail au bureau, des pauses-café, des activités de loisirs, des déplacements en public, de l’épicerie au centre commercial en passant par la station-service et le cinéma, bref, partout où l’autre parle avec un autre, pour se rendre compte que les gens donnent force de vérité à ce qu’ils disent et pensent, sans entretenir le moindre doute.
J’ai commencé bien jeune à me rendre compte que je ne pouvais pas me fier aux pensées les plus certaines des gens. Même les journalistes sont trompés par l’évidence. Je ne sais plus combien d’informations de toutes sortes sur les sujets les plus variés j’ai vérifiées jusqu’à la source pour m’apercevoir que les médias m’avaient induit en erreur, faute d’avoir eux-mêmes vérifié.
À titre d’exemple, à la sortie dans les médias de l’affaire des messages subliminaux dans la musique rock, piqué au vif, j’ai entrepris une vaste vérification de l’information pour satisfaire un doute systématique. Le sujet était traité par les médias avec tellement d’erreurs que je n’ai pu faire autrement que d’intituler ma première tournée de conférences dans les écoles élémentaires, secondaires et collégiales et les maisons de jeunes du Québec, de l’Ontario et des provinces maritimes : « Le rock et la déformation de l’information ». Il me fallait un minimum de deux heures et demie par conférence pour expliquer les erreurs relevées dans cinq articles publiés par différents quotidiens parmi les plus prestigieux au Canada. Et gare aux directeurs et aux animateurs qui voulaient couper court à la conférence car les jeunes, tout comme les parents rencontrés en soirée, voulaient savoir, tout savoir; la vérité ne court pas les rues et je l’avais trouvée pour la partager.
Pire encore, l’ignorance d’un seul homme peut priver tout un peuple d’une meilleure connaissance. À titre d’exemple, j’ai vu de mes yeux vu le dossier de l’éducation aux médias foirer lamentablement au Québec dans la première moitié des années 80 alors que je revenais de la France avec toutes les informations originales du projet initié par l’U.N.E.S.C.O., expérimenté pour la première fois en plusieurs pays sous l’égide du Conseil de l’Europe parmi lesquels la France était le plus avancé. J’avais en main non seulement les informations pédagogiques nécessaires à l’implantation du projet au Québec mais même les notes ministérielles confidentielles expliquant comment promouvoir le projet en hauts lieux. Je ne parle pas ici d’une valise de documents mais de plus d’une dizaine de caisses bourrées des informations les plus précieuses étalant un savoir de grande valeur. Dès mon arrivée, je me suis mis à la recherche d’informations du côté américain pour être en mesure de comparer la vision européenne avec la vision américaine. J’ai procédé de même avec le Québec et les autres provinces canadiennes, plus pauvres que jamais sur le sujet.
Avec une équipe, qui a compté au plus fort une quinzaine de personnes, nous avons expérimenté sur le terrain pendant cinq ans, ajustant ici et là le projet aux réalités québécoises, et de façon à avoir en main une version parfaitement adaptée avant de nous rendre en commission parlementaire lors de l’étude des crédits du ministère des communications du Québec pour demander de l’aide en vue de généraliser le projet dans les écoles, les maisons de jeunes et les services de loisirs. Déjà, nous avions fait la une de plusieurs médias et été l’objet de nombreux reportages, même l’Office National du Film du Canada avait produit un documentaire sur nos ateliers dans les écoles primaires.
Mais il ne fallut même pas une minute à un politicien de l’opposition, parfait ignorant du sujet, pour faire de notre cause un dossier partisan et ainsi inciter le ministre à ignorer notre demande. Il a laissé croire que le but de l’éducation aux médias était de critiquer les médias alors qu’en réalité, il s’agit de développer le sens critique. Mais pour lui, on ne pouvait pas développer le sens critique autrement qu’en faisant des critiques engagées. On devient critique des médias en apprenant « comment ça marche » par une expérimentation pratique des médias et en cernant l’influence des médias dans nos vies. Ainsi et seulement ainsi, on peut prétendre à des critiques objectives et être en mesure d’expliquer pourquoi on aime et pourquoi on n’aime pas. Nous avons poursuivi nos expériences sur le terrain, ajoutant même une véritable escouade pour répondre aux demandes de directeurs d’écoles aux prises avec la violence, celle dans les médias étant devenue un Cheval de Troie pour aborder la question. Au bout de quelques années, nous avons dû abandonner, faute de subventions gouvernementales pour compléter le financement privé. Ailleurs, l’éducation aux médias est toujours plus évoluée qu’au Québec et largement subventionnée par le privé et le public.
Frustré ? Comment ne pas l’être lorsque l’absence d’un doute raisonnable cause autant de ravage dans tous les milieux de la société. Qu’importe la région du monde où vous habitez, vous observerez de multiples décisions prises sous la seule connaissance des évidences plutôt qu’une juste compréhension de cette connaissance brute. Une conscience respectueuse d’elle-même se compose de la connaissance et de la compréhension tirées de la connaissance par la réflexion. La connaissance seule ne suffit jamais à l’être humain conscient de lui-même. Aussi, l’être humain conscient fait preuve d’humilité dans l’énoncé de ses certitudes car il sait fort bien qu’il ne dispose pas généralement de toutes les connaissances nécessaires pour réfléchir sur un sujet au point et produire une réflexion à toute épreuve. L’être humain responsable demeure continuellement à la recherche de nouvelles connaissances, particulièrement celles pouvant mettre en doute ce qu’il sait et croit savoir.
Nous terminerons notre chapitre sur la pensée certaine en traitant du « bon sens », ce qui me permettra de tenir ma promesse de vous présenter les opérations de pensées telles qu’expliquées par le professeur Clain :
« Il y a trois moments dans toute connaissance du monde :
1. Moment dans lequel je fais l’expérience de l’objet avec ses qualités propres et ses déterminations empiriques.
2. Moment de la construction des concepts, des catégories que j’utilise pour décrire les qualités de l’objet.
3. Moment, en constante relation avec les deux autres et qui sert de médiation dans le rapport entre les deux autres, et qui est le moment de la formulation des énoncés à caractère théorique. »
Quand je dis « La table est jaune et rectangulaire », j’affirme une connaissance dans laquelle ces trois moments sont présents. D’abord, l’expérience de l’objet, c’est le moment où s’effectue le premier contact avec l’objet, un contact sensoriel; je vois, je sens, je touche, j’entends et/ou je goûte l’objet. Lors de ce moment l’objet agit sur mes sens, il les stimule. Chaque sens stimulé produit alors une sensation (tactile, oculaire, auditive, etc.) qui sera acheminée au cerveau sous la forme d’un influx nerveux par les nerfs. La connaissance de l’objet se limite alors à un message sensoriel en route vers le cerveau. Ce message comprend alors toutes les données nécessaires pour me représenter mentalement l’objet, en avoir une « photographie » (sensorielle), c’est-à-dire une perception.
Le message arrive au thalamus, centre de réception et de traduction des messages sensoriels en langage du cerveau. En fait, le thalamus code l’influx nerveux pour qu’il puisse circuler dans les circuits formés par les neurones, les circuits neuronaux, différents des nerfs utilisés par les sens. Le thalamus produira le message en deux copies, l’une pour le cerveau pensant (conscient) et l’autre pour le cerveau émotionnel (inconscient). On sait depuis peu que le cerveau émotionnel, centre de la perception, reçoit sa copie du message bien avant le cerveau pensant. Le fait s’explique simplement par la longueur du circuit neuronal, celui entre le thalamus et le cerveau émotionnel est plus court que celui entre le thalamus et le cerveau pensant. Ainsi, le cerveau émotionnel a souvent pris connaissance du message et agit en conséquence avant même que le cerveau pensant ait enregistré l’arrivée de sa copie du message.
Je passe alors au deuxième moment de la connaissance, le développement de la photographie, si je puis dire. Les différents concepts dont j’ai déjà l’expérience en mémoire m’y aideront. Par exemple, j’ai déjà l’expérience du concept des formes et des différentes catégories de formes, je puis donc identifier la forme de l’objet en la classant dans la catégorie des formes rectangulaires. J’ai aussi l’expérience de la catégorie de formes que j’appelle « pattes », je puis voir que la forme rectangulaire repose sur des pattes. J’ai l’expérience du concept des nombres, je puis compter quatre pattes. J’ai l’expérience du concept des couleurs, je puis identifier la couleur de l’objet comme faisant partie de la catégorie de couleurs jaune. La représentation mentale ou le développement de la photographie est complété.
Il me faut maintenant que je m’exprime cette représentation mentale en la formulant, par exemple, avec des mots : « la table est jaune et rectangulaire ». Si jamais je n’avais pas eu l’expérience de la forme spécifique de l’objet, ma formulation ressemblerait à ceci : « La table est jaune et d’une forme que je n’avais jamais vue auparavant ». D’une couleur inconnue, j’aurais affirmé : « La table est rectangulaire et d’une « drôle de couleur » ». Cette formulation exige que je me réfère constamment aux deux premiers de la connaissance, à mon expérience sensorielle de l’objet et aux qualités que je peux attribuer à l’objet.
Le cerveau émotionnel disposera ainsi d’une identification précise de ce que mes sens ont perçu et toute l’opération lui aura demandé quelques millisecondes. Il communiquera au cerveau pensant l’identification de l’objet mais une fois de plus, avant même que celui-ci ait pu en prendre conscience et commencé sa réflexion, s’il y a lieu, le cerveau émotionnel nous aura commandé l’attitude et le comportement à adopter face à cette table jaune et rectangulaire. Par exemple, mon cerveau émotionnel relèvera toutes mes références à la couleur jaune. Ces références sont classées dans notre schéma de référence, dossier sur la couleur, une sorte d’échelle de valeurs où les couleurs sont classées selon les émotions, agréables et désagréables, qu’elle suscite en moi. Si le jaune est classé comme une couleur désagréable parce que trop voyante pour un meuble, le cerveau émotionnel commandera une attitude rébarbative pouvant aller jusqu’au dédain. Ici encore, le cerveau émotionnel informera le cerveau pensant de son opinion et je pourrais en prendre conscience et y réfléchir.
C’est que nous sommes généralement inconscients du travail effectué par le cerveau émotionnel qui, par expérience, juge qu’il n’y a jamais de temps à perdre pour adopter une attitude précise face aux objets, aux personnes, aux situations, question de toujours être en mesure d’assurer notre sécurité. Vous vous souvenez de ces crissements de pneus d’automobile qui m’ont fait remonter sur le trottoir sans prendre le temps de réfléchir. Le cerveau émotionnel est en constante alerte et, pour lui, il n’y a aucun objet, personne et situation anodines.
Peut-être comprendrez-vous encore mieux en apprenant que les études de l’évolution du cerveau de l’homme démontrent que le cerveau émotionnel est le premier à s’être développé. Le cerveau pensant est venu plus tard et s’est développé, non pas indépendamment du cerveau émotionnel, mais plutôt en l’entourant, en y plongeant ses racines, si je puis dire, d’où les multiples connexions entre les deux cerveaux. Plusieurs spécialistes en neurosciences déduisent de ce fait une explication logique de la domination du cerveau émotionnel sur le cerveau pensant, des émotions sur l’intelligence.
Cette domination fut longtemps analysée par la science comme un défaut auquel remédier en prenant le contrôle de nos émotions. Aujourd’hui, la science reconnaît là une erreur car elle doit conclure que la raison n’est pas fonctionnelle sans les émotions. En effet, des patients privés de leurs émotions à la suite de lésions au cerveau émotionnel, n’arrivent plus à user de leur raison, même pas pour décider l’heure d’un prochain rendez-vous avec le médecin. La raison a besoin des émotions, d’où l’idée que le cerveau pensant est loin d’avoir le monopole de l’intelligence humaine. Il faut désormais parler de l’intelligence raisonnée et de l’intelligence émotionnelle, la première ne pouvant pas être exploitée sans la seconde. La lecture de l’ouvrage L’intelligence émotionnelle de Daniel Goleman vous est recommandée, un ouvrage auquel nous reviendrons.
Revenons aux moments présents dans toute connaissance. « Dans la vie de tous les jours, ces trois moments ne se distinguent pas clairement à ma conscience », ajoute le professeur Clain. Je les traverse inconsciemment et je me rends rapidement à l’évidence de mon constat d’observation. Nous avons déjà souligné qu’une telle connaissance, somme toute uniquement perceptive, peut nous induire en erreur.
Le professeur poursuit : « Ce n’est que dans la connaissance scientifique que ces moments vont se séparer clairement, qu’ils vont être posés comme différents par la conscience, s’autonomiser les uns des autres de manière claire et qu’ils vont se constituer en moment de connaissance scientifique ». Bref, la pensée scientifique s’arrête à chaque moment pour les contrôler, comme le recommandait Descartes (maîtrise des opérations de penser). L’expérience de l’objet sera minutieusement préparée, organisée et contrôlée, c’est-à-dire, systématique. Il en sera de même de la construction des concepts, généralement soumis au consensus des confrères, avant de les adopter et les utiliser pour décrire l’objet. Pareil effort sera déployé le temps venu de la formulation des énoncés à caractère théorique. On peut aisément comprendre que la différenciation des moments présents dans la connaissance et leur contrôle serré permettent à la science de produire des connaissances plus certaines que l’homme de la rue qui n’a aucune conscience de ces moments et se rend à l’évidence sans trop la questionner, du moins dans la vie quotidienne.
Car l’homme de la rue, vous et moi, peut réfléchir aux évidences s’il s’y arrête en s’isolant de son train-train quotidien. Cependant, comparée à la connaissance qualifiable de scientifique, la nôtre sera nommée « connaissance du sens commun » (le sens communément donné par l’homme à ses connaissances), reliée au bon sens dont nous parlions.
Dans la connaissance du sens commun, je connais des lois et, dans la connaissance scientifique, j’explique les lois. À titre d’exemple, la loi de la succession et celle de l’ordination des saisons (hiver, printemps, été, automne) est une connaissance du sens commun. L’explication de la succession des saisons et l’ordre dans lequel elles défilent relèvent de la connaissance scientifique.
Il est important de comprendre ce qu’est une loi, ce que nous faisons en expliquant que « la connaissance se distingue selon le type d’objets connu. Selon le professeur Clain, il y a trois types d’objets, chacun permettant un degré de connaissance différent.
Premièrement, il y a la connaissance intuitive qui me donne une certitude sensible, relative à ce que mes sens me laissent percevoir. Cette connaissance a pour objet le simple fait d’être d’une chose en face de moi. Par cette connaissance, je reconnais l’existence des choses. C’est le « Il y a ». C’est la connaissance d’un acte d’être, la forme la plus simple de la connaissance.
Deuxièmement, il y a la connaissance de l’imagination ou de la perception. C’est « lorsque je connais un objet et que je lui attribue des qualités ». J’acquiers une connaissance de l’objet en relation avec ses qualités. Ici, non seulement j’ai la connaissance de l’existence de l’objet devant moi, par exemple, en tant que table, mais j’ai aussi la connaissance de ses qualités, jaune et rectangulaire.
Troisièmement, il y la connaissance de l’entendement, c’est-à-dire, la connaissance de la relation elle-même entre les qualités d’un objet ou entre des objets. Dans la connaissance de l’entendement, je porte plus spécifiquement attention à la constance, à la stabilité de la relation. Par exemple, je peux relier la qualité rectangulaire et la qualité jaune pour voir s’il y a une relation constante en me demandant si toutes les tables rectangulaires sont jaunes? Parfois oui, parfois non, devrais-je admettre. Il n’y a donc pas de relation constante entre les deux qualités, si ce n’est qu’aléatoire. En revanche, année après année, je peux voir une relation constante dans l’ordre dans le nombre de saisons et leur ordre. Il y a là de quoi déduire une loi du nombre de saisons et une loi de leur ordre. « Lorsque je connais grâce à l’entendement, je connais une loi », « je connais de loi », explique le professeur.
Dans ce dernier cas, on parlera de « l’entendement naturel », pour distinguer « l’entendement scientifique ». Dans l’entendement naturel, je connais de loi, dans l’entendement scientifique, je connais l’explication de la loi.
Dans l’entendement naturel, l’objet de la connaissance est la relation entre les qualités d’un objet ou des objets, d’où je peux tirer, comme résultat, une loi. Dans l’entendement scientifique, l’objet de la connaissance est la loi formulée par l’entendement naturel, son résultat. Bref, le résultat de l’entendement naturel est une loi tandis que celui de l’entendement scientifique saura l’explication de la loi.
Évidemment, l’homme n’accorde pas à l’entendement scientifique le monopole de l’explication des lois. L’homme a tendance à risquer une explication des lois que lui inspire son entendement naturel. Dans ce cas, « la loi trouve son explication dans le mythe, la religion, la culture, la coutume,… ». Il y a ici une « interprétation d’une volonté », la volonté de prouver l’existence d’une règle universelle, d’un mythe, d’une religion,… Une telle interprétation est inadmissible dans l’entendement scientifique.
En science, l’explication recourt plutôt à « des principes théoriques à partir desquels je pourrai présenter la loi comme le résultat d’une déduction ». La formulation pratique nous donnera l’affirmation suivante : « Étant donné que (principes théoriques posés), les saisons se présentent dans cet ordre (déduction). » La loi devient une explication déduite d’un énoncé de principes. Et seuls sont admis les principes :
1. parfaitement impersonnels, c’est-à-dire ne résultant pas d’une volonté divine;
2. parfaitement abstraits, c’est-à-dire qui ne relèvent pas d’une réalité concrète, une force cosmique concrète (de l’univers matériel);
3. et qui font intervenir des catégories parfaitement universelles, générales, c’est-à-dire des principes qui ne font pas appel à des cas individuels, particuliers, partiels.
Si Dieu intervient dans votre explication, vous n’êtes pas scientifique mais dogmatique. Si votre explication fait appel à des réalités du monde matériel, sensibles ou qui peuvent être perçues par les sens, votre explication n’est pas scientifique. Ici, le modèle de référence pour distinguer l’abstrait du concret est le nombre et les mathématiques, d’où que la science en fasse grand usage. Jamais vous rencontrerez le nombre « 2 » sur la rue, il n’a aucune existence matérielle, il est parfaitement abstrait. En revanche, il peut décrire parfaitement une réalité concrète. Si je dis « deux arbres », votre esprit sait exactement ce que je connais. L’usage du nombre m’évite d’avoir à vous faire un dessin concret de la réalité concrète. Il n’est plus besoin d’un support matériel (dessin) pour représenter le monde matériel. Je représente parfaitement la réalité concrète par des principes parfaitement abstraits. Le mot « arbre » est aussi un concept abstrait mais il n’est pas parfaitement défini, celui qui entend ce mot est libre de sa représentation tandis que le nombre ne laisse aucune liberté.
Enfin, si votre explication utilise des catégories de concepts concernant uniquement quelques exemplaires de l’objet ou des individus à l’étude, plutôt qu’à tous les exemplaires de l’objet ou à tous les individus, votre explication n’est pas scientifique. En fait, la science s’intéresse uniquement aux lois universelles, qui s’appliquent à tous les objets ou individus. Rien n’empêche la science de se pencher sur des cas d’espèce, un cas « qui n’entre pas dans la règle générale, qui doit être étudié spécialement » (Le Petit Robert), mais ces cas sont toujours interprétés en référence à la loi générale, universelle. La science se demande alors pourquoi le cas échappe à la loi universelle établie. La science n’en démord pas, l’universel est la règle. Après tout, comparer un cas particulier à un autre cas particulier ne serait pas très fiable. C’est en comparant une cellule cancéreuse avec la cellule saine qu’on peut avoir la certitude de ce qui afflige la cellule cancéreuse. Bref, vaut mieux d’abord des catégories générales si on ne veut pas être dépourvu devant les cas particuliers.
Si jamais la science laisse à d’autres le soin de la volonté divine, elle est tout de même le résultat d’une forte volonté, « d’une volonté de connaître, d’une entreprise systématique de recherche des lois et d’une recherche systématique des explications de ces lois », ajoute le professeur Clain.
La science est loin de la « manière de juger, d’agir commune à tous les hommes », bref, du « sens commun » ou « bon sens ».19 La présence du mot « sens » dans les deux expressions devrait suffire pour mettre en doute le sens commun. Plus gros est le « bon sens », plus nous devrions en douter. En fait, dire « C’est le gros bon sens », revient à dire « C’est l’évidence même », ce qui n’a rien pour inspirer la pensée certaine.
Le fait qu’un grand nombre de personnes partagent la même évidence nous impressionne et nous incite à croire à une vérité parce que nous jugeons qu’autant de gens ne peuvent tous se tromper en même temps sur la même chose. Or, c’est bien là tout le problème avec le bon sens, il jouit de la force du nombre, tandis que la vérité tient souvent d’un seul homme, comme ce fut le cas avec Nicolas Copernic, Marie Curie, Albert Einstein et plusieurs autres hommes et femmes de science.
Dans l’esprit du gros bon sens, la raison du nombre l’emporte. Dans l’esprit de la science, la raison d’un seul homme peut l’emporter. C’est ce que j’aime de l’esprit scientifique, il permet à quiconque trouve une vérité de changer le monde. La société du sens commun vante la liberté de pensée et la liberté d’expression accordées à chaque personne mais on devient vite un cas à part si on ne pense pas comme tout le monde. On se retrouve isolé. Mais quand tout le monde pense avoir le droit d’être certain parce que tout le monde le croit, le monde résout péniblement ses problèmes parce qu’il est privé du bénéfice du doute.
Quand tout le monde est certain de la même chose, vers qui se tourner quand on n’est pas du même avis ?
Quand on ne pense pas comme tout le monde, n’est-on pas jugé comme un cas à part ? À moins de taire sa différence, la personne qui ne pense pas comme tout le monde est isolée de son groupe, jusqu’à temps qu’elle pense à nouveau comme tout le monde dans son groupe. Autrement, elle devra changer de groupe. Mais, ce faisant, elle commet souvent la même erreur qu’au départ : elle choisit encore des personnes qui pensent comme elle. Visiblement, cette personne est mal à son aise dans un groupe qui ne pense pas comme elle. D’une part, cette personne réclame le droit de ne pas penser comme tout le monde et, d’autre part, elle cherche la compagnie de gens qui pensent comme elle. Cette personne nage en pleine contradiction.
Quand tout le monde a expérimenté sans succès la même chose, où est celui ou celle qui aura une solution vraiment nouvelle ? Nulle part. En tout cas, pas parmi tout le monde, à moins qu’elle s’y soit dissimulée sans crier gare. D’une part, cette personne n’est pas comme tout le monde et, d’autre part, elle se comporte comme tout le monde. Agir ainsi, c’est vivre dans la contradiction.
Quand chaque personne se donne raison personnellement, c’est-à-dire en elle, par elle et pour elle, ne partage-t-elle pas uniquement la solitude intérieure de tout le monde ? Quand une personne se donne raison personnellement, elle se prive de la sagesse accumulée par l’Homme depuis des siècles. Elle vit comme si elle était le premier homme ou la première femme sur Terre, niant le savoir de tous les hommes et de toutes les femmes qui l’ont précédée. Elle n’a alors de bons sens que le sien, et de science que la sienne. D’une part, cette personne souffre de la solitude car il est reconnu que l’homme n’est pas fait pour vivre seul et, d’autre part, elle crée son isolement en s’enfermant dans sa raison. Cette personne vit donc en contradiction avec sa raison. Il sera difficile de la raisonner.
Quand tout le monde se rallie au gros bon sens, à la force du nombre, pour se donner raison, comment se fait-il qu’il y ait autant de gens parmi ce monde qui donnent l’impression voire affirment haut et fort se foutre de ce que les autres pensent? Quand, d’une part, tout le monde pense comme tout le monde et que, d’autre part, tout le monde dit se foutre de ce que les autres pensent, parce que tout le monde le fait, le monde étale au grand jour toute son inconscience. Il y a là une contradiction que l’absence de conscience de la conscience, de réflexion, suffit à expliquer. Si nous sommes si nombreux, ce n’était certainement pas pour nous priver de réflexions.
À force de contradictions pareilles, plusieurs personnes en arrivent à ne plus aimer penser. Dès leurs premières réflexions, elles n’ont pu faire autrement que de tourner en rond, ce qui est assez pour ne pas aimer penser. Elles finiront par nier les contradictions, souvent en les poussant hors de leur conscience pour les refiler à leur inconscient, question de les oublier profondément.
On tourne en rond dans sa raison, comme on tourne en rond en forêt, c’est-à-dire, lorsqu’on est privé de repères, de lumière. On est ainsi privé lorsque rien ne laisse pénétrer la lumière, quand la couche de nuage est si dense et étendue qu’aucune lumière de la Lune et des étoiles est visible aux yeux. Il n’y a qu’un système de pensées sans aucune faille, sans aucun doute, qui prive la raison de lumière. Dans le noir, on se donne raison aveuglément. La raison aveugle ne voit pas les contradictions, elle ne peut que les sentir et éprouver un malaise. Mais la pensée certaine de la raison aveugle ne tient à rien de suffisamment solide pour soulager le malaise de la contradiction. Alors aussi bien les réduire en importance ou les nier. Après tout, l’esprit est davantage préoccupé par le malaise, ce qu’il ressent, que par les contradictions elles-mêmes puisqu’il ne les voit pas.
Il suffirait d’un tout petit doute pour éclairer la raison. La raison éclairée n’est pas embêtée par les contradictions, au contraire, elle crie : « Contredisez-moi ! ». Pourquoi ? Parce qu’elle transforme chaque contradiction en une nouvelle faille pour être toujours plus éclairée. La raison éclairée ne cherche pas à réconcilier toutes les contradictions révélées par la lumière, une tâche qu’elle sait impossible. Elle considère la réconciliation comme exercice. Tant mieux si la réconciliation advient de cet exercice mais le plus important est d’y entraîner la raison à la rigueur d’un éclairage toujours plus pertinent. Car, plus la raison est éclairée, plus elle est en mesure de tirer le bénéfice du doute, c’est-à-dire, de produire une pensée toujours plus certaine. Contredisez-moi !
_____________
NOTES
1. Je reprends ici, à peu de chose près, le texte de L. Meynard, La connaissance, Librairie Classique Eugène Belin, Paris, 1963, p. 31.
2. Le Petit Robert.
3. Voir : La pensée malheureuse, p. 69.
4. Meynard, L. La connaissance, Librairie Classique Eugène Belin, Paris, 1963, p. 32.
5. Huisman, Denis et Vergez, André, Court traité de la connaissance, Classes terminales A-B, Édition Fernard Nathan, 1969, p. 309.Les mots en caractères gras sont des auteurs.
6. Ibid., p. 311.
7. Bachelard, Gaston, La formation de l’esprit scientifique, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1938, Seizième édition, 1999. (Disponible en livre de poche).
8. Nicolle, Jean-Marie, Histoire des méthodes scientifiques – Du théorème de Thalès à la fécondation in vitro, Bréal, 1994, p.107.
9. Clain, Olivier, cours Science, Éthique et Société, programme de formation Télé-Universitaire du département de sociologie de l’Université Laval.
10. Nicolle, Jean-Marie, Histoire des méthodes scientifiques – Du théorème de Thalès à la fécondation in vitro, Bréal, 1994, p.107. Les caractères ont été mis en italique par l’auteur. Le professeur Nicole traite ici de l’enseignement de Gaston Bachelard.
11. Ibid., pp. 107-108.
12. Bachelard, Gaston, La formation de l’esprit scientifique, Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1938, Seizième édition, 1999, pp. 13-15.
13. Tel que rapporté par : Nicolle, Jean-Marie, Histoire des méthodes scientifiques – Du théorème de Thalès à la fécondation in vitro, Bréal, 1994, pp. 115-116.
14. Homme politique et orateur latin, 106 – 43 av. J.-C. Le Petit Larousse Illustré.
15. Gaston Bachelard fait référence à Émile Chartier, dit Alain, « essayiste français » (1868 – 1951). Le Petit Larousse Illustré.
16. Matalon, Benjamin, La construction de la science – De l’épistémologie à la sociologie de la connaissance scientifique, Delachaux et Niestlé S.A., Lausane (Switzerland) – Paris, 1996, pp. 21-22.
17. Matalon, Benjamin, La construction de la science – De l’épistémologie à la sociologie de la connaissance scientifique, Delachaux et Niestlé S.A., Lausane (Switzerland) – Paris, 1996, p. 22.
18. Matalon, Benjamin, La construction de la science – De l’épistémologie à la sociologie de la connaissance scientifique, Delachaux et Niestlé S.A., Lausane (Switzerland) – Paris, 1996, p. 23.
19. Définition donnée par Le Petit Robert au « sens commun », « qui équivaut au bon sens »

La pensée profonde
Pour trouver la cause première
Celui ou celle qui aime penser n’évite pas la pensée profonde mais y plonge toujours avec prudence. Le risque de se perdre dans les profondeurs de la pensée est réel. Rien ne sert de se lancer dans la recherche de la cause première d’un problème et ainsi pouvoir le résoudre une fois pour toutes, à tout le moins, de le comprendre vraiment, s’il devient impossible de revenir à la surface. De nombreuses illusions peuvent nous retenir. Certaines usent du charme de la poésie pour nous perdre dans nos pensées. Voyez par vous-même.
On peut toujours rester à la surface et se laisser bercer par les flots de la mer. Par beau temps, tout va pour le mieux. Malheureusement, la mer perd souvent son calme, signe de problèmes à résoudre. Parfois, il tempête de problèmes. Notre embarcation risque de chavirer à la prochaine vague. Et la plupart d’entre nous prennent place dans un simple canot. Malgré nos efforts honnêtes de pensée positive pour en faire un paquebot, nos mains agrippées au rebord nous trahissent et nous ramènent vite à la dure réalité du tangage et du roulis excessif de la vie en ces jours malades de mauvais temps.
De toute évidence, le recours à l’arme secrète s’impose. Il faut vite sauter à bord du sous-marin de la raison et plonger loin du tumulte des pensées incisives.
Inimaginable d’envisager aplanir les vagues avec nos mains, même avec un mouvement soutenu en nageant directement à la surface de la mer. Ça prendrait un front de bœuf et une pensée écervelée pour se lancer dans l’aventure. C’est pourtant l’impression que me donnent les animateurs des débats d’opinions dans les médias et ailleurs. Tombés à la mer, on ne voit plus que leurs mains tapant désespérément sur le dos des vagues, entourées de dizaines voire de centaines d’autres mains s’agitant dans un pareil effort perdu d’avance. À vol d’oiseau, la scène ressemble au naufrage du Titanic de la raison, retenu à la surface par des poches pleines d’air de l’esprit vide de sens. En fait, il n’y a plus que le courant qui a du sens dans ces débats d’idées. Rien de plus normal : les idées suivent le courant qui les entraîne. Pendant ce temps, l’esprit ballotte dans un sens, puis dans l’autre, revient, ballotte encore dans un sens, puis dans l’autre. Il y a de quoi avoir le mal de mer et plusieurs l’ont, si l’on se fie aux vomissements avalés par la mer de sa gigantesque bouche de liberté d’expression dont l’appétit vorace ne connaît jamais la satiété. C’est peu dire que j’en ai contre les débats d’opinions, de véritables cliniques d’avortement de la raison.
Pendant ce temps, les plus sages, évidemment beaucoup moins nombreux, sont déjà en discussion dans leur raison sous-marine, chargée d’une bonne provision d’idées éclairantes alimentées par des piles de doutes et d’une réserve d’ouverture d’esprit oxygénante reliée à un caisson à air comprimé de connaissances et de compréhensions permettant d’éviter en tout temps les accidents de décompressions de la raison. Une carte des profondeurs du grand Esprit dans une main, le bâton de contrôle des émotions de navigation dans l’autre, le sage s’éloigne lentement mais sûrement de la surface énervée et énervante. Bientôt, seule la lumière des idées l’éclaire. Sur le plateau du continent, il distingue déjà l’épave de la raison utile à rien. Il progresse sur la pente descendante, évite d’autres épaves de l’« hommerie », cette fois, avec difficultés, car les courants idéologiques, les plus meurtriers de l’histoire humaine secouent sans ménagement la raison. Sur la carte, il peut lire : « Cimetière perdu des idées aveugles ». Absorbé par le drame de la vision de toutes ces catastrophes, il est surpris par un premier signe du mal des profondeurs : il hallucine. Il voit des fantômes idéologiques sortir de la coque des navires irraisonnés. Il imagine le pire à l’idée de voir ces fantômes atteindre la réalité de la surface. Il augmente l’arrivée d’oxygène, retrouve ses esprits et le mal disparaît peu à peu. L’hallucination l’a motivé davantage à trouver la cause première du problème, la source de la foule folle tuée par le remous de sa raison sans gouvernail. Il arrive à la limite du plateau de la bêtise, à ses pieds, les bas fonds, dangereux, très dangereux, là où se trouvent les meilleures raisons mais aussi les pires, dont celles avec le pouvoir de l’empêcher de revenir à la surface, qui le rendraient complètement ivre des profondeurs de la pensée.
Mais il dispose d’une deuxième arme secrète : une science des profondeurs, la philosophie. Sa recherche de la cause première ne sera pas désordonnée, sans méthode. Il a mis un certain temps à maîtriser quelque peu cette arme au nom rébarbatif. Au départ, il avait l’impression d’une science difficile et ennuyeuse. Même après une certaine familiarité, cette impression n’est jamais complètement disparue, d’où une certaine prudence, souvent salutaire, il faut le dire, car la science a deux tranchants : on risque de comprendre mais aussi de ne pas être compris.
Une seule condition s’impose pour accepter de courir le risque de la réflexion : demeurer raisonnable par les autres, c’est-à-dire, s’assurer qu’il y aura toujours quelqu’un pour me comprendre et me ramener à la raison si je perds la tête. Un sage est sage tant qu’il n’est pas seul, tant qu’il y a quelqu’un pour prendre de ses nouvelles. Si le sage apprend à réfléchir en profondeur avec sa raison, cela ne lui servirait à rien s’il ne pouvait pas en discuter ensuite avec d’autres, pour recharger ses piles de doutes.
Passons donc aux choses pratiques. Dès que l’on croit avoir trouvé la cause à un problème, il faut en douter. Il sera sage de se demander s’il s’agit bel et bien de la cause première ou de l’effet d’une cause plus profonde. En fait, je dois absolument savoir si je me trouve en présence de l’effet domino1, c’est-à-dire d’un problème résultant de causes successives.
Prenons un problème simple. Je vais acheter un sac de sucre en marchant jusqu’au dépanneur du coin. Je reviens à la maison et je m’aperçois que le sac s’est vidé du tiers de son contenu. Quelle est la cause du problème ? J’examine le sac et j’y repère un trou, exactement à la hauteur des deux tiers. L’évidence me pousse donc à croire que ce trou est la cause du problème. Je peux me limiter à cette évidence, boucher le trou dans le sac et passer à autre chose. Mais ma conscience m’incite à me demander qu’est-ce qui a causé ce trou dans le sac.
Mais je suis pressé par le temps et voilà que je manque de farine. Je marche à nouveau jusqu’au dépanneur pour m’en procurer et je reviens à la maison où je constate une fois de plus que le sac s’est vidé du tiers de son contenu. J’examine le sac et j’y repère un trou, exactement à la hauteur des deux tiers. L’évidence me pousse donc de nouveau à croire que ce trou est la cause du problème.
Mais, je doute d’autant plus de cette évidence parce que l’incident n’est pas isolé; c’est la deuxième fois que je constate la présence d’un trou. La question « Qu’est-ce qui a causé ce trou dans le sac ? » revient à mon esprit. Il y a une cause de la cause. Puisque que c’est moi qui transportais le sac, je dois voir si je suis la cause première de ce problème. Je m’examine et je constate que la pointe de mon crayon a transpercé la poche de côté de mon pantalon, exactement à la hauteur où je portais les sacs en revenant à la maison. N’ayant pas l’habitude de placer mon crayon dans cette poche, justement pour éviter pareil incident, c’est une inattention de ma part qui est la cause première du problème. Le trou dans le sac, la pointe du crayon et mon inattention se sont succédés au banc des accusés; je suis en présence d’un effet domino.
À force de pensées profondes, l’Homme a appris que plusieurs problèmes, pour ne pas dire la plupart, impliquent un effet domino, d’où l’importance d’approfondir jusqu’à la cause première pour être certain de résoudre une fois pour toutes le problème à l’étude.
On trouve la cause première « en envisageant les problèmes à leur plus haut degré de généralité ».2 Dans le cas des sacs percés, j’ai généralisé le problème dès le deuxième incident similaire. Cette généralisation du problème m’a permis de me mettre à la recherche d’une seule et même cause pour les deux trous, de généraliser la cause.
Notez que j’ai facilité ma recherche en me mettant moi-même en cause. Nous devrions toujours vérifier si nous ne sommes pas la cause de notre problème au lieu de s’avouer victimes dès le départ pour excuser d’avance toutes fautes de notre part. S’il est une culture de la victime à entretenir, c’est celle nous incitant à nous demander si nous ne sommes pas victimes de nous-mêmes. L’auto-examen transforme la culture de la victime en une culture de la responsabilité personnelle. Quand c’est toujours la faute des autres, la conscience se ratatine. Nous avons toujours la responsabilité de nos réactions, y compris nos réactions face à ce que nous ne contrôlons pas.
L’exemple du sac percé est anodin mais c’est dans des situations de la vie quotidienne que l’on sait si nous sommes portés ou non à penser au-delà de la simple évidence des problèmes et de leurs causes. Pour paraphraser mon professeur de diction affirmant : « il n’y a pas une diction pour le dimanche et une autre les autres jours de la semaine »; je dis qu’il n’y a pas une conscience du dimanche et une conscience pour tous les autres jours de la semaine. Aussi, chaque fois que l’occasion se présente, nous avons l’obligation de donner à notre pensée la profondeur nécessaire pour bien comprendre.
Pour ce faire, nous devons nous exercer à « Raisonner par généralisation, en allant du particulier au général ».3 L’image de l’entonnoir renversé illustre bien la généralisation, le particulier étant l’extrémité la plus étroite et la généralisation étant l’extrémité la plus large. Si la pensée certaine ne doit pas généraliser trop vite, de peur de ne pas reconnaître toutes les composantes et les éléments en cause dans un tout (dans un problème), la pensée profonde doit généraliser pour trouver la cause première du tout (du problème).
Personnellement, je me réfère à une structure hiérarchique des savoirs pour généraliser. Prenons en exemple, ma recherche suite à la demande d’un de mes clients. Dans ce cas, mon client voulait savoir pourquoi le nouveau format de son produit-vedette4 fut un échec et s’il y avait moyen de prévenir un tel échec. En comparant le témoignage de mon client avec ceux de plusieurs autres chefs d’entreprise et en me documentant sur le sujet, je me suis vite rendu compte que le problème particulier de mon client était en fait un problème général. Les plus récentes études faisaient état d’un taux d’échec de 90 % des produits nouveaux et améliorés (y compris les nouveaux formats). De là, j’ai reconnu au savoir en marketing la structure ou les aspects suivants : commerce, technique, science et philosophie.
Dans l’aspect commercial, j’ai d’abord inclus la connaissance du marketing, celle appliquée lors de la mise en marché des produits, puis la connaissance utile à la vente de la connaissance en marketing. Dans l’aspect technique, j’ai regroupé toutes les techniques d’étude du marché et des consommateurs, telles que les sondages et les groupes de discussion.5 Dans l’aspect scientifique, j’ai rassemblé toutes les hypothèses de base, les théories, à partir desquelles les spécialistes travaillent. Parmi ces théories, il y avait, par exemple, celle soutenant qu’un produit doit répondre à un besoin pour connaître le succès commercial espéré. Dans l’aspect philosophique, j’ai identifié la sagesse des experts, leur façon de penser l’échec et le succès, et leurs conceptions du marketing.
Du commerce, plus spécifiquement, de la connaissance critique de la connaissance en marketing, plusieurs chefs d’entreprise m’ont dit que les consommateurs ne font pas toujours ce qu’ils disent lors des sondages et des groupes de discussion. De la technique, j’ai appris que les sondages et les groupes de discussion étaient les deux techniques les plus utilisées, malgré l’observation des chefs d’entreprise. De ces deux techniques, j’ai compris qu’elles mesuraient ce que les gens disent, leurs opinions. De la science, j’ai été instruit de la théorie du besoin, ci-dessus, et de la théorie stipulant que les consommateurs sont les mieux placés pour connaître leurs besoins et qu’il suffisait de leur demander d’exprimer (leurs opinions sur) leurs besoins pour évaluer les chances de succès d’un produit.
Jusque-là, la démarche m’apparut tout à fait logique mais les résultats sur le terrain ne confirmaient pas les deux théories puisque les chefs d’entreprise ayant suivi les opinions des consommateurs constatent que ces derniers ne font pas souvent ce qu’ils disent, qu’ils n’agissent pas eux-mêmes conformément à leurs propres opinions.
Comme la plupart des gens, je savais déjà que nous n’agissons pas toujours conformément à nos opinions, que nous ne faisons pas toujours ce que nous disons que nous allons faire, même lorsque toutes nos exigences pour passer à l’action sont satisfaites. « Nous sommes, m’ont expliqué les spécialistes, dans l’impossibilité de prédire le comportement des gens avec précision et exactitude parce que les facteurs à contrôler sont trop nombreux et souvent mal connus voire inconnus ».
L’explication me semblait aussi tout à fait logique jusqu’à ce que je lise les rapports de recherche d’un chercheur prétendant le contraire. D’une part, il confirmait qu’on ne peut vraiment pas se fier aux opinions des gens pour prédire ce qu’ils feront, y compris leurs réactions face à un produit. D’autre part, il démontrait qu’on peut se fier à leurs attitudes. Ce chercheur avait mis au point un système de recherche permettant d’identifier et de mesurer les attitudes avec la même exactitude et autant de précisions qu’en physique, et ce, à tout coup et sans jamais se tromper. Ce chercheur avait fait de la recherche marketing auprès des consommateurs une science exacte alors que tous les autres spécialistes croyaient dur comme fer que le marketing était condamné à jamais à demeurer une science parfaitement inexacte.
Je fus surpris d’apprendre que les spécialistes du marketing sur le terrain tout comme ceux des milieux universitaires ne connaissaient ni ce spécialiste ni sa méthode. Ce chercheur étant décédé et les spécialistes actuels ne croyant pas en ses travaux, je dus me résigner à étudier et à expérimenter cette méthode par mes propres moyens. Après cinq années d’expérimentation sur le terrain et de nombreuses consultations de physiciens, je dus conclure que ce spécialiste avait raison.
Il y avait donc deux sciences du marketing, l’une fondée sur la théorie des opinions et l’autre sur la théorie des attitudes. Cependant, l’une et l’autre prétendaient cerner les perceptions, ce qui engendrait une confusion générale. L’histoire du marketing me confirma que cette confusion régnait depuis plusieurs années, depuis les débuts du marketing à titre de spécialisation universitaire au cours des années cinquante.
Comment était-ce possible ? Il me fallait approfondir davantage la question pour y trouver une réponse. J’avais déjà fait le tour de l’aspect scientifique, il me restait l’aspect philosophique. En fait, la science tire ses théories de propositions philosophiques. Le philosophe émet une idée accompagnée d’une explication, la science vérifie si cette idée et son explication reposent ou non sur des faits (scientifiques).
J’ai découvert que les deux sciences répondaient de deux écoles de pensées, de deux philosophies différentes.
La théorie des attitudes provient de la philosophie concevant l’homme comme une machine, une mécanique. Il s’agit du « mécanisme », une « théorie philosophique admettant qu’une classe ou que la totalité des phénomènes puisse être ramenée à une combinaison de mouvements physiques ».6 Parmi ces phénomènes se trouvent le comportement et les attitudes. Selon cette école de pensées, il s’agit de bien connaître la mécanique du comportement et celle des attitudes pour amener l’homme à agir de telle ou telle façon. De là vient l’idée de la manipulation de l’homme comme on manipule une mécanique.
La théorie des opinions s’inspire de toutes les philosophies refusant de voir l’homme comme une simple machine et elles sont nombreuses. À titre d’exemples, la plupart des philosophies de la spiritualité et celles liées au concept de la liberté s’opposent avec vigueur à « l’homme machine ». Certains reconnaissent qu’une partie de l’Homme peut être mécanique, mais ils croient que son esprit ne l’est pas, mais là, pas du tout.
Des centaines d’années de débat n’ont pas encore déterminé la vérité des idées de ces deux écoles philosophiques.
La subdivision des sciences en deux grandes familles n’est pas étrangère à ces deux écoles philosophiques. D’un côté, les sciences de nature qui se réservent le monde physique et, ainsi la possibilité d’être précises et exactes. L’aspect ou la réalité physique de l’homme est incluse dans les sciences de l’homme. De l’autre côté, se trouvent les sciences de l’homme et de la société qui se réservent le monde métaphysique7 (l’aspect immatériel de l’homme et du monde) et, ainsi la possibilité d’être imprécises et inexactes. Bref, d’un côté les sciences exactes du monde physique et, de l’autre, les sciences inexactes du monde métaphysique.
La physique, la cinématique (science du mouvement), la biologie et la chimie forment la famille des sciences exactes. La psychologie, la logique, les disciplines sémiotiques8 et les sciences neuronales liées à la réalité spirituelle forment le groupe des sciences de l’homme tandis que l’histoire, la sociologie, l’économie, la politique et la géographie humaine forment le groupe des sciences de la société, les deux groupes forment la famille des sciences inexactes. En résumé, une science étudiant un objet physique est exacte tandis qu’une science se penchant sur un objet métaphysique est inexacte.
Quand vous vous prononcez sur un sujet, vous devriez toujours être en mesure d’identifier de quelle science relève ce sujet et à quelle famille, exacte ou inexacte, appartient cette science, et ce, de façon à déterminer jusqu’à quel point vous pouvez avoir l’assurance d’être exact. Rappelez-vous simplement ceci : dès que vous quittez le monde physique, matériel, vous perdez la possibilité d’être exact. L’humilité est de mise dans le cas d’un sujet relevant d’une science inexacte.
Dans le cas du marketing, le sujet appartient effectivement à la famille des sciences inexactes, comme me l’ont dit les premiers spécialistes consultés. L’objet du marketing est le marché, relevant de l’économie, et les consommateurs, relevant des sciences de l’homme, pour l’aspect psychologique, et des sciences de la société, pour les aspects sociologiques, économiques, culturels et autres.
C’est dans ce contexte que le marketing a épousé la théorie des opinions. Le consommateur est l’objet de l’étude et ses opinions sont le moyen de le connaître. Les statistiques de ventes, le profil sociologique et autres s’ajouteront aux moyens de connaître mais le consommateur est et demeure l’objet de la connaissance.
Distinguer très nettement l’objet à connaître, le moyen de connaître cet objet et l’objectif de la connaissance donne déjà une bonne profondeur de pensée.
Aussi, je me suis rendu compte que l’autre spécialiste, celui ayant retenu la théorie des attitudes, ne prenait pas pour objet le consommateur. L’objet de ses recherches marketing était plutôt le produit ou le service (dans leur existence matérielle, perceptible). Il était donc tout à fait logique qu’il puisse aboutir à une science exacte, comme la physique, en donnant à ses recherches un tel objet physique. Pour lui, le consommateur n’était pas l’objet à connaître mais plutôt le moyen de connaître. Selon son approche, je connais le produit de par les réactions du consommateur. Selon l’approche des autres spécialistes, je connais les consommateurs de par… les réactions du consommateur au produit. Mêlant, n’est-ce pas ? C’est que l’objet de la connaissance, le consommateur, est aussi le moyen de connaître. En fait, si ces spécialistes réussissent à connaître tout de même le produit, ce qu’ils connaissaient ce que le consommateur connaît du produit, rien de plus. Bref, ils connaissent l’opinion du consommateur au sujet du produit, rien de plus logique, cette fois.
Mais pourquoi recourent-ils aux opinions des consommateurs si elles ne sont pas fiables ? La vraie question est : Pourquoi ces spécialistes prennent pour vrai ce que les consommateurs disent ? Réponse, toute philosophique : parce qu’ils prennent eux-mêmes pour vrai ce qu’ils disent. Je prends pour vrai ce que les autres me disent si je prends moi-même pour vrai ce que je dis. J’accorde à l’autre la même crédibilité que je m’accorde.
Et comment en arrive-t-on à prendre pour vrai ce que l’on dit ? Quand on ne doute pas. Ainsi, la cause première du taux d’échecs de 90 % des produits et des services : l’absence de doute ou une ouverture d’esprit trop étroite de la part des chefs d’entreprise et des spécialistes en marketing. Ma recommandation : une révolution, changer la théorie des opinions pour la théorie des attitudes.9
Mais, pour ce faire, il faudrait une révolution car l’industrie de l’opinion (des sondages et des groupes de discussion) a pris une telle ampleur qu’elle soumet la vérité scientifique (sciences exactes) à ses intérêts commerciaux. Je n’imagine pas les sondeurs se lever debout et affirmer : « Excusez-nous, nous nous sommes trompés. Il ne fallait pas mesurer les opinions mais les attitudes pour des résultats exacts ».
Lorsque la vérité trouvée par les sciences exactes ne triomphe pas, c’est qu’il y a quelque part quelqu’un qui ne respecte pas la hiérarchie du savoir, souvent par simple ignorance et par priorité de ses intérêts aux dépens des autres.
Personnellement, c’est au cours de ma recherche sur le marketing que j’ai appris à hiérarchiser le savoir et à respecter les intérêts de chaque aspect ou domaine de connaissances. Dès lors, j’ai su quoi chercher et comment le chercher. Dans ma hiérarchie, chaque domaine de connaissances et chaque intérêt ont une importance égale aux autres. Cependant, il y a un ordre à respecter : le commerce vient après la technique qui vient après la science qui vient après la philosophie. D’abord l’idée philosophique, purement intuitive, ensuite sa vérification par la science puis, s’il y a lieu, sa production sous la forme d’une technique et, enfin, le commerce de la technique ou du produit de la technique. Chaque domaine de connaissances règne en roi et maître sur son savoir et ses intérêts : la philosophie ne dit pas à la science quoi faire, la science voit elle-même ce qu’elle doit faire et ainsi de suite jusqu’au commerce. Rien n’empêche de nombreux échanges entre les différents domaines de connaissances mais dans le plus grand respect de la souveraineté du savoir et des intérêts de chacun.
Évidemment, c’est un idéal car, dans la réalité, les domaines de connaissances et les intérêts se livrent à un chassé-croisé où il devient souvent difficile de déterminer si tout le monde est à sa place. Ainsi, le simple fait de différencier les domaines de connaissances et leurs intérêts grandit déjà passablement la profondeur de pensée; elle exploite alors tous les domaines de connaissances.
Quand l’expérience nous fait défaut, il s’agit de repérer le plus grand nombre de connaissances et de les classer par domaines de connaissances. L’important est d’avoir en main un nombre suffisant d’informations dans chacun des domaines de connaissances. L’idéal est de se référer à des résumés produits par des experts qui se réfèrent à tous les domaines de connaissances, non pas à une seule spécialité. La fin du 20e siècle et le commencement du 21ème siècle furent et sont propices à de tels résumés; profitez-en.
À ce stade-ci, ce sont les différentes réflexions déjà faites sur le problème qui nous intéressent, quasiment davantage que le problème lui-même. On cherche à identifier tous les aspects relevés par chaque domaine de connaissances. Souvent, deux ou trois résumés suffisent. Dans tous les cas, ne vous fiez jamais à un seul résumé; un minimum de deux résumés est utile pour les comparer l’un avec l’autre. Dans tous les cas aussi, la lecture d’un couvert à l’autre n’est pas obligée. Une analyse rigoureuse des tables des matières vous donnera une idée assez juste de ce qu’il y a à connaître dans votre problème, ce qui a l’avantage de comparer un plus grand nombre de résumés. Préférez les ouvrages avec une table des matières complète et un index, pour faciliter la consultation.
Le classement terminé, vient ensuite l’étude de la connaissance dans chaque domaine. Revoyons donc plus en détail le travail à faire dans chaque domaine.
La philosophie livre la première connaissance : une intuition, « forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement ».10 C’est l’affirmation : « J’ai l’intuition que… ». Bien sûr, vous trouverez différentes intuitions sur un même sujet et de multiples raisonnements philosophiques sur chaque intuition. Le risque de se perdre est très élevé. Je vous recommande de remonter à l’intuition originale, la première à être apparue sur le sujet. Pour ce faire, identifiez l’auteur de chaque intuition. Il s’agit souvent d’un personnage historique dont vous pouvez vérifier la principale contribution à la connaissance du sujet de votre intérêt dans les dictionnaires populaires et spécialisés.
La science s’inscrit à la suite de la philosophie. Il revient à la science de vérifier si cette intuition est certaine, démontrable. Vous savez qu’il y a deux grandes familles de sciences, cherchez dans l’une et dans l’autre. Même si au départ vous avez l’impression que votre sujet relève, disons, des sciences inexactes, assurez-vous que les sciences exactes n’ont pas découvert quelque chose de concret. Par les temps qui courent, plusieurs sciences inexactes s’associent à des sciences exactes en raison de récentes découvertes. À titre d’exemple, mentionnons l’association de la neurologie, une science exacte, avec la psychologie, une science inexacte, dans la formation d’une nouvelle science, la neuropsychologie, une science exacte. Comment l’addition exacte + inexacte = exacte ? Parce que dans ces associations interfamiliales, les sciences exactes imposent leurs conditions. On peut imaginer la science exacte s’adressant à la science inexacte en ces termes : « J’accepte de m’associer avec toi que si tu te fondes sur les preuves physiques que je te donne ». Ces nouvelles sciences sont passionnantes, aussi ne manquez pas de vérifier si elles peuvent vous être utiles.
Cela dit, la science reformulera l’intuition philosophique en une hypothèse de travail sous la forme d’une vérité à prouver. Cette hypothèse sera appelée « paradigme » et définie comme « un ensemble de postulats, en général clairement exprimé »11, les postulats étant « des propositions admises sans démonstration qui servent de point de départ »12. C’est l’affirmation : « On suppose que… ». Pour simplifier, parlons d’une théorie à vérifier. Dans votre recherche, vous devez identifier la ou les théories que la ou les sciences tentent de vérifier concernant le sujet de votre recherche.
Ceci fait, vous devez vous informer des résultats à savoir si les données de l’expérimentation confirment ou infirment la théorie. Si à chaque fois que vous entendez le mot « Science », vous vous imaginez devant des données complexes incompréhensibles, sachez que vous avez uniquement besoin de savoir si la théorie est vraie ou fausse. Ne vous étonnez pas si l’on vous répond : « La théorie est en partie vraie et en partie fausse ». C’est que des doutes persistent et c’est le signe d’éventuels progrès. Demandez une explication de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Enfin, vous devez aussi apprendre si des changements de théories ont eu lieu depuis que la science étudie le sujet. Le cas échéant, prenez bonne note des théories passées et sachez pourquoi elles furent rejetées. L’exercice vous mettra dans le contexte historique général, ce qui vous permettra de donner de la perspective à votre étude, puis de prendre du recul. Trop collé à la réalité d’aujourd’hui, il vous sera difficile de saisir l’évolution de la connaissance et la difficulté restante.
Lorsque la science a démontré la vérité d’une théorie, la technique prend la relève. Elle se chargera alors de l’application pratique de cette théorie sur le terrain. Vous devez connaître sommairement les techniques utilisées en relation avec le problème que vous étudiez. Vous devez aussi vous informer des résultats.
Prenez bien garde de ne pas être berné car plusieurs experts justifient voire vantent davantage leurs techniques que les résultats concrets, souvent et justement parce qu’ils se font attendre.
Dans le cas du suicide, par exemple, les experts font grand bruit de leurs techniques mais elles n’empêchent pas l’augmentation du taux de suicides, année après année, au Québec. Le président d’honneur de la dernière campagne annuelle de prévention du suicide au Québec se demandait publiquement pourquoi le gouvernement n’investit pas massivement dans une large campagne publicitaire, comme il le fait, par exemple, pour l’alcool au volant. Pour l’appuyer dans sa démarche, il faudrait savoir quelle publicité de celle gouvernementale et de celle de l’Opération Nez Rouge a été la plus efficace. Pour l’instant, l’expert en marketing bien avisé sait que la publicité porte fruit uniquement une fois sur deux, sans même qu’il soit possible de déterminer pourquoi. Officiellement, les techniques publicitaires sont vantées davantage que les résultats réellement connus sur le terrain. J’insiste : prenez garde !
Cette mise en garde nous a fait quitter la technique pour entrer dans le commerce, c’est-à-dire dans la promotion des connaissances intuitives, scientifiques et techniques. La société affairiste complique grandement la recherche des vérités profondes parce qu’elle truque le discours officiel rendant public la connaissance. Tout le monde est en affaires avec tout le monde et chacun se sent obligé, non pas de partager sa connaissance, mais de la publiciser. Par conséquent, chaque information du discours officiel doit être vérifiée à sa source avant de déterminer si elle est importante ou non pour votre réflexion.
Maintenant que vous connaissez les différents aspects du sujet, vous devez le formuler tel que chaque aspect le connaît : « En philosophie, le sujet est… », « En science, le sujet est… » et ainsi de suite. Faites de même avec le problème relatif au sujet : « En philosophie, le problème avec mon sujet est… », « En science, le problème avec mon sujet est… » et ainsi de suite.
Au départ, si vous avez vous-même défini le sujet et le problème comme étant techniques, vous devez vous appliquer à connaître le problème dans sa version scientifique, puis dans sa version philosophique et, enfin, dans sa version commerciale. Et cela même si vous êtes fermement convaincu que votre sujet et votre problème sont uniquement techniques car, comme nous l’avons souligné, la théorie avec laquelle la science a travaillé est peut-être fausse, d’où l’efficacité réduite de la technique produite par la science.
Une simple erreur de logique, un manque de cohérence, entre les différents discours des différents domaines de connaissances et la cause du problème peut vous sauter aux yeux, du moins, vous donner une nouvelle compréhension du problème.
Si la société affairiste truque le discours officiel, l’organisation de la société en spécialisation complique encore davantage la recherche. Or, la spécialisation est l’ennemi numéro un de la généralisation utile pour trouver la cause première.
On a souvent l’impression que seule la pensée spécialisée peut se permettre d’être profonde. Nous marions « spécialisation » et « profondeur » en commettant une erreur d’évidence entre la « complexité » et la « profondeur » d’une connaissance. La spécialisation témoigne de la complexité, non pas de la profondeur. La complexité est horizontale; elle s’étend à la surface. La profondeur est verticale; elle va de haut en bas en s’élargissant ou en généralisant.
Vous constaterez rapidement que chaque spécialisation possède sa version de la cause du problème que vous étudiez. Rares sont les résumés offrant une généralisation toute faite, il faut donc généraliser soi-même et, ce faisant, lever les barrières des spécialisations.
Dans son livre « La civilisation inconsciente », l’auteur John Saul présente en ces termes les experts spécialisés que vous rencontreront :
« Nous vivons dans un monde où ceux à qui on a donné le savoir n’ont pas le droit de regarder en l’air ni autour d’eux. C’est la connaissance réduite à l’ignorance. Plus la connaissance est limitée à un seul domaine, plus l’expert est ignorant. » 13
Il qualifie ces spécialistes d’« experts à œillères ». Vous en viendrez vous-même à ce constat lorsque vous vous rendrez compte que la plupart des spécialistes n’ont aucune idée de ce qui se passe dans d’autres domaines que celui de leur spécialisation. Pour la profondeur, on repassera.
Et ces experts à œillères sont en affaires, comme tout un chacun : ils défendent « leurs » intérêts, ceux de « leur » groupe. John Saul écrit :
« Aujourd’hui, le fonctionnement de notre société est fondé pour une grande part sur les relations entre les groupes. Qu’est-ce que je veux dire par groupes ? Certains évoquent aussitôt des compagnies transnationales. D’autres pensent à des ministères gouvernementaux. Le problème n’est pas là. Notre société comporte des milliers de groupes d’intérêt et de spécialistes organisés de façon hiérarchique ou pyramidale. Ce sont soit des compagnies, en effet, soit des groupements de compagnies, soit des professions libérales, ou encore d’étroites catégories d’intellectuels. Ils sont publics ou privés, bien ou mal intentionnés. Des médecins, des avocats, des sociologues, une multitude de groupes scientifiques. Le problème n’est pas de savoir qui ils sont ni ce qu’ils sont. Le problème est que la société est vue comme une somme de tous ces groupes, rien de plus. Et que la loyauté fondamentale de l’individu ne va pas à la société, mais au groupe auquel il appartient.
Les décisions graves et importantes ne sont pas prises après une discussion ou une participation démocratique, mais après des négociations entre les groupes concernés, appuyées sur la compétence, l’intérêt et la capacité à exercer le pouvoir. Je dirais que l’individu occidental, du haut en bas de ce qui est maintenant défini comme l’élite, agit d’abord en tant que membre d’un groupe. En conséquence, il, nous existons principalement en tant que fonction, et non en tant que citoyen, qu’individu. On nous récompense dans nos méritocraties hiérarchiques pour notre réussite en tant que fonction intégrée. Nous savons que les vraies expressions d’individualisme ne sont pas seulement découragées, elles sont pénalisées. Le citoyen actif qui dit ce qu’il pense, a peu de chances de réussir une carrière professionnelle. »14
Non seulement l’expert à œillères est fermé aux autres domaines de connaissances, mais il soumet votre intérêt de connaître à l’intérêt de son groupe. Autrement dit, il vous livrera rarement le fond de sa pensée, ce qu’il sait vraiment ou qu’il soupçonne d’être la vérité vraie, de peur de voir sa carrière mise en péril par son groupe. La situation a de quoi décourager chacun d’entre nous dans sa recherche de la vérité sur la cause première d’un problème. Ce n’est pas tout :
« On suppose que le public n’est pas capable de comprendre et que ce n’est pas la peine de se fatiguer à lui donner des explications. »15
Et si vous avez le malheur de déceler une erreur :
« (…), tous ces groupes se rejettent mutuellement la faute pour la moindre erreur. » 16
Vous vous dites peut-être que vous n’avez pas de temps à perdre à jouer au chat et à la souris dans votre recherche de la cause première. C’est aussi un trait de notre société où nous jugeons que la vérité vraie prend trop de temps à venir :
« Le temps, notre grand ennemi, nous vaincra si nous hésitons un instant pour réfléchir ou douter. Dans notre panique, nous nous précipitions vers la certitude ». 17
Pourtant, « les gens n’ont jamais eu autant de temps ».18
« Rien que depuis le début du siècle (XXè »), l’espérance de vie des Occidentaux a augmenté de vingt-cinq ans. Nous disposons à présent de 50 % de temps de plus pour faire ce dont nous avons envie. Compte tenu de notre niveau de vie général et de notre éducation, nous pourrions utiliser au moins un peu de ce temps pour réfléchir davantage et remplacer la course à la certitude par une promenade vers le doute.
Pourtant, il semble qu’avoir 50 % de temps en plus ait produit l’effet contraire. Nous nous sommes retranchés dans ces peurs inconscientes qui nous rendent sensibles à la menace du temps. Ces dernières années, les menaces de la nécessité, du « maintenant ou jamais », ont influencé avec une remarquable facilité et à maintes reprises des publics très complexes. » 19
Lorsque nous avons un problème, il nous apparaît donc tout à fait naturel de vouloir le résoudre au plus tôt. C’est plus particulièrement le cas d’un problème technique, comme si je constatais à l’instant même où j’écris ces mots que mon ordinateur ne répondait plus à mes doigts enfonçant les touches du clavier. Comme mon ami spécialiste en la matière dort en cette nuit d’hiver, je prendrais sans doute une pause en allant au lit moi aussi. Mais, dès le matin venu, je me lèverais d’un trait pour me précipiter au téléphone en vue de le joindre et de le consulter subito presto. Un problème technique dans un monde dominé par la technique est toujours très lourd de conséquences. Je m’imaginerais mal soumettre à un éditeur un document écrit à la main, même parfaitement lisible. Le seul fait de ne pas disposer d’un ordinateur porterait atteinte à ma crédibilité. J’entends l’éditeur se dire à lui-même : « Il a pensé à tout, sauf à l’ordinateur ».
Quant aux problèmes d’autres natures, pourquoi laisser le temps s’ajouter à notre stress ? Sous la pression du temps, un nombre incroyable de problèmes sont expliqués selon les premières causes du bord et solutionnés avec les premières certitudes évidentes. Conséquence, les problèmes finissent, un jour ou l’autre, par se manifester à nouveau, souvent dans une nouvelle version, pire que la précédente. Le vrai problème : on n’a pas pris le temps de trouver la cause première, de vérifier tous les aspects du problème.
Tant et aussi longtemps que l’on ne prend pas le temps de penser, le résultat demeure partiel et superficiel, nos pensées manquent de profondeur, et les problèmes reviennent sans cesse.
L’Homme, nous dit-on, a beaucoup évolué. À mes yeux, l’homme technique et l’homme scientifique ont constamment évolué depuis leur naissance. Il en va de même de l’homme commercial ou affairiste, du moins, dans le sens de ses propres intérêts, car, pour ce qui est du bien commun, je ne suis pas sûr qu’une évolution acquise aux dépens des autres soit vraiment une évolution. Dans mon dictionnaire, « évolution » rime avec « partage », comme le font l’homme scientifique et l’homme technique avec nous tous. Quant à l’homme citoyen, il est devenu plus bavard mais moins efficace dans l’exercice de la démocratie, même sous son toit.
Reste l’homme penseur, profond ou philosophique, il est le parent pauvre de la grande famille humaine. Il arrive à peine à se reconnaître lui-même. Il est troublé à l’idée de creuser, pourtant ancrée dans sa nature depuis la nuit des temps. Il trouve dans le temps le moyen d’aller contre sa propre nature. « On ne va pas encore philosopher ce soir », lance-t-il sur un ton lancinant et pénible.
Vous vous souvenez du professeur qui nous disait : « Prenez le temps de bien faire votre examen, de réviser vos réponses ». Quand la feuille d’examen, que dis-je, le cahier des questions arrivait sur notre pupitre, on constatait que ce contrôle de nos connaissances et de notre compréhension était en fait un contrôle de vitesse. « Quand on a compris, on est supposé aller plus vite que celui qui n’a pas compris », croit-on faussement. Pourtant, « C’est toujours parce qu’on est allé trop vite qu’on a fait des erreurs », dit-on aussi. La vitesse n’est pas un critère de l’intelligence. On devrait lui préférer la rigueur et la profondeur.
Le nombre de questions était généralement inversement proportionnel au nombre de minutes accordées. Les premiers à quitter la salle de classe étaient les plus rapides à fournir les réponses. On s’aperçut plus tard qu’ils n’avaient pas tous compris ce qu’ils avaient répondu. Rien n’empêche que leur sortie de la salle de classe nous incitait à accélérer la cadence. Puis, quand on relevait la tête pour constater, cette fois, que plus de la moitié des chaises étaient vides, l’idée de ne pas être normal nous passait par la tête, comme un éclair. Heureusement, car ce n’était ni le temps ni le moment d’y penser, examen oblige. Puis nous étions surpris par la cloche annonçant la fin de la période de l’examen, sans qu’on ait eu le temps de répondre à toutes les questions. Quels mauvais gestionnaires de temps faisions-nous!
À l’époque, j’avais titré l’un de mes poèmes : « L’Homme de Course », par analogie avec l’automobile de course. Je m’étonnais que l’on coure à gauche et à droite, d’un cours à l’autre, d’une matière à l’autre. Ici aussi, pour la profondeur, on repassera.
Je comprends aujourd’hui pourquoi la plupart de mes collègues et consœurs de classe trouvaient que le cours de philo était le plus long; ça n’allait pas assez vite. Leur esprit surexcité par la vitesse de penser était tout perdu dans l’univers de la philosophie où tout semble au ralenti en état d’apesanteur, comme sur la Lune.
« Perdu dans l’espace ? » C’est vrai, il faut l’admettre, le professeur avait lui-même l’air perdu, parfois, souvent ou toujours, selon le point de vue. C’était le sujet préféré à la sortie de la salle de cours : « As-tu trouvé que le prof avait l’air perdu ? ». On aurait dit que le prof s’amusait à nous poser le défi de le comprendre, plutôt que de nous enseigner. On sentait nettement chez la plupart des élèves qu’aucun ne voulait être comme le professeur de philo, aussi mêlé et mêlant. Les élèves perdus semblaient souffrir le calvaire et l’errance du professeur de philosophie nous confirmait la possibilité d’être aussi perdus une fois adulte.
Mal enseignée, la pensée profonde nous répugne toute notre vie si aucune expérience ne nous la rend agréable.
La pensée profonde a deux utilités, la première, nous l’avons vu, guider notre recherche de la cause première, la deuxième, nous allons le voir, aider à développer une philosophie de vie. La difficulté énorme de la plupart des gens face aux questions « Quelle est ta philosophie de vie ? » et « Quel est le sens de la vie pour toi ? », auxquelles la réponse est souvent « Qu’est-ce que tu veux dire par là ? », démontre hors de tout doute raisonnable que la pensée profonde est généralement mal connue et mal enseignée.
Pourtant, personne ne peut vivre sans une philosophie de vie, sans une « conception générale, une vision plus ou moins méthodique du monde et des problèmes de la vie ».20 Autrement dit, nous avons tous une philosophie de vie. Les uns en sont plus ou moins conscients. Les autres en sont totalement inconscients. À preuve, la philosophie de vie se traduit par des attitudes face au monde et aux problèmes de la vie. Or, nous avons tous de telles attitudes, consciemment et/ou inconsciemment. En fait, le choix d’avoir ou non des attitudes face au monde et aux problèmes de la vie ne nous est pas donné. Adopter des attitudes est une propriété de l’esprit, comme l’estomac a la propriété de diriger. En fait, notre esprit est toujours en état d’adopter une attitude et il ne nous laissera jamais sans aucune attitude, sans quoi il y aurait un vide insupportable qui nous laisserait sans comportement. Même figés, nous exprimons une attitude.
Les attitudes font partie de la « chaîne de commandement » de notre comportement, si je puis dire. L’attitude est le dernier facteur entrant en jeu, juste avant qu’un geste soit posé. Elle se définit comme un « ensemble de jugements et de tendances qui poussent à un comportement ».21 Au stade final, on peut voir de nos yeux les attitudes d’une personne dans son corps, plus spécifiquement dans sa « manière de se tenir qui correspond à une certaine disposition psychologique », et « philosophique » devons-nous ajouter. Selon moi, notre disposition psychologique prend racine ou exprime notre disposition philosophique. À mes yeux, la psychologie est en quelque sorte une version logique et émotive de ma philosophie de vie.
À titre d’exemple, une personne qui se croise les bras adopte une attitude de défense, elle se sent attaquée, intimidée, bref, elle ressent le besoin de se protéger.22 Je puis dire de sa philosophie qu’elle compte déjà un jugement sur ce qui la fait réagir, par exemple, sur le propos dont je l’entretiens. Je tiens ici un sujet de sa conception du monde ou d’un problème de la vie lié à mon propos. Aussi, je puis dire de sa philosophie de vie concernant ce sujet qu’elle n’est pas favorable au jugement inclus dans mon propos.
C’est peu mais c’est tout de même un bon début. J’ai un sujet qui peut m’inspirer d’autres propos pour découvrir d’autres réactions. Je peux qualifier la philosophie de vie de mon hôte de favorable, défavorable ou mi-favorable mi défavorable (indifférence) au sujet de mon propos. C’est plus que plusieurs livres de philosophie peuvent m’apprendre de pratique.
À la limite, nous pouvons dire : « Montrez-moi quelles sont vos attitudes à l’égard du monde et des problèmes de la vie, je vous dirai quelle est votre philosophie de vie ».
J’ai bien écrit : « montrez-moi », non pas « dites-moi », car les attitudes et les opinions sont deux concepts différents. De plus, je peux verbaliser mes opinions mais je ne peux pas verbaliser mes attitudes car « les attitudes peuvent être inconscientes et généralement elles le sont ».23 Les attitudes sont adoptées par le corps (manière de se tenir). Le ton avec lequel je livre mes opinions peut laisser voir mon attitude face au sujet sur lequel je me prononce. Mais mon opinion n’est pas garante de mes attitudes. Je puis me montrer favorable à un geste dans mes opinions et adopter une attitude d’indifférence qui fera que je ne poserai pas le geste auquel j’étais pourtant favorable. Nous l’avons vu, je peux dire une chose et en faire une autre. Pourquoi ? Parce qu’au moment où je parle, je ne tiens pas compte de mes attitudes profondes parce que j’en suis généralement inconscient. Lorsque je livre mon opinion, je suis uniquement conscient de ce que je pense et de l’image que je donne à l’autre de par mes propos, ce qui peut me retenir de dire le fond de ma pensée.
Puisque nous sommes généralement inconscients de nos attitudes, il faut déployer un effort pour en prendre conscience. Cet effort consiste essentiellement à prendre du recul face à soi-même. Si la pensée certaine exige de prendre du recul face à notre conscience, nos connaissances et nos compréhensions, la pensée profonde demande du recul face à notre inconscience, nos réactions cachées, incluant nos émotions et nos attitudes.
L’exercice commence réellement le jour où nous nous avouons être davantage inconscients que conscients. Mais n’allez pas croire qu’il se termine le jour où nous avons pris conscience de toute notre inconscience au point d’être pleinement conscients de tout. Dans cet état, la vie nous serait insupportable. L’inconscient, si je puis dire, est chargé de fonctions que la conscience ne peut pas remplir. L’inconscient est chargé de nous maintenir dans un certain état d’équilibre entre ce dont nous avons conscience de ce qui se passe et de ce qui se passe réellement. Avec une conscience pleine et entière, nous ne tiendrions pas debout plus d’une minute sans perdre conscience, et ce n’est pas un jeu de mots. La réalité nous serait impossible à concevoir, visible et invisible. Aussi, imaginez-vous pleinement conscient de la faim dans le monde au moment des repas : pourriez-vous encore manger ? Si vous êtes tenté de me répondre : « Tout dépend de ma philosophie face aux problèmes de la vie », vous avez pleinement raison. Mais encore faut-il que vous puissiez en être suffisamment conscient pour me l’expliquer. Or, cette philosophie de vie, vous l’avez acquise de vos parents et des autres membres de votre famille, de vos professeurs, de vos amis-es,…, et ce, sans vraiment vous rendre compte. Voilà donc pourquoi la pensée profonde demande de prendre du recul face à son inconscience, à commencer par l’acceptation de son inconscience.
Alors si l’objectif de l’exercice n’est pas de prendre conscience de tout, quel est-il ? L’objectif est de développer une pensée toujours plus profonde, plus générale, pour éviter d’être superficiel et trop particulier. L’avantage est toujours entre les mains de la pensée profonde, d’une vision générale du monde et des problèmes de la vie, car ce n’est qu’une vue générale qui permet de constater la profondeur que je peux atteindre par la pensée, comme le plongeur du haut de son tremplin a une vue générale de la profondeur de l’eau qui l’attend. Aussi, la pensée profonde envisage la connaissance et la compréhension comme un processus à long terme, à l’abri des courants de la surface, des modes passagères, qui ne nous conduisent pas nécessairement là où nous nous épanouirons dans tout notre être.
Il est facile de se perdre dans la profondeur inconsciente de l’esprit car nous sommes alors privés des repères auxquels nous sommes habitués lorsque nous naviguons en surface, comme le marin d’eau douce devenu sous-marinier est privé du soleil, de la lune et des étoiles pour s’orienter.
Aussi, à la surface, la portée de nos pensées se limite à la portée de nos sens, aux évidences premières, celles qui nous entourent. C’est lorsque nous réfléchissons à ces évidences que nous donnons à nos pensées une plus grande portée, une certaine certitude. Mais nous sommes toujours à la surface et cette certitude ne peut pas s’étendre plus loin que l’horizon visible. Nous pouvons toujours franchir les limites de cet horizon par le rêve et l’imagination mais il nous faut alors accepter de penser en l’absence de preuve. Cependant, même dans le rêve et l’imagination, nos pensées restent accrochées à nos sens, sauf que, cette fois, c’est nous qui nous inventons des évidences.
Enfin, à la surface, il est impossible d’envisager les problèmes à leur plus haut degré de généralité, bref, de généraliser, en vue de trouver la cause première car le particulier retient toujours notre attention. « Il ne faut pas généraliser un cas particulier », nous dit-on, avec raison d’ailleurs. En fait, à la surface, tout est particulier, « original, distinctif ».24 Aussi, notre pensée a pris l’habitude de particulariser, de « distinguer, différencier par des traits particuliers »25, « qui appartiennent en propre à quelqu’un, à quelque chose », tout au plus, à une « catégorie d’êtres, de choses »26. Ici, la généralisation sert à former des groupes (de gens et de choses), non pas à trouver la cause première. La pensée ne parvient pas à se débarrasser du sentiment d’être particulière et elle voit ce qu’elle ressent, c’est-à-dire, ce qu’il y a de particulier plutôt que le général. Bref, impossible de cerner le problème général et de trouver la cause générale.
Seule une plongée sous la surface, une pensée profonde, permet de libérer nos pensées de nos sens et du particulier. Ainsi et seulement ainsi, nous pouvons atteindre le général, oublier les détails et se concentrer sur l’essentiel, et enfin prendre l’initiative de donner un sens aux choses, au monde, à la vie, aux problèmes.
Dans ce cas, notre pensée a besoin de nouveaux repères. D’une part, les différents domaines de connaissances et leur ordre sont d’excellents repères pour approfondir un sujet. D’autre part, nos attitudes sont aussi d’excellents repères pour s’approfondir soi-même.
Il suffit souvent d’identifier une première attitude pour être en position de reconnaître les autres. À nous de la qualifier de favorable, défavorable ou mi-favorable et de tenter une première explication d’après un premier domaine de connaissances. Voilà, la pensée profonde est née.
_______________
NOTES
1. L’expression est tiré du jeu de domino où les tablettes sont posées debout, assez proches l’une de l’autre, de façon à ce que la chute de la première entraîne la chute de la deuxième, la chute de la deuxième celle de la troisième et ainsi de suite.
2. Le Petit Robert. Je tire cette citation de la définition du mot philosophie.
3. Généraliser : » Raisonner par généralisation, en allant du particulier au général », Le Petit Robert.
4. Meilleur vendeur.
5. Groupe de consommateurs soumis à différentes questions.
6. Le Petit Robert.
7. Qui est d’ordre rationnel, et non sensible. Le Petit Robert. Les sciences métaphysiques se penchent sur les aspects non sensibles de l’homme et de la société, c’est-à-dire les aspects non perceptibles par nos sens ou qui n’ont pas d’existence matérielle.
8. Théorie générale des signes et de leur articulation dans la pensée. Le Petit Robert.
9. J’ai écrit un livre sur le sujet (en voie d’édition) : Comment motiver les consommateurs à l’achat de votre produit au détriment de la compétition – Tout ce que vous n’apprendrez jamais à l’université en recherche marketing auprès des con-sommateurs. À consulter si vous êtes intéressé à en savoir plus. Ici, je dois revenir à mon sujet principal.
10. Intuition : » Sentiment plus ou moins précis de ce qu’on ne peut vérifier, ou de ce qui n’existe pas encore », Le Petit Robert.
11. Le Trésor – Dictionnaire des Sciences, sous la direction de Michel Serres et Nayla Farouki, Flammarion, Paris, 1997. p. 681.
12. Le Trésor – Dictionnaire des Sciences, sous la direction de Michel Serres et Nayla Farouki, Flammarion, Paris, 1997. p. 94.
13. Saul, John Ralston, La civilisation inconsciente, Éditions Payot & Rivages, Paris, 1997, p. 118.
14. Saul, op. cit., pp. 41-42.
15. Saul, op. cit., p. 107.
16. Saul, op. cit., p. 114.
17. Saul, op. cit., p. 175.
18. Saul, op. cit., pp. 175-176.
19. Saul, op. cit. p. 176.
20. Le Petit Robert.
21. Le Petit Robert.
22. Livres de références utiles : Pease, Allan, Interpréter les gestes, les mimiques, les attitudes − Pour comprendre les autres sans se trahir, Éditions Nathan, Paris, 1988, 224 pages, illustrations nombreuses. Axtelle, Roger, Le pouvoir des gestes – Guide de la communication non verbale, InterÉditions, Paris, 1993, 260 pages, illustrations. Hall, Edward T. et Hall, Mildread Reed, Guide du comportement dans les affaires − Allemagne, États-Unis, France, Éditions du Seuil, 1990, 261 pages.
23. Goleman, Daniel, L’intelligence émotionnelle, Éditions Robert Laffont, Paris, 1997, p. 76.
24. Le Petit Robert
25. Le Petit Robert
26. Le Petit Robert

Liste des articles par ordre de publication
Article # 1 : Introduction
Témoignage de ma recherche personnelle au sujet de la philothérapie (philosophie + thérapie) ou, si vous préférez, de la pratique de la philosophie en clinique. Il s’agit de consultation individuel ou de groupe offert par un philosophe praticien pour nous venir en aide. Elle se distingue de la « psychothérapie » (psychologie + thérapie) en ce qu’elle utilise des ressources et des procédés et poursuit de objectifs propres à la philosophie. On peut aussi parler de « philosophie appliquée ».
Article # 2 : Mise en garde contre le copinage entre la philosophie et la psychologie
La philothérapie gagne lentement mais sûrement en popularité grâce à des publications de plus en plus accessibles au grand public (voir l’Introduction de ce dossier).
L’un des titres tout en haut de la liste s’intitule « Platon, pas Prozac! » signé par Lou Marinoff paru en français en l’an 2000 aux Éditions Logiques. Ce livre m’a ouvert à la philothérapie.
L’auteur est professeur de philosophie au City College de New York, fondateur de l’Association américaine des praticiens de la philosophie (American Philosophical Practitioners Association) et auteurs de plusieurs livres.
Article # 3 : Philothérapie – Libérez-vous par la philosophie, Nathanaël Masselot, Les Éditions de l’Opportun
Présentation du livre Philothérapie – Libérez-vous par la philosophie suivie de mes commentaires de lecture.
Article # 4 : Sur le divan d’un philosophe – La consultation philosophie : une nouvelle démarche pour se connaître, changer de perspective, repenser sa vie. Jean-Eudes Arnoux, Éditions Favre
Présentation du livre Sur le divan d’un philosophe – La consultation philosophie : une nouvelle démarche pour se connaître, changer de perspective, repenser sa vie suivie de mes commentaires de lecture.
Article # 5 : Philosopher pour se retrouver – La pratique de la philo pour devenir libre et oser être vrai, Laurence Bouchet, Éditions Marabout
Cet article présente et relate ma lecture du livre « Philosopher pour se retrouver – La pratique de la philo pour devenir libre et oser être vrai », de Laurence Bouchet aux Éditions Marabout. Malheureusement ce livre n’est plus disponible à la vente tel que mentionné sur le site web de l’éditeur. Heureusement on peut encore le trouver et l’acheter dans différentes librairies en ligne.
Article # 6 : Une danse dangereuse avec le philothérapeute Patrick Sorrel
Cet article se penche sur l’offre du philothérapeute Patrick Sorrel.
Article # 7 : La consultation philosophique – L’art d’éclairer l’existence, Eugénie Vegleris
Le livre « La consultation philosophique – L’art d’éclairer l’existence » de Madame Eugénie Vegleris aux Éditions Eyrolles se classe en tête de ma liste des meilleurs essais que j’ai lu à ce jour au sujet de la « philothérapie ».
Article # 8 : Guérir la vie par la philosophie, Laurence Devillairs, Presses universitaires de France
À ce jour, tous les livres dont j’ai fait rapport de ma lecture dans ce dossier sont l’œuvre de philosophes consultants témoignant de leurs pratiques fondées sur le dialogue. Le livre « Guérir la vie par la philosophie » de Laurence Devillairs aux Presses universitaires de France (PUF) diffère des précédents parce que l’auteure offre à ses lecteurs une aide direct à la réflexion sur différents thèmes.
Article # 9 : Du bien-être au marché du malaise – La société du développement personnel – par Nicolas Marquis aux Presses universitaires de France
J’ai lu ce livre à reculons. J’ai appliqué les feins dès les premières pages. L’objectivité sociologique de l’auteur m’a déplu. Ce livre présente aux lecteurs des observations, que des observations. L’auteur n’en tire aucune conclusion.
Article # 10 : Happycratie : comment l’industrie du bonheur a pris le contrôle de nos vies, Eva Illouz et Edgar Cabanas, Premier Parallèle, 2018
J’accorde à ce livre cinq étoiles sur cinq parce qu’il m’a révélé les coulisses de la quête du bonheur au cœur de notre société néo-libérale. Je savais que cette obsession du bonheur circulait au sein de la population, notamment par le biais des coach de vie et des agents de développement personnel, mais je n’aurais jamais imaginé qu’elle cachait une véritable industrie soutenue par une idéologie psychologisante. Jusque-là, je ne connaissais de cette industrie que le commerce des livres et la montée en puissance des coachs de vie dédiés à la recherche du bonheur.
Article # 11 : La consultation philosophique, Oscar Brenifier, Éditions Alcofribas, 2020
J’ai adoré ce livre. Il est dense, très dense. On ne peut pas le lire comme un roman. Me voici enfin devant un auteur qui dit tout, où, quand, comment il observe, comment il pense, comment il chemine, comment il voit, comment il entend, comment il anticipe, comment il tire ses conclusions… Bref, un auteur qui expose son propre système de pensée dans un essai plus que formateur pour le nôtre.
Article # 12 : Fin du chapitre : Oscar Brenifier, philosophe praticien
La lecture du livre «La consultation philosophique» signé par le philosophe praticien Oscar Brenifier (voir article #11 de notre dossier «Consulter un philosophe – Quand la philosophie nous aide») nous apprend qu’il adresse un document à ses clients potentiels. J’ai écrit à monsieur Brenifier pour lui demander s’il pouvait me faire parvenir ce document.
Article # 13 : La philo-thérapie, Éric Suárez, Éditions Eyrolles, 2007
Cet article présente et relate ma lecture du livre du «La philo-thérapie» de Éric Suárez, Docteur en philosophie de l’Université Laval (Québec), philosophe praticien (Lausanne), publié en 2007 aux Éditions Eyrolles. Ce livre traite de la consultation philosophique ou, si vous préférez, de la philo-thérapie, d’un point de vue pratique. En fait, il s’agit d’un guide pour le lecteur intéressé à acquérir sa propre approche du philosopher pour son bénéfice personnel. Éric Suárez rassemble dans son ouvrage vingt exemples de consultation philosophiques regroupés sous cinq grands thèmes : L’amour, L’image de soi, La famille, Le travail et le Deuil.
Article # 14 : Comment choisir son philosophe ? Guide de première urgence à l’usage des angoissés métaphysiques, Oreste Saint-Drôme avec le renfort de Frédéric Pagès, La Découverte, 2000
Ce livre se caractérise par l’humour de son auteur et se révèle ainsi très aisé à lire. D’ailleurs l’éditeur nous prédispose au caractère divertissant de ce livre en quatrième de couverture : «Étudier in extenso la pensée des grands théoriciens et en extraire un mode de réflexion agissant est une mission impossible pour l’honnête homme/femme. C’est pourquoi l’auteur de cet ouvrage aussi divertissant que sérieux propose des voies surprenantes au premier abord, mais qui se révèlent fort praticables à l’usage. L’une passe par la rencontre avec la vie et la personnalité du philosophe : la voie des affinités électives».
Article # 15 : La philosophie comme manière de vivre, Pierre Habot, Entretiens avec Jeanne Cartier et Arnold I Davidson, Le livre de poche – Biblio essais, Albin Michel, 2001
Référencé par un auteur à mon programme de lecture, le livre «La philosophie comme manière de vivre» m’a paru important à lire. Avec un titre aussi accrocheur, je me devais de pousser plus loin ma curiosité. Je ne connaissais pas l’auteur Pierre Hadot : «Pierre Hadot (né à Paris, le 21 février 1922, et mort à Orsay, le 24 avril 20101) est un philosophe, historien et philologue français, spécialiste de l’Antiquité, profond connaisseur de la période hellénistique et en particulier du néoplatonisme et de Plotin. Pierre Hadot est l’auteur d’une œuvre développée notamment autour de la notion d’exercice spirituel et de la philosophie comme manière de vivre.» (Source : Wikipédia)
Article # 16 : La philosophie, un art de vivre de vivre, Collectif sous la direction de Jean-François Buisson, Les Éditions Cabédita, 2021
Jeanne Hersch, éminente philosophe genevoise, constate une autre rupture encore, celle entre le langage et la réalité : « Par-delà l’expression verbale, il n’y a pas de réalité et, par conséquent, les problèmes ont cessé de se poser (…). Dans notre société occidentale, l’homme cultivé vit la plus grande partie de sa vie dans le langage. Le résultat est qu’il prend l’expression par le langage pour la vie même. » (L’étonnement philosophique, Jeanne Hersch, Éd. Gallimard.) / On comprend par là qu’aujourd’hui l’exercice du langage se suffit à lui-même et que, par conséquent, la philosophie se soit déconnectée des problèmes de la vie quotidienne.» Source : La philosophie, un art de vivre, Collectif sous la direction de Jean-François Buisson, Les Éditions Cabédita, 2021, Préface, p. 9.
Article # 17 : Socrate à l’agora : que peut la parole philosophique ?, Collectif sous la direction de Mieke de Moor, Éditions Vrin, 2017
J’ai trouvé mon bonheur dès l’Avant-propos de ce livre : «Laura Candiotto, en insistant sur le rôle joué par les émotions dans le dialogue socratique ancien et sur l’horizon éthique de celui-ci, vise à justifier théoriquement un «dialogue socratique intégral», c’est-à-dire une pratique du dialogue socratique qui prend en compte des émotions pour la connaissance.» Enfin, ai-je pensé, il ne s’agit plus de réprimer les émotions au profit de la raison mais de les respecter dans la pratique du dialogue socratique. Wow ! Je suis réconforté à la suite de ma lecture et de mon expérience avec Oscar Brenifier dont j’ai témoigné dans les articles 11 et 12 de ce dossier.
Article # 18 : La philosophie, c’est la vie – Réponses aux grandes et aux petites questions de l’existence, Lou Marinoff, La table ronde, 2004
Lou Marinoff occupe le devant de la scène mondiale de la consultation philosophique depuis la parution de son livre PLATON, PAS PROJAC! en 1999 et devenu presque’intantément un succès de vente. Je l’ai lu dès sa publication avec beaucoup d’intérêt. Ce livre a marqué un tournant dans mon rapport à la philosophie. Aujourd’hui traduit en 27 langues, ce livre est devenu la bible du conseil philosophique partout sur la planète. Le livre dont nous parlons dans cet article, « La philosophie, c’est la vie – Réponses aux grandes et aux petites questions de l’existence », est l’une des 13 traductions du titre original « The Big Questions – How Philosophy Can Change Your Life » paru en 2003.
Article # 19 : S’aider soi-même – Une psychothérapie par la raison, Lucien Auger, Les Éditions de l’Homme
J’ai acheté et lu « S’aider soi-même » de Lucien Auger parce qu’il fait appel à la raison : « Une psychothérapie par la raison ». Les lecteurs des articles de ce dossier savent que je priorise d’abord et avant tout la philothérapie en place et lieu de la psychothérapie. Mais cette affiliation à la raison dans un livre de psychothérapie m’a intrigué. D’emblée, je me suis dit que la psychologie tentait ici une récupération d’un sujet normalement associé à la philosophie. J’ai accepté le compromis sur la base du statut de l’auteur : « Philosophe, psychologue et professeur ». « Il est également titulaire de deux doctorats, l’un en philosophie et l’autre en psychologie » précise Wikipédia. Lucien Auger était un adepte de la psychothérapie émotivo-rationnelle créée par le Dr Albert Ellis, psychologue américain. Cette méthode trouve son origine chez les stoïciens dans l’antiquité.
Article # 20 (1/2) : Penser par soi-même – Initiation à la philosophie, Michel Tozzi, Chronique sociale
J’accorde à ce livre cinq étoiles sur cinq et je peux même en rajouter une de plus, une sixième, pour souligner son importance et sa pertinence. Il faut le lire absolument ! Je le recommande à tous car il nous faut tous sortir de ce monde où l’opinion règne en roi et maître sur nos pensées.
Article # 20 (2/2) : Penser par soi-même – Initiation à la philosophie, Michel Tozzi, Chronique sociale
Dans la première partie de ce rapport de lecture du livre « Penser par soi-même – Initiation à la philosophie » de Michel Tozzi, je vous recommandais fortement la lecture de ce livre : « J’accorde à ce livre cinq étoiles sur cinq et je peux même en rajouter une de plus, une sixième, pour souligner son importance et sa pertinence. Il faut le lire absolument ! Je le recommande à tous car il nous faut tous sortir de ce monde où l’opinion règne en roi et maître sur nos pensées.» Je suis dans l’obligation d’ajouter cette deuxième partie à mon rapport de lecture de ce livre en raison de ma relecture des chapitres 6 et suivants en raison de quelques affirmations de l’auteur en contradiction avec ma conception de la philosophie.
Article # 21 – Agir et penser comme Nietzsche, Nathanaël Masselot, Les Éditions de l’Opportun
J’accorde au livre Agir et penser comme Nietzsche de Nathanaël Masselot cinq étoiles sur cinq. Aussi facile à lire qu’à comprendre, ce livre offre aux lecteurs une excellente vulgarisation de la philosophie de Friedricha Wilhelm Nietzsche. On ne peut pas passer sous silence l’originalité et la créativité de l’auteur dans son invitation à parcourir son œuvre en traçant notre propre chemin suivant les thèmes qui nous interpellent.
Article # 22 – La faiblesse du vrai, Myriam Revault d’Allones, Seuil
Tout commence avec une entrevue de Myriam Revault d’Allonnes au sujet de son livre LA FAIBLESSE DU VRAI à l’antenne de la radio et Radio-Canada dans le cadre de l’émission Plus on de fous, plus on lit. Frappé par le titre du livre, j’oublierai le propos de l’auteur pour en faire la commande à mon libraire.
Article # 23 – Pour une philothérapie balisée
Le développement personnel fourmille de personnes de tout acabit qui se sont improvisées conseillers, coachs, thérapeutes, conférenciers, essayistes, formateurs… et auxquelles s’ajoutent des praticiens issus des fausses sciences, notamment, divinatoires et occultes, des médecines et des thérapies alternatives. Bref, le développement personnel attire toute sorte de monde tirant dans toutes les directions.
Article # 24 – Comment nous pensons, John Dewey, Les empêcheurs de penser en rond / Seuil
Je n’aime pas cette traduction française du livre How we think de John Dewey. « Traduit de l’anglais (États-Unis) par Ovide Decroly », Comment nous pensons parait aux Éditions Les empêcheurs de penser en rond / Seuil en 2004. – Le principal point d’appui de mon aversion pour traduction française repose sur le fait que le mot anglais « belief » est traduit par « opinion », une faute majeure impardonnable dans un livre de philosophie, et ce, dès les premiers paragraphes du premier chapitre « Qu’entend-on par penser ? »
Article # 25 – Une philothérapie libre axée sur nos besoins et nos croyances avec Patrick Sorrel
Hier j’ai assisté la conférence Devenir philothérapeute : une conférence de Patrick Sorrel. J’ai beaucoup aimé le conférencier et ses propos. J’ai déjà critiqué l’offre de ce philothérapeute. À la suite de conférence d’hier, j’ai changé d’idée puisque je comprends la référence de Patrick Sorrel au «système de croyance». Il affirme que le «système de croyance» est une autre expression pour le «système de penser». Ce faisant, toute pensée est aussi une croyance.
Article # 26 – Une pratique philosophique sans cœur
J’éprouve un malaise face à la pratique philosophique ayant pour objectif de faire prendre conscience aux gens de leur ignorance, soit le but poursuivi par Socrate. Conduire un dialogue avec une personne avec l’intention inavouée de lui faire prendre conscience qu’elle est ignorante des choses de la vie et de sa vie repose sur un présupposé (Ce qui est supposé et non exposé dans un énoncé, Le Robert), celui à l’effet que la personne ne sait rien sur le sens des choses avant même de dialoguer avec elle. On peut aussi parler d’un préjugé philosophique.
Article # 27 – Êtes-vous prisonnier de vos opinions ?
Si votre opinion est faite et que vous n’êtes pas capable d’en déroger, vous êtes prisonnier de votre opinion. Si votre opinion est faite et que vous êtes ouvert à son évolution ou prêt à l’abandonner pour une autre, vous êtes prisonnier de l’opinion. Si votre opinion compte davantage en valeur et en vérité que les faits, vous êtes prisonnier de vos opinions. Si votre opinion est la seule manière d’exprimer vos connaissances, vous êtes prisonnier de vos opinions. Si vous pensez que l’opinion est le seul résultat de votre faculté de penser, vous êtes prisonnier de vos opinions. Si vous prenez vos opinion pour vraies, vous êtes prisonnier de vos opinions.
Article # 28 – La pratique philosophique – Une méthode contemporaine pour mettre la sagesse au service de votre bien-être, Jérôme Lecoq, Eyrolles, 2014
J’ai mis beaucoup de temps à me décider à lire « La pratique philosophique » de Jérôme Lecoq. L’auteur est un émule d’Oscar Brenifier, un autre praticien philosophe. J’ai vécu l’enfer lors de mes consultations philosophiques avec Oscar Brenifier. Ainsi toute association de près ou de loin avec Oscar Brenifier m’incite à la plus grande des prudences. Jérôme Lecoq souligne l’apport d’Oscar Brenifier dans les Remerciements en première page de son livre « La pratique philosophique ».
Article # 29 – Je sais parce que je connais
Quelle est la différence entre « savoir » et « connaissance » ? J’exprime cette différence dans l’expression « Je sais parce que je connais ». Ainsi, le savoir est fruit de la connaissance. Voici quatre explications en réponse à la question « Quelle est la différence entre savoir et connaissance ? ».
Article # 30 – Les styles interpersonnels selon Larry Wilson
J’ai décidé de publier les informations au sujet des styles interpersonnels selon Larry Wilson parce que je me soucie beaucoup de l’approche de la personne en consultation philosophique. Il m’apparaît important de déterminer, dès le début de la séance de philothérapie, le style interpersonnel de la personne. Il s’agit de respecter la personnalité de la personne plutôt que de la réprimer comme le font les praticiens socratiques dogmatiques. J’ai expérimenté la mise en œuvre de ces styles inter-personnels avec succès.
Article # 31 – La confiance en soi – Une philosophie, Charles Pépin, Allary Éditions, 2018
Le livre « La confiance en soi – Une philosophie » de Charles Pépin se lit avec une grande aisance. Le sujet, habituellement dévolue à la psychologie, nous propose une philosophie de la confiance. Sous entendu, la philosophie peut s’appliquer à tous les sujets concernant notre bien-être avec sa propre perspective.
Article # 32 – Les émotions en philothérapie
J’ai vécu une sévère répression de mes émotions lors deux consultations philosophiques personnelles animées par un philosophe praticien dogmatique de la méthode inventée par Socrate. J’ai témoigné de cette expérience dans deux de mes articles précédents dans ce dossier.
Article # 33 – Chanson « Le voyage » par Raôul Duguay, poète, chanteur, philosophe, peintre… bref, omnicréateur québécois
Vouloir savoir être au pouvoir de soi est l’ultime avoir / Le voyage / Il n’y a de repos que pour celui qui cherche / Il n’y a de repos que pour celui qui trouve / Tout est toujours à recommencer
Article # 34 – « Ah ! Là je comprends » ou quand la pensée se fait révélation
Que se passe-t-il dans notre système de pensée lorsque nous nous exclamons « Ah ! Là je comprends » ? Soit nous avons eu une pensée qui vient finalement nous permettre de comprendre quelque chose. Soit une personne vient de nous expliquer quelque chose d’une façon telle que nous la comprenons enfin. Dans le deux cas, il s’agit d’une révélation à la suite d’une explication.
Article # 35 – La lumière entre par les failles
Âgé de 15 ans, je réservais mes dimanches soirs à mes devoirs scolaires. Puis j’écoutais l’émission Par quatre chemins animée par Jacques Languirand diffusée à l’antenne de la radio de Radio-Canada de 20h00 à 22h00. L’un de ces dimanches, j’ai entendu monsieur Languirand dire à son micro : « La lumière entre par les failles».
Article # 36 – Les biais cognitifs et la philothérapie
Le succès d’une consultation philosophique (philothérapie) repose en partie sur la prise en compte des biais cognitifs, même si ces derniers relèvent avant tout de la psychologie (thérapie cognitive). Une application dogmatique du dialogue socratique passe outre les biais cognitifs, ce qui augmente les risques d’échec.
Article # 37 – L’impossible pleine conscience
Depuis mon adolescence, il y a plus de 50 ans, je pense qu’il est impossible à l’Homme d’avoir une conscience pleine et entière de soi et du monde parce qu’il ne la supporterait pas et mourrait sur le champ. Avoir une pleine conscience de tout ce qui se passe sur Terre et dans tout l’Univers conduirait à une surchauffe mortelle de notre corps. Il en va de même avec une pleine conscience de soi et de son corps.
Article # 38 – Verbalisation à outrance : «Je ne suis pas la poubelle de tes pensées instantanées.»
Le Dr Jean-Christophe Seznec, psychiatre français, a été interrogé par la journaliste Pascale Senk du quotidien Le Figaro au sujet de son livre Savoir se taire, savoir parler, coécrit avec Laurent Carouana et paru en 2017. Le titre de l’article a retenu mon attention : Psychologie: «il faut sortir de l’hystérie de la parole».
Article # 39 – Comment dialoguer de manière constructive ? par Julien Lecomte, Philosophie, médias et société
Reproduction de l’article « Comment dialoguer de manière constructive ? », un texte de Julien Lecomte publié sur son site web PHILOSOPHIE, MÉDIAS ET SOCIÉTÉ. https://www.philomedia.be/. Echanger sur des sujets de fond est une de mes passions. Cela fait plusieurs années que je m’interroge sur les moyens de faire progresser la connaissance, d’apprendre de nouvelles choses. Dans cet article, je reviens sur le cheminement qui m’anime depuis tout ce temps, pour ensuite donner des pistes sur les manières de le mettre en pratique concrètement.
Article # 40 – Le récit d’initiation en spirale
Dans le récit initiatique, il s’agit de partir du point A pour aller au point B afin que le lecteur ou l’auditeur chemine dans sa pensée vers une révélation permettant une meilleure compréhension de lui-même et/ou du monde. La référence à la spirale indique une progression dans le récit où l’on revient sur le même sujet en l’élargissant de plus en plus de façon à guider la pensée vers une nouvelle prise de conscience. Souvent, l’auteur commence son récit en abordant un sujet d’intérêt personnel (point A) pour évoluer vers son vis-à-vis universel (point B). L’auteur peut aussi se référer à un personnage dont il fait évoluer la pensée.
Article # 41 – La philothérapie – Un état des lieux par Serge-André Guay, Observatoire québécois de la philothérapie
Cet article présente un état des lieux de la philothérapie (consultation philosophique) en Europe et en Amérique du Nord. Après un bref historique, l’auteur se penche sur les pratiques et les débats en cours. Il analyse les différentes publications, conférences et offres de services des philosophes consultants.
Article # 42 – L’erreur de Descartes, Antonio Damasio, Odile Jacob, 1995
J’ai découvert le livre « L’erreur de Descartes » du neuropsychologue Antonio R. Damasio à la lecture d’un autre livre : L’intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. L’édition originale de ce livre est parue en 1995 en anglais et j’ai lu la traduction française à l’été 1998 parue un an auparavant chez Robert Laffont. Diplômé de l’université Harvard et docteur en psychologie clinique et développement personnel, puis journaliste au New York Times, où il suit particulièrement les sciences du comportement, Daniel Goleman nous informe dans son livre « L’intelligence émotionnel » au sujet de la découverte spectaculaire pour ne pas dire révolutionnaire de Antonio R. Damasio à l’effet que la raison a toujours besoin d’un coup des émotions pour prendre des décisions. Jusque-là, il était coutume de soutenir que les émotions perturbaient la raison, d’où l’idée de les contrôler.
Article # 43 – Éloge de la pratique philosophique, Sophie Geoffrion, Éditions Uppr, 2018
Ma lecture du livre ÉLOGE DE LA PRATIQUE PHILOSOPHIQUE de la philosophe praticienne SOPHIE GEOFFRION fut agréable et fort utile. Enfin, un ouvrage court ou concis (le texte occupe 65 des 96 pages du livre), très bien écrit, qui va droit au but. La clarté des explications nous implique dans la compréhension de la pratique philosophique. Bref, voilà un éloge bien réussi. Merci madame Geoffrion de me l’avoir fait parvenir.
Article # 44 – Consultation philosophique : s’attarder à l’opinion ou au système de pensée ?
Dans cet article, je m’interroge à savoir la consultation philosophique doit s’attarder à l’opinion ou au système pensée du client. OPINION – Le philosophe praticien cible l’opinion de son client en vue de démontrer l’ignorance sur laquelle elle repose et, par conséquent, l’absence de valeur de vérité qu’elle recèle. Cette pratique repose sur le « questionnement philosophique ».
Article # 45 – Sentir et savoir – Une nouvelle théorie de la conscience, Antonio Damasio, Éditions Odile Jacob
Dans son livre « Sentir et savoir », Antonio Damasio propose « Une nouvelle théorie de la conscience ». Il démontre que la conscience ne peut pas exister sans le corps. Il identifie dans le corps la capacité de sentir comme préalable à la conscience.
Article # 46 – Dépression et philosophie : Du mal du siècle au mal de ce siècle, Robert Redeker, Editions Pleins Feux, 2007
Un si petit livre, seulement 46 pages et en format réduit, mais tellement informatif. Une preuve de plus qu’il ne faut se fier aux apparences. Un livre signé ROBERT REDEKER, agrégé de philosophie originaire de la France, connaît fort bien le sujet en titre de son œuvre : DÉPRESSION ET PHILOSOPHIE.
Article # 47 – Savoir se taire, savoir parler, Dr Jean-Christophe Seznec et Laurent Carouana, InterÉditions, 2017
La plupart des intervenants en psychologie affirment des choses. Ils soutiennent «C’est comme ceci» ou «Vous êtes comme cela». Le lecteur a le choix de croire ou de ne pas croire ce que disent et écrivent les psychologues et psychiatres. Nous ne sommes pas invités à réfléchir, à remettre en cause les propos des professionnels de la psychologie, pour bâtir notre propre psychologie. Le lecteur peut se reconnaître ou pas dans ces affirmations, souvent catégoriques. Enfin, ces affirmations s’apparentent à des jugements. Le livre Savoir se taire, savoir dire de Jean-Christophe Seznec et Laurent Carouana ne fait pas exception.
Article # 48 – Penser sa vie – Une introduction à la philosophie, Fernando Savater, Éditions du Seuil, 2000
Chapitre 1 – La mort pour commencer – Contrairement au philosophe Fernando Savater dans PENSER SA VIE – UNE INTRODUCTION À LA PHILOSOPHIE, je ne définie pas la vie en relation avec la mort, avec son contraire. Je réfléchie et je parle souvent de la mort car il s’agit de l’un de mes sujets préféré depuis mon adolescence. Certaines personnes de mon entourage pensent et affirment que si je parle aussi souvent de la mort, c’est parce que j’ai peur de mourir. Or, je n’ai aucune peur de la mort, de ma mort, de celles de mes proches. Je m’inquiète plutôt des conséquences de la mort sur ceux et celles qui restent, y compris sur moi-même.
Article # 49 – Pourquoi avons-nous des couleurs de peau et des physiques si différents ?
À la lumière du documentaire LE SOLEIL ET DES HOMMES, notamment l’extrait vidéo ci-dessus, je ne crois plus au concept de race. Les différences physiques entre les hommes découlent de l’évolution naturelle et conséquente de nos lointains ancêtres sous l’influence du soleil et de la nature terrestre, et non pas du désir du soleil et de la nature de créer des races. On sait déjà que les races et le concept même de race furent inventés par l’homme en se basant sur nos différences physiques. J’abandonne donc la définition de « race » selon des critères morphologiques…
Article # 50 – Extrait du mémoire de maîtrise «Formation de l’esprit critique et société de consommation» par Stéphanie Déziel
Dans le cadre de notre dossier « Consulter un philosophe », la publication d’un extrait du mémoire de maîtrise « Formation de l’esprit critique et société de consommation » de Stéphanie Déziel s’impose en raison de sa pertinence. Ce mémoire nous aide à comprendre l’importance de l’esprit critique appliqué à la société de consommation dans laquelle évoluent, non seule les jeunes, mais l’ensemble de la population.
Article # 51 – « En fait, c’est dans son incertitude même que réside largement la valeur de la philosophie. » Bertrand Russell
Je reproduis ci-dessous une citation bien connue sur le web au sujet de « la valeur de la philosophie » tirée du livre « Problèmes de philosophie » signé par Bertrand Russell en 1912. Mathématicien, logicien, philosophe, épistémologue, homme politique et moraliste britannique, Bertrand Russell soutient que la valeur de la philosophie réside dans son incertitude. À la suite de cette citation, vous trouverez le texte de Caroline Vincent, professeur de philosophie et auteure du site web « Apprendre la philosophie » et celui de Gabriel Gay-Para tiré se son site web ggpphilo. Des informations tirées de l’Encyclopédie Wikipédia au sujet de Bertrand Russell et du livre « Problèmes de philosophie » et mon commentaire complètent cet article.
Article # 52 – Socrate et la formation de l’esprit critique par Stéphanie Déziel
Passez donc sans vous arrêter, amis, au milieu des Marchands de Sommeil; et, s’ils vous arrêtent, répondez-leur que vous ne cherchez ni un système ni un lit. Ne vous lassez pas d’examiner et de comprendre. (…) Lisez, écoutez, discutez, jugez; ne craignez pas d’ébranler des systèmes; marchez sur des ruines, restez enfants. (…) Socrate vous a paru un mauvais maître. Mais vous êtes revenus à lui; vous avez compris, en l’écoutant, que la pensée ne se mesure pas à l’aune, et que les conclusions ne sont pas l’important; restez éveillés, tel est le but. Les Marchands de Sommeil de ce temps-là tuèrent Socrate, mais Socrate n’est point mort; partout où des hommes libres discutent, Socrate vient s’asseoir, en souriant, le doigt sur la bouche. Socrate n’est point mort; Socrate n’est point vieux. (…) – Alain, (Emile Charrier), Vigiles de l’esprit.
Article # 53 – J’ai un problème avec la vérité
Tout au long de ma vie, j’ai vu la vérité malmenée, tassée d’un bord puis de l’autre, devenir une propriété personnelle (ma vérité — ta vérité — à chacun sa vérité), tantôt objet de monopôle, tantôt reconnue, tantôt niée et reniée… Ah ! La vérité. Quel chaos ! Je me demande depuis longtemps pourquoi la vérité, si elle existe, ne triomphe pas à tout coup, pourquoi elle ne s’impose à tous d’elle-même. Contestée de toutes parts, la vérité, si elle existe, n’a d’intérêt que pour l’opinion qu’on en a et les débats qui s’ensuivent. On va jusqu’à donner à la vérité une mauvaise réputation eu égard à son influence néfaste sur la société et les civilisations. Et que dire de toutes ces croyances qui se prennent pour la vérité ? Et c’est sans compter l’observation récente à l’effet que nous venons d’entrer dans une « ère de post-vérité ».
Article # 54 – Petit manuel philosophique à l’intention des grands émotifs, Iaria Gaspard, Presses Universitaires de France, 2022
J’accorde à ce livre trois étoiles sur cinq. Le titre « Petit manuel philosophique à l’intention des grands émotifs » a attiré mon attention. Et ce passage du texte en quatrième de couverture m’a séduit : «En proposant une voyage philosophique à travers l’histoire des émotions, Iaria Gaspari bouscule les préjugés sur notre vie émotionnelle et nous invite à ne plus percevoir nos d’états d’âme comme des contrainte ». J’ai décidé de commander et de lire ce livre. Les premières pages m’ont déçu. Et les suivantes aussi. Rendu à la moitié du livre, je me suis rendu à l’évidence qu’il s’agissait d’un témoignage de l’auteure, un témoignage très personnelle de ses propres difficultés avec ses émotions. Je ne m’y attendais pas, d’où ma déception. Je rien contre de tels témoignages personnels qu’ils mettent en cause la philosophie, la psychologie, la religion ou d’autres disciplines. Cependant, je préfère et de loin lorsque l’auteur demeure dans une position d’observateur alors que son analyse se veut la plus objective possible.
Article # 55 – Savoir, connaissance, opinion, croyance
Tout repose sur le Savoir. L’expérience personnelle et/ou professionnelle qu’on fait du Savoir, après en avoir pris conscience, se retrouve à la base des Connaissances que nous possédons. Les Opinions expriment des Jugements des connaissances et inspirent souvent les Croyances.
Article # 56 – Philosophie, science, savoir, connaissance
La philosophie, mère de toutes les sciences, recherche la sagesse et se définie comme l’Amour de la Sagesse. La sagesse peut être atteinte par la pensée critique et s’adopte comme Mode de vie. • La philosophie soutient la Science et contribue à la naissance et au développement de la méthode scientifique, notamment avec l’épistémologie.
Article # 57 – La philosophie encore et toujours prisonnière de son passé ?
La philothérapie, principale pratique de la philosophie de nos jours, met sans cesse de l’avant les philosophes de l’Antiquité et de l’époque Moderne. S’il faut reconnaître l’apport exceptionnel de ces philosophes, j’ai parfois l’impression que la philothérapie est prisonnière du passé de la philosophie, à l’instar de la philosophie elle-même.
Article # 58 – Le Québec, un désert philosophique
Au Québec, la seule province canadienne à majorité francophone, il n’y a pas de tradition philosophique populaire. La philosophie demeure dans sa tour universitaire. Très rares sont les interventions des philosophes québécois dans l’espace public, y compris dans les médias, contrairement, par exemple, à la France. Et plus rares encore sont les bouquins québécois de philosophie en tête des ventes chez nos libraires. Seuls des livres de philosophes étrangers connaissent un certain succès. Bref, l’espace public québécois n’offre pas une terre fertile à la Philosophie.
Article # 59 – La naissance du savoir – Dans la tête des grands scientifiques, Nicolas Martin, Éditions Les Arènes, 2023.
J’accorde à ce livre cinq étoiles sur cinq parce qu’il me permet d’en apprendre beaucoup plus sur la pensée scientifique telle que pratiquée par de grands scientifiques. L’auteur, Nicolas Martin, propose une œuvre originale en adressant les mêmes questions, à quelques variantes près, à 17 grands scientifiques.
Article # 60 – Pourquoi est-il impossible d’atteindre l’équilibre entre développement personnel et développement spirituel ou philosophique ?
Cet article répond à ce commentaire lu sur LinkedIn : « L’équilibre entre développement personnel et développement spirituel ou philosophique est indispensable. » Il m’apparaît impossible de viser « L’équilibre entre développement personnel et développement spirituel ou philosophique » et de prétendre que cet équilibre entre les trois disciplines soit « indispensable ». D’une part, le développement personnel est devenu un véritable fourre-tout où l’ivraie et le bon grain se mélangent sans distinction, chacun avançant sa recette à l’aveugle.
Article # 61 – Le commerce extrême de la philosophie avec les « philopreneurs »
En ne s’unissant pas au sein d’une association nationale professionnelle fixant des normes et des standards à l’instar des philosophes consultants ou praticiens en d’autres pays, ceux de la France nous laissent croire qu’ils n’accordent pas à leur disciple tout l’intérêt supérieur qu’elle mérite. Si chacun des philosophes consultants ou praticiens français continuent de s’affairer chacun dans son coin, ils verront leur discipline vite récupérée à mauvais escient par les philopreneurs et la masse des coachs.
D’AUTRES ARTICLES SONT À VENIR