J’ai lu pour vous
Sur cette page : un référencement du livre, des extraits de l’œuvre, une revue de presse, une présentation de l’auteur, des livres de l’auteur à télécharger gratuitement… Et MON RAPPORT DE LECTURE.
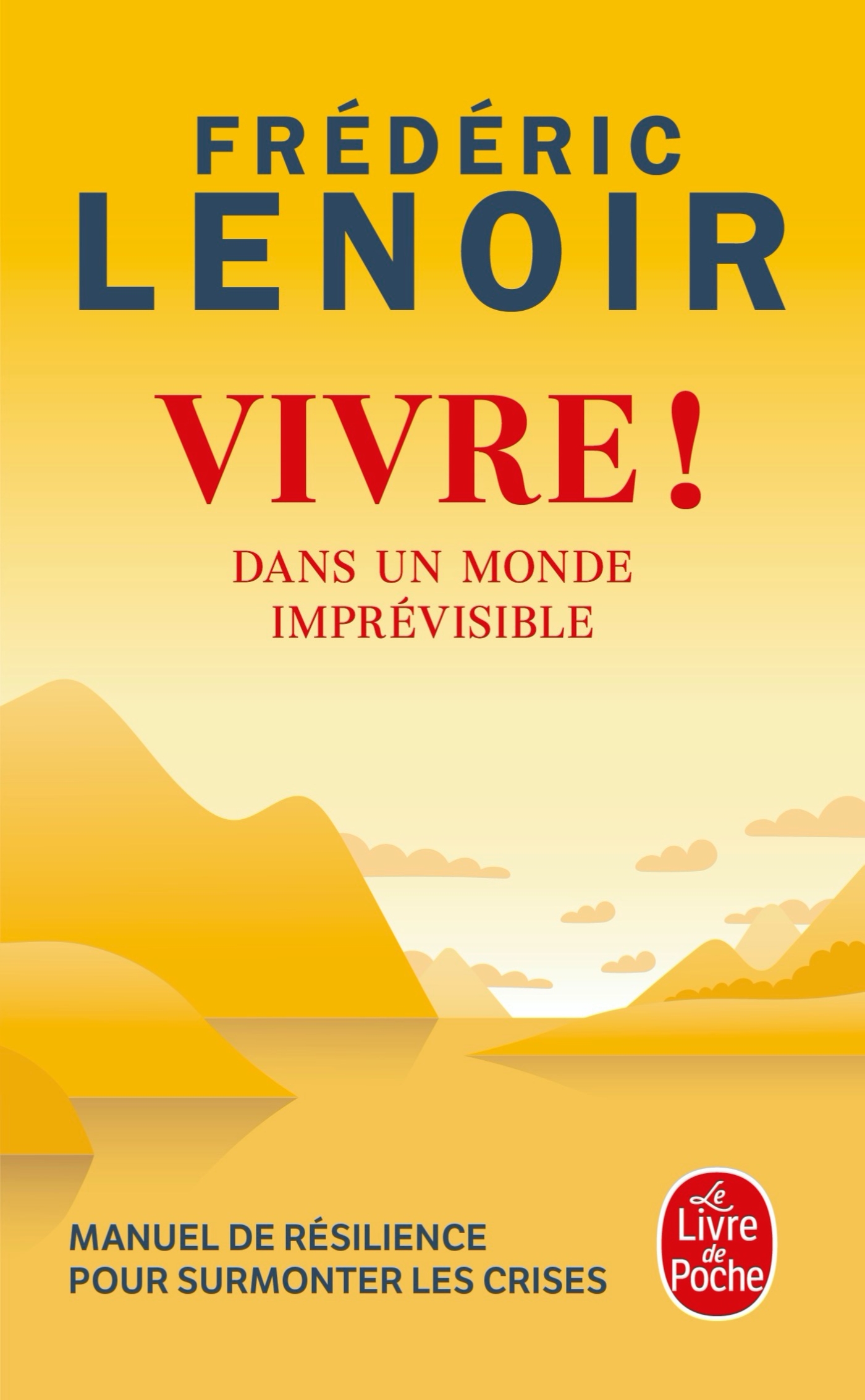
Frédéric Lenoir
Vivres ! dans un monde imprévisible
Manuel de résilience pour surmonter les crises
Éditions Fayard
Commander via le site de FAYARD
Commander via le site du Livre de Poche
Commander via le site Les Libraires (Canada)
Date de sortie : 02 août 2021
Langue : Français
Éditeur : LE LIVRE DE POCHE
Collections : Le Livre de poche. Documents
Catégories : Essais / Sciences sociales
Nombre de pages : 137 pages
Composition Contient un seul article
Support : Livre imprimé à couverture souple
Format : Livre de poche
Mesure : 18.0 cm (Hauteur), 11 cm (Largeur), 92 gr (Poids)
Couverture : Hokus Pokus
ISBN : 97-8-221-371923-8
EAN : 9782253104643
Fayard, 17 juin 2020 – 144 pages – EAN : 9782213717609 – EAN (numérique) : 9782213719238
Le Livre de Poche, 2 juin 2021 – 144 pages – EAN : 9782253104643
QUATRIÈME DE COUVERTURE
Il a suffi d’un virus lointain pour que le cours de nos vies soit bouleversé. « Vivre, ce n’est pas attendre que l’orage passe, c’est apprendre à danser sous la pluie », disaient les Anciens. Je suis convaincu que plus rien ne sera comme avant et qu’il nous faut apprendre à développer nos ressources intérieures pour vivre le mieux possible dans un monde imprévisible.
F. L.
Pour traverser ces temps difficiles, cet ouvrage optimiste nous invite à revenir à l’essentiel, à entretenir la joie et la sérénité malgré l’adversité. Frédéric Lenoir nous y montre comment les grands philosophes du passé, mais aussi les neurosciences et la psychologie des profondeurs, peuvent nous y aider, et pourquoi cette crise est une occasion de changer notre regard, nos comportements, de devenir davantage nous-mêmes, de mieux nous relier aux autres et au monde.
Frédéric Lenoir nous donne les clés du bonheur (presque) retrouvé.
Le Parisien Week-end.
Son livre invite à grandir.
Nice Matin.
Frédéric Lenoir est philosophe, sociologue et écrivain. Il est l’auteur de nombreux essais et romans vendus à plus de 7 millions d’exemplaires dans le monde.
Source : Éditions Fayard.
TABLE DES MATIÈRES
Avant-propos
1. Se sentir en sécurité
2. Entrer en résilience
3. S’adapter
4. Cultiver le plaisir et les émotions positives
5. Ralentir et savourer l’instant
6. Resserrer les liens
7. Donner du sens
8. Devenir libres
9. Apprivoiser la mort
10. Agir et consentir
Notes
EXTRAIT DU LIVRE AUDIO
EXTRAIT DU TEXTE DU LIVRE
Avant-propos
Qui aurait pu imaginer au début de l’année 2020 que, deux mois plus tard, la moitié de la population mondiale serait confinée, qu’il n’y aurait plus d’avions dans le ciel, plus de touristes à Venise et qu’on vivrait une récession économique mondiale historique ? La pandémie du Covid-19, qui n’est pourtant pas la plus grave que l’humanité ait connue, révèle l’extrême vulnérabilité du monde globalisé. Lorsque la peste noire a décimé plus du tiers des Européens (soit environ 25 millions de personnes) au milieu du XIVe siècle, les Chinois ou les Indiens n’étaient pas concernés, et ils n’en étaient sans doute même pas informés. Pour le meilleur et pour le pire, nous sommes aujourd’hui tous connectés, et un simple virus, surgi dans n’importe quel coin du globe, peut mettre l’économie mondiale à terre et impacter la vie de près de 8 milliards d’individus. Car ce sont bien toutes les dimensions de notre existence qui sont bouleversées par cette pandémie : notre vie familiale et professionnelle, comme notre rapport au monde, à l’espace et au temps. Nous sommes touchés ou angoissés – pour nous-même et pour nos proches – par la maladie et par la mort. Mais aussi par l’insécurité matérielle, par la perte de notre liberté de circuler, par l’impossibilité de nous projeter dans l’avenir.
Face à de tels bouleversements, nous pouvons serrer les dents et espérer que tout redevienne comme avant le plus rapidement possible. Cela me semble illusoire. Non seulement parce qu’on ne peut sortir d’un tel chaos en quelques mois, mais surtout parce que les causes profondes qui ont conduit à cette situation vont perdurer après la fin de la pandémie du Covid-19. Comme je l’ai déjà longuement expliqué en 2012 dans mon ouvrage La Guérison du monde, la crise contemporaine est systémique : toutes les crises que nous vivons dans notre monde globalisé – économique, sanitaire, écologique, migratoire, sociale, etc. – sont reliées entre elles par une même logique consumériste et de maximisation des profits, dans le contexte d’une mondialisation dérégulée. La pression exercée sur la planète et sur les sociétés humaines est intenable à long terme. Si nous cherchons à repartir « comme avant », nous irons de crise économique en crise économique, de crise écologique en crise écologique, de crise sociale en crise sociale et de crise sanitaire en crise sanitaire. La vraie solution consiste à changer de logique, à sortir de la frénésie consumériste, à relocaliser des pans entiers des activités économiques, à réguler la finance, à passer du « toujours plus » au mieux-être, de la compétition à la collaboration.
Ces grandes questions, capitales pour l’avenir de l’humanité et de la planète, font l’objet d’un autre livre auquel je travaille depuis plus d’un an avec Nicolas Hulot (qui sera vraisemblablement publié au second semestre 2020). Pour l’instant, la question que je souhaite aborder dans ce petit ouvrage est tout autre : comment vivre le mieux possible en temps de crise ? En attendant l’hypothétique changement de paradigme auquel nous sommes de plus en plus nombreux à aspirer, quelle solution intérieure pouvons-nous trouver pour faire face à la crise sanitaire, aux bouleversements de nos modes de vie et aux angoisses qui en découlent ? Comment essayer de rester serein, voire heureux, dans un monde de plus en plus chaotique et imprévisible ? Ou, pour le dire encore autrement : en attendant que le monde change, comment nous changer nous-mêmes ou transformer notre regard pour nous adapter le plus positivement possible à un réel qui nous déstabilise ?
J’ai donc conçu ce livre comme un manuel de survie et de croissance intérieure, c’est-à-dire un manuel de résilience, en apportant aux lecteurs des conseils pour vivre mieux en cette période douloureuse et déstabilisante à bien des égards. Je me suis beaucoup inspiré de philosophes du passé – comme les stoïciens, Montaigne ou Spinoza – qui ont vécu et pensé pendant des périodes de crise profonde et qui nous apportent des réflexions essentielles pour traverser au mieux l’adversité. Mais je m’inspire aussi de considérations plus contemporaines, issues notamment des neurosciences et de la psychologie, qui nous offrent des clés précieuses pour faire face aux perturbations de nos besoins biologiques, psychiques et affectifs fondamentaux.
Puisse ce petit livre, écrit dans l’urgence du temps présent, apporter durablement lumière et réconfort à tous ceux qui le liront.
1 – SE SENTIR EN SÉCURITÉ
CHAPITRE 1
Au moment où je commençais l’écriture de ce livre, j’ai eu un échange téléphonique avec une amie canadienne très chère, maître en yoga et en qi gong : Nicole Bordeleau. Elle m’a demandé quel était, selon moi, notre besoin le plus fondamental : celui du lien ou celui de la sécurité ? Je lui ai répondu sans hésiter : celui de la sécurité. Le lien est capital, et même vital, parce que, justement, il nous apporte avant tout ce dont nous avons le plus besoin : la sécurité, tant intérieure (psychique) que matérielle et sociale.
Pour mieux le comprendre, évoquons deux grandes théories : celle du conatus, du philosophe néerlandais Baruch Spinoza, et celle de la pyramide des besoins, du psychologue Abraham Maslow. Au XVIIe siècle, dans son ouvrage majeur, L’Éthique, Spinoza affirme que « chaque chose, selon sa puissance d’être, s’efforce de persévérer dans son être ». Cet effort (conatus en latin) est une loi universelle de la vie, comme le confirme le célèbre neurologue portugais Antonio Damasio, fervent disciple de Spinoza : « L’organisme vivant est construit de telle sorte qu’il préserve la cohérence de ses structures et de ses fonctions contre les nombreux aléas de la vie1. » Spinoza constate ensuite que, de manière tout aussi naturelle, chaque organisme vivant essaye de progresser, de grandir, de parvenir à une plus grande perfection. Il observe enfin que, chaque fois qu’il y parvient, sa puissance vitale augmente, il est habité par un sentiment de joie, alors que chaque fois qu’il rencontre un obstacle, qu’il se sent menacé dans son être ou que sa puissance vitale diminue, il est envahi par un sentiment de tristesse. Toute l’éthique spinoziste consiste dès lors à organiser notre vie grâce à la raison, pour préserver l’intégrité de notre être et augmenter notre puissance d’agir et la joie qui l’accompagne. Spinoza met au jour deux mécanismes de la vie : se préserver et augmenter sa puissance vitale et d’action. Dit autrement, il nous explique que la sécurité et la croissance sont nos deux besoins les plus fondamentaux.
Entre 1943 et 1970, le psychologue américain Abraham Maslow a élaboré et affiné une théorie de la motivation qui s’incarne dans une hiérarchisation universelle des besoins humains, et qui n’est pas sans lien avec la théorie spinoziste. À la base de la pyramide, on trouve d’abord nos besoins physiologiques élémentaires : respirer, boire, se nourrir, dormir, éliminer… Surgissent ensuite les besoins de sécurité : être en bonne santé et vivre dans un environnement stable et prévisible. Puis viennent les besoins d’appartenance et d’amour. Apparaissent enfin les besoins d’estime et de reconnaissance et, tout en haut de la pyramide, le besoin d’accomplissement de soi. L’idée développée par Maslow, fort bien illustrée par la forme pyramidale, est qu’une nouvelle motivation survient lorsque qu’un besoin plus fondamental est satisfait : je ne chercherai à m’accomplir que lorsque tous mes autres besoins auront été pris en compte.
Autant la typologie des besoins élaborée par Maslow me semble pertinente, autant leur hiérarchisation peut prêter le flanc à la critique. De nombreux auteurs ont constaté que certains besoins, comme l’appartenance ou la reconnaissance, étaient tout aussi fondamentaux pour vivre que les besoins physiologiques ou de sécurité. On sait par exemple qu’un bébé qui ne reçoit pas d’amour sera incapable de se développer psychiquement de manière harmonieuse, voire de survivre. On peut constater aussi que certaines personnes mettent tout en œuvre pour satisfaire un besoin de reconnaissance, alors que leurs besoins primaires ne sont pas pleinement satisfaits : un ado d’une famille pauvre préférera parfois avoir le même smartphone ou les mêmes baskets hors de prix que ses copains plutôt que bien s’alimenter ou vivre sous un toit décent. De même, le besoin de s’accomplir, qui inclut la dimension spirituelle et la foi, peut s’exprimer chez ceux dont les autres besoins n’ont pas été pleinement satisfaits. J’ai rencontré aux quatre coins du monde des gens très pauvres habités par une foi intense qui les aidait justement à supporter leur condition misérable.
Il ne faut donc pas faire un absolu de la hiérarchisation des besoins de Maslow. Néanmoins, on peut constater qu’en période de crise profonde, à l’instar de celle que nous vivons actuellement, elle semble retrouver une certaine pertinence. La survie est brutalement redevenue la principale motivation des humains. On l’a vu dès les premiers signes de la propagation du virus : les magasins d’alimentation ont été dévalisés. J’ai croisé au supermarché, en bas de chez moi, des personnes qui avaient un Caddy rempli à ras-bord de pâtes, d’eau minérale, de farine et de papier hygiénique, et qui se moquaient des sarcasmes ou des critiques d’autres clients. Le premier réflexe dans un contexte de survie, c’est de s’assurer que nos besoins physiologiques pourront être satisfaits, et peu importe qu’on apparaisse comme égoïste ou ridicule. En cas de crise majeure, les besoins primaires passent avant tout, et les besoins de sécurité viendront juste après : une fois le frigo plein, on se confine chez soi pour échapper à la contamination. Et ce n’est qu’une fois en sécurité qu’on pourra laisser s’exprimer notre besoin d’appartenance, en appelant nos proches et nos amis, en resserrant – dans une distance protectrice – nos liens affectifs et sociaux. Les besoins de reconnaissance et d’accomplissement viendront ensuite, lorsque tous les autres auront été satisfaits.
Dans le monde occidental relativement stable et opulent dans lequel nous vivons depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la plupart d’entre nous avions échappé à la peur de ne plus pouvoir satisfaire nos besoins vitaux et de sécurité les plus fondamentaux. On pourrait d’ailleurs regrouper les trois premiers besoins et motivations (physiologique, sécurité, appartenance) dans une même catégorie : celle de la sécurité. Tandis que les deux suivants (reconnaissance, accomplissement) relèveraient d’un autre ordre : celui de notre croissance (dans la société, mais aussi spirituel). Les trois premiers sont indispensables à la survie. Les deux suivants permettent le déploiement de la vie, tant sur le plan social que personnel. Nous retrouvons dès lors les deux grands besoins démontrés par Spinoza : se préserver (sécurité) et croître. Et on peut globalement affirmer que lorsque nos besoins de sécurité sont satisfaits on peut davantage se concentrer sur nos besoins de croissance, lesquels nous apportent les joies les plus profondes : joie de l’amour qui s’épanouit, de nos réalisations professionnelles qui nous permettent de nous accomplir et d’être reconnus, joies créatives, intellectuelles et spirituelles de notre esprit qui progresse, etc. Mais lorsque nous ressentons un profond sentiment d’insécurité, le besoin de protection l’emporte sur le besoin de croissance, et la recherche de la sérénité, de l’apaisement émotionnel, sur celui de la joie.
Il existe cependant une interaction importante entre la base et le sommet de la pyramide, entre notre besoin de sécurité (à travers ses diverses dimensions) et notre dimension spirituelle : la force de notre esprit peut nous aider à renforcer notre sentiment de sécurité ou, plus précisément, à mieux vivre en temps d’insécurité. Je l’ai déjà évoqué à propos de la foi religieuse, qui aide de nombreuses personnes démunies à mieux vivre, voire à être joyeuses. Il en va de même aujourd’hui en Occident pour des personnes qui ont une foi profonde, mais aussi pour des personnes non croyantes qui ont développé leur potentiel humain ou une forme de spiritualité laïque. Ceux qui cultivent leur esprit en lisant des livres de philosophie ou de poésie, ceux qui pratiquent régulièrement le yoga ou la méditation, ceux qui ont une activité créatrice, ceux qui développent l’amour et la compassion en s’engageant dans la société, ceux qui cherchent à donner un sens à leur existence sont sans doute mieux armés pour traverser les périodes difficiles de la vie. En effet, ils déploient des qualités spirituelles qui viennent soutenir le corps et stabiliser les émotions (notamment la peur), améliorer la qualité des liens affectifs et sociaux, renforcer la confiance et l’amour de la vie. Autant de qualités précieuses qui favorisent, après un choc ou une déstabilisation profonde comme celle que nous venons de vivre, la possibilité d’un rebond, d’un travail sur soi, d’une entrée en résilience.
____________
NOTE
1 Antonio Damasio, Spinoza avait raison. Joie et tristesse. Le cerveau des émotions, Paris, Odile Jacob, 2013, p. 40.
Source : © 2020 Librairie Arthème Fayard, 2020.
Note : Cet extrait est disponible sur le site web LESLIBRAIRES.CA.
REVUE DE PRESSE
THÈSES
La théorie du génie selon Arthur Schopenhauer par Nathanaël Gilbert
AU SUJET DE L’AUTEUR
 https://www.fredericlenoir.com/
https://www.fredericlenoir.com/
Philosophe et sociologue. Docteur de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS).
Ecrivain. Auteur d’une cinquantaine d’ouvrages (essais, romans, contes, encyclopédies), traduits dans une vingtaine de langues et vendus à dix millions d’exemplaires dans le monde, il écrit aussi pour le théâtre, la télévision (documentaires) et la bande dessinée.
En 2016, il crée l’association Ensemble pour les Animaux et en 2017, il cofonde la Fondation et l’association SEVE, Savoir Être et Vivre Ensemble (sous l’égide de la Fondation de France).
En novembre 2024, il fonde La Maison des sagesses afin de diffuser une connaissance philosophique au sens d’un art de vivre, tel que les Grecs l’entendaient.
Il partage sa vie entre sa résidence principale en Haute-Savoie, la Corse, Paris et le reste du monde où il fait de nombreux séminaires et conférences.
Menu du site web
BIOGRAPHIES — LIVRES — PODCASTS — VIDEOS — ENGAGEMENTS — CONTACT
SOURCE
Site web officiel de l’auteur
* * *
* * *

DU MÊME AUTEUR
(Ouvrages disponibles)
ESSAIS ET DOCUMENTS
Méditer à cœur ouvert, Robert Laffont, 2018, Pocket, 2019.
La Sagesse expliquée à ceux qui la cherchent, Seuil, 2018.
Le Miracle Spinoza, Fayard, 2017, Le Livre de Poche, 2019.
Lettre ouverte aux animaux (et à ceux qui les aiment), Fayard, 2017.
Philosopher et méditer avec les enfants, Albin Michel, 2016.
La Puissance de la joie, Fayard, 2015.
François, le printemps de l’Évangile, Fayard, 2014, Le Livre de Poche, 2015.
Du Bonheur, un voyage philosophique, Fayard, 2013, Le Livre de Poche, 2015.
La Guérison du monde, Fayard, 2012, Le Livre de Poche, 2014.
Petit traité de vie intérieure, Plon, 2010 ; Pocket, 2012.
Comment Jésus est devenu Dieu, Fayard, 2010 ; Le Livre de Poche, 2012.
La Saga des francs-maçons, avec Marie-France Etchegoin, Robert Laffont, 2009 ; Points, 2010.
Socrate, Jésus, Bouddha, Fayard, 2009 ; Le Livre de Poche, 2011.
Petit traité d’histoire des religions, Plon, 2008 ; Points, 2011.
Tibet, 20 clés pour comprendre, Plon, 2008, Prix « Livres et droits de l’homme » de la ville de Nancy ; Points, 2010.
Le Christ philosophe, Plon, 2007 ; Points, 2009.
Code Da Vinci, l’enquête, avec Marie-France Etchegoin, Robert Laffont, 2004 ; Points, 2006.
Les Métamorphoses de Dieu, Plon, 2003, Prix européen des écrivains de langue française 2004 ; Plon, « L’Abeille » 2019.
L’Épopée des Tibétains, avec Laurent Deshayes, Fayard, 2002.
La Rencontre du bouddhisme et de l’Occident, Fayard, 1999 ; Albin Michel, « Spiritualités vivantes », 2001 et 2012.
Le Bouddhisme en France, Fayard, 1999.
FICTION
La Consolation de l’ange, roman, Albin Michel, 2019.
Cœur de cristal, conte, Robert Laffont, 2014 ; Pocket, 2016.
Nina, avec Simonetta Greggio, roman, Stock, 2013, Le Livre de Poche, 2014.
L’Âme du monde, conte de sagesse, NiL, 2012 ; version illustrée par Alexis Chabert, NiL, 2013, Pocket, 2014.
La Parole perdue, avec Violette Cabesos, roman, Albin Michel, 2011 ; Le Livre de Poche, 2012.
Bonté divine !, avec Louis-Michel Colla, théâtre, Albin Michel, 2009.
L’Oracle della Luna, roman, Albin Michel, 2006 ; Le Livre de Poche, 2008.
La Promesse de l’ange, avec Violette Cabesos, roman, Albin Michel, 2004, Prix des Maisons de la Presse 2004 ; Le Livre de Poche, 2006.
Le Secret, fable, Albin Michel, 2001 ; Le Livre de Poche, 2003.
ENTRETIENS
Oser l’émerveillement, avec Leili Anvar, Albin Michel, 2016.
Sagesse pour notre temps, avec Leili Anvar, Albin Michel, 2016.
Dieu, Entretiens avec Marie Drucker, Robert Laffont, 2011 ; Pocket, 2013.
Mon Dieu… Pourquoi ?, avec l’abbé Pierre, Plon, 2005.
Mal de Terre, avec Hubert Reeves, Seuil, 2003 ; Points, 2005.
Le Moine et le Lama, avec Dom Robert Le Gall et Lama Jigmé Rinpoché, Fayard, 2001 ; Le Livre de Poche, 2003.
Sommes-nous seuls dans l’univers ?, avec J. Heidmann, A. Vidal-Madjar, N. Prantzos et H. Reeves, Fayard, 2000 ; Le Livre de Poche, 2002.
Entretiens sur la fin des temps, avec Jean-Claude Carrière, Jean Delumeau, Umberto Eco, Stephen Jay Gould, Fayard, 1998 ; Pocket, 1999.
Le Temps de la responsabilité. Entretiens sur l’éthique, postface de Paul Ricœur, Fayard, 1991 ; nouvelle édition, Pluriel, 2013.
DIRECTION D’OUVRAGES ENCYCLOPÉDIQUES
La Mort et l’immortalité. Encyclopédie des croyances et des savoirs, avec Jean-Philippe de Tonnac, Bayard, 2004.
Le Livre des sagesses, avec Ysé Tardan-Masquelier, Bayard, 2002 et 2005 (poche).
Encyclopédie des religions, avec Ysé Tardan-Masquelier, 2 volumes, Bayard, 1997 et 2000 (poche).

MON RAPPORT DE LECTURE
Frédéric Lenoir
Vivre ! dans un monde imprévisible
Fayard, 17 juin 2020 – 144 pages – EAN : 9782213717609 – EAN (numérique) : 9782213719238
Le Livre de Poche, 2 juin 2021 – 144 pages – EAN : 9782253104643
J’ai longtemps résisté à l’achat des livres de Frédéric Lenoir car je craignais de tomber dans le développement personnel avec tous ses travers largement dénoncés dans mes rapports de lecture. Sur un coup de tête, avec l’achat de plusieurs livres de philosophie, j’ai glissé dans ma pile un titre de Frédéric Lenoir : « Vivres ! dans un monde imprévisible (édition mise à jour – Le Livre de Poche, 2021). Ma lecture de ce livre confirme crainte : nous sommes bel et bien dans un manuel de développement personnel plutôt qu’un livre de philosophie. Dès qu’un auteur se dit philosophe et d’une autre profession, on peut être certain de la contamination de la première par cette dernière. De plus, Frédéric Lenoir se réfère non seulement aux « grands philosophes du passé, mais aussi les neurosciences et la psychologie des profondeurs (…) ». La mention de la psychologie par un philosophe éveille en moi de forts mécanismes de défense. Il faut lire ma « Mise en garde contre le copinage entre la philosophie et la psychologie » pour comprendre ma réticence. Quand aux neurosciences, je m’en méfie tout autant depuis ma lecture du livre « Neuromania – Le vrai du faux sur votre cerveau » d’Albert Moukheiber, Docteur en neurosciences cognitives et psychologue clinicien, paru chez Allary Éditions en 2024 (voir mon rapport de lecture). Bref, j’ai lu ce livre les deux pieds sur les freins.
Pour traverser ces temps difficiles, cet ouvrage optimiste nous invite à revenir à l’essentiel, à entretenir la joie et la sérénité malgré l’adversité. Frédéric Lenoir nous y montre comment les grands philosophes du passé, mais aussi les neurosciences et la psychologie des profondeurs, peuvent nous y aider, et pourquoi cette crise est une occasion de changer notre regard, nos comportements, de devenir davantage nous-mêmes, de mieux nous relier aux autres et au monde.
LENOIR, Frédéric, Vivre ! dans un monde imprévisible – Manuel de résilience pour surmonter les crises, Quatrième de couverture, Le Livre de Poche, 2 juin 2021.
Frédéric Lenoir accorde l’épigraphe de son livre à Carl Gustav Jung, psychanalyste et psychiatre, fondateur de la psychologie analytique, plutôt qu’à un philosophe.
« Les crises, les bouleversements, la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d’indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. »
Carl Gustav Jung
LENOIR, Frédéric, Vivre ! dans un monde imprévisible – Manuel de résilience pour surmonter les crises, Épigraphe, Le Livre de Poche, 2 juin 2021.
Personnellement et par défaut professionnel, je vérifie toujours les sources des citations mais celle-ci de Carl Gustav Jung n’est nulle part. En désespoir de cause, j’ai même demandé à l’intelligence artificielle Microsoft Copilot et Gemini Google :
Quelle est l’origine de la citation suivante : « Les crises, les bouleversements, la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d’indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. » de Carl Gustav Jung
La citation que vous avez mentionnée est couramment attribuée à Carl Gustav Jung, le célèbre psychiatre suisse et fondateur de la psychologie analytique. Cependant, il semble qu’il n’existe pas de source écrite ou d’œuvre précise de Jung qui contienne cette citation exacte. Il est possible que cette phrase soit une interprétation ou une paraphrase des idées de Jung, qui accordait une grande importance à la signification des crises et des bouleversements dans le développement psychologique de l’individu. Si vous souhaitez en savoir plus sur la pensée de Jung, je vous recommande de lire ses œuvres, telles que « L’Homme à la découverte de son âme » et « Les Racines de la Conscience ».
Microsoft Copilot
Quelle est l’origine de la citation suivante : «Les crises, les bouleversements, la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d’indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. » de Carl Gustav Jung
Il est important de noter que l’attribution exacte de certaines citations à Carl Gustav Jung peut parfois être sujette à interprétation. Cependant, l’idée générale exprimée dans la citation que vous avez fournie est tout à fait cohérente avec la pensée de Jung. Voici ce que nous pouvons dire à ce sujet :
La philosophie de Jung :Carl Gustav Jung, fondateur de la psychologie analytique, croyait profondément que les expériences de vie, y compris les crises et les maladies, avaient un sens et un but.
Il considérait que ces expériences pouvaient servir de catalyseurs pour la croissance personnelle et l’individuation, un processus de réalisation de soi.
Jung mettait l’accent sur l’importance de l’inconscient et de la recherche de sens dans la vie. Il pensait que les difficultés rencontrées pouvaient être des signaux de l’inconscient, nous invitant à explorer des aspects de nous-mêmes que nous avions négligés.
Les concepts clés de Jung :Le concept d’« individuation » est central dans la pensée de Jung. Il s’agit d’un processus de développement psychologique qui implique l’intégration des aspects conscients et inconscients de la personnalité.
Les crises et les bouleversements peuvent être vus comme des étapes nécessaires sur le chemin de l’individuation.
La maladie comme expérience précieuse. Jung a lui même expérimenté la maladie et en a tiré des expériences précieuses.
Il a notamment partagé des réflexions très profondes lors de sa maladie en 1944.
En résumé, bien que la formulation exacte de la citation puisse varier, l’idée qu’elle véhicule est profondément enracinée dans la psychologie jungienne.
Cela ne répond pas à ma question. Je cherche l’origine.
Vous avez raison de souligner que l’origine précise de cette citation est difficile à établir avec certitude. Bien qu’elle soit largement attribuée à Carl Gustav Jung, il est fréquent que des citations soient reformulées ou interprétées au fil du temps.
Voici ce que l’on peut dire à ce sujet :
La pensée jungienne comme source d’inspiration :Les concepts développés par Jung, notamment l’individuation, l’importance des symboles et la signification des expériences de vie, sont au cœur de cette citation.
Jung considérait que les crises et les maladies pouvaient être des manifestations de l’inconscient, nous invitant à prendre conscience de certains aspects de nous-mêmes.
Cette idée est très présente dans son œuvre, où il explore la relation entre le corps et l’esprit, ainsi que la dimension symbolique des maladies.
La diffusion de la citation :La citation a probablement été diffusée et popularisée à travers des ouvrages de vulgarisation de la psychologie jungienne, des conférences et des articles.
Il est possible qu’elle ait été reformulée ou adaptée au fil du temps, ce qui rend difficile son identification exacte dans les écrits originaux de Jung.
De nombreux site internet ou blog reprennent cette citation, mais sans indiquer sa source précise.
En résumé, bien que l’on puisse affirmer que l’esprit de cette citation est profondément jungien, il est difficile de retrouver sa formulation exacte dans ses écrits.
Gemini, Google
Citer Carl Gustav Jung sans en donner la source exacte aux lecteurs
atténue la crédibilité de l’auteur.
( Je poursuis mes recherches pour trouver l’origine de cette citation)
Bonjour,
Nous venons de publier un article Sur l’utilisation des citations de Carl Gustav Jung et nous déplorons comme vous que la plupart des citations ne sont pas sourcées. C’est un fléau sur internet, et si vous nous posez cette question c’est que vous n’avez pas trouvé l’information. Possiblement elle est tirée d’une phrase voisine, voire une paraphrase. En l’absence de source, prudence donc.
Bien à vous.
Jean-Pierre ROBERT
Espace Francophone Jungien cgjung.net
Bonjour,
Je suis désolé de ne pas pouvoir répondre à votre question. Peut-être que l’institut C.G. Jung pourra vous aider : https://junginstitut.ch/en/About-Us/Contact.
Meilleures salutations,
Oliver Ammann
ETH Zurich, Oliver Ammann, Rare Books, ETH Library, Rämistrasse 101, 8092 Zurich, Switzerland, Phone +41 44 632 49 05, oliver.ammann@library.ethz.ch,
Dear Mr. Guay
Thank you for your message and request, which we are unfortunately unable to answer. However, you are welcome to visit our library and carry out your research on site. The library is open on Friday between 9-12h and 13-16h.
May I mention at this point that in order to find a quotation, you would have to physically read through all of C.G. Jung’s works. Unfortunately, digital research is not possible. Thank you for your understanding.
With kind regards
Julia Budai
Library / Program & Event Organization
C.G. Jung-Institut Zürich, Küsnacht
Hornweg 28, CH-8700 Küsnacht
Tel.: +41 44 914 10 51, Fax: +41 44 914 10 50
budai@junginstitut.ch , www.junginstitut.ch
Dear Serge-André Guay,
I am sorry but it was not possible to find the German original of the quotation you are looking for. Frankly, I do not think it really is a sentence of Jung. It seems to have widely spread on French-speaking internet sites, but mostly in non-academic circles, often in the context of texts on the covid-pandemic or on sites by coaches/therapists. And there was not a single scientific reference (e.g. to Jungs Collected Works) to be found. I assume that someone attributed this sentence to Jung and then in spread in the French-speaking Internet.
I am very familiar with Jung, especially with his texts on healing. There is one quotation which comes a bit close to the one your are looking for – but at the same time it is very different.
« […] wir [müssen] zunächst den Weg der Krankheit gehen, den Irrweg, der die Konflikte noch verschärft und die Vereinsamung zur Unerträglichkeit steigert, in der Hoffnung, daß aus der Tiefe der Seele, aus der alle Zerstörung kommt, auch das Rettende wachse. » (GW 11, § 532)
« […] we [must] first take the path of illness, the wrong path that exacerbates the conflicts and increases the loneliness to the point of unbearability, in the hope that from the depths of the soul, from which all destruction comes, salvation will also grow. »
Wishing you all the best,
Christiane Neuen
(Board member of the C. G. Jung Society, Cologne)
TRADUCTION
Cher Serge-André Guay,
Je suis désolé mais il n’a pas été possible de trouver l’original allemand de la citation que vous recherchez. Franchement, je ne pense pas qu’il s’agisse vraiment d’une phrase de Jung. Elle semble s’être largement répandue sur les sites internet francophones, mais surtout dans des milieux non académiques, souvent dans le contexte de textes sur la covidopandémie ou sur des sites de coachs/thérapeutes. Et il n’y avait pas une seule référence scientifique (par exemple aux Collected Works de Jungs) à trouver. Je suppose que quelqu’un a attribué cette phrase à Jung et qu’elle s’est ensuite répandue sur l’internet francophone.
Je connais très bien Jung, en particulier ses textes sur la guérison. Il y a une citation qui se rapproche un peu de celle que vous recherchez – mais qui est en même temps très différente.
« […] wir [müssen] zunächst den Weg der Krankheit gehen, den Irrweg, der die Konflikte noch verschärft und die Vereinsamung zur Unerträglichkeit steigert, in der Hoffnung, daß aus der Tiefe der Seele, aus der alle Zerstörung kommt, auch das Rettende wachse. » (GW 11, § 532)
« […] nous [devons] d’abord prendre le chemin de la maladie, le mauvais chemin qui exacerbe les conflits et accroît la solitude jusqu’à l’insupportable, dans l’espoir que des profondeurs de l’âme, d’où vient toute destruction, grandira aussi le salut. »
Tous mes vœux de réussite,
Christiane Neuen
(membre du conseil d’administration de la Société C. G. Jung, Cologne)
Si vous la connaissez, écrivez-moi s’il-vous-plaît à : info@philotherapie.ca
Quel est notre besoin le plus fondamental ? Voici la réponse de Frédéric Lenoir :
Au moment où je commençais l’écriture de ce livre, j’ai eu un échange téléphonique avec une amie canadienne très chère, maître en yoga et en qi gong : Nicole Bordeleau. Elle m’a demandé quel était, selon moi, notre besoin le plus fondamental : celui du lien ou celui de la sécurité ? Je lui ai répondu sans hésiter : celui de la sécurité. Le lien est capital, et même vital, parce que, justement, il nous apporte avant tout ce dont nous avons le plus besoin : la sécurité, tant intérieure (psychique) que matérielle et sociale.
LENOIR, Frédéric, Vivre ! dans un monde imprévisible – Manuel de résilience pour surmonter les crises, chapitre 1. Se sentir en sécurité, Le Livre de Poche, 2 juin 2021, p.17.
Frédéric Lenoir répond sans hésiter à la question du besoin le plus fondamental en pointant du doigt « celui de la sécurité ». Mais, il précise que la sécurité provient d’un autre besoin à combler, celui du lien. Sans lien, pas de sécurité. En vérité, le besoin le plus fondamentale est le lien qui débouche sur la sécurité. Il y a souvent confusion entre l’objet (le sujet), l’objectif fixé au sujet de l’objet et le moyen d’atteindre cet objectif.
La question était simple : Quel est notre besoin le plus fondamentale entre le lien et la sécurité. Frédéric Lenoir fait du lien un moyen pour combler le besoin de sécurité. Or, la question faisait du lien et de la sécurité deux besoins, non pas un besoin et un moyen. Le philosophe et sociologue affirme que « Le lien est capital, et même vital, parce que, justement, il nous apporte avant tout ce dont nous avons le plus besoin : la sécurité (…) ». Le moyen ne vient jamais avant l’objet et l’objectif. Si l’objectif demeure d’être sécurité, le moyen est le lien. mais là n’était pas la question.
Objet : Sécurité ou lien à titre de besoins fondamentaux
Objectif : déterminer lequel est le plus fondamental (avant tout).
Moyen : le lien (capital, et même vital).
Résultat : Sécurité.
La réponse adéquate était donc : le besoin le plus fondamental est le lien parce qu’une fois comblé il procurera la sécurité. À la base, un besoin ne comble pas un autre besoin. Ce ne sera que la réponse à un besoin dont on pourra déduire qu’il comblera un autre besoin. Il y a une logique à respecter, un ordre des choses. Il ne s’agit pas de jouer avec les mots.
Frédéric Lenoir enchaîne avec Baruch Spinoza, Abraham Maslow et Antonio Damasio :
Pour mieux le comprendre, évoquons deux grandes théories : celle du conatus, du philosophe néerlandais Baruch Spinoza, et celle de la pyramide des besoins, du psychologue Abraham Maslow. Au XVIIe siècle, dans son ouvrage majeur, L’Éthique, Spinoza affirme que « chaque chose, selon sa puissance d’être, s’efforce de persévérer dans son être ». Cet effort (conatus en latin) est une loi universelle de la vie, comme le confirme le célèbre neurologue portugais Antonio Damasio, fervent disciple de Spinoza : « L’organisme vivant est construit de telle sorte qu’il préserve la cohérence de ses structures et de ses fonctions contre les nombreux aléas de la vie1. » Pour mieux le comprendre, évoquons deux grandes théories : celle du conatus, du philosophe néerlandais Baruch Spinoza, et celle de la pyramide des besoins, du psychologue Abraham Maslow. Au XVIIe siècle, dans son ouvrage majeur, L’Éthique, Spinoza affirme que « chaque chose, selon sa puissance d’être, s’efforce de persévérer dans son être ». Cet effort (conatus en latin) est une loi universelle de la vie, comme le confirme le célèbre neurologue portugais Antonio Damasio, fervent disciple de Spinoza : « L’organisme vivant est construit de telle sorte qu’il préserve la cohérence de ses structures et de ses fonctions contre les nombreux aléas de la vie1. » Spinoza constate ensuite que, de manière tout aussi naturelle, chaque organisme vivant essaye de progresser, de grandir, de parvenir à une plus grande perfection. Il observe enfin que, chaque fois qu’il y parvient, sa puissance vitale augmente, il est habité par un sentiment de joie, alors que chaque fois qu’il rencontre un obstacle, qu’il se sent menacé dans son être ou que sa puissance vitale diminue, il est envahi par un sentiment de tristesse. Toute l’éthique spinoziste consiste dès lors à organiser notre vie grâce à la raison, pour préserver l’intégrité de notre être et augmenter notre puissance d’agir et la joie qui l’accompagne. Spinoza met au jour deux mécanismes de la vie : se préserver et augmenter sa puissance vitale et d’action. Dit autrement, il nous explique que la sécurité et la croissance sont nos deux besoins les plus fondamentaux.
____________
NOTE
1 Antonio Damasio, Spinoza avait raison. Joie et tristesse. Le cerveau des émotions, Paris, Odile Jacob, 2013, p. 40.
LENOIR, Frédéric, Vivre ! dans un monde imprévisible – Manuel de résilience pour surmonter les crises, chapitre 1. Se sentir en sécurité, Le Livre de Poche, 2 juin 2021, pp.17-18.
Bon, Spinoza ne semble pas d’accord avec Frédéric Lenoir. Pour Spinoza, « la sécurité et la croissance sont nos deux besoins les plus fondamentaux ». Le besoin du lien n’est plus dans le décor, à moins qu’il faille le déterminer comme un moyen et non pas comme un besoin.
Je comprends ces différences dans le fait que Frédéric Lenoir fait le tour de la question avec différents points de vue.
J’aime bien quand Frédéric Lenoir nuance : « Il ne faut donc pas faire un absolu de la hiérarchisation des besoins de Maslow. » Personnellement, je ne vois pas en quoi il fut utile de parler de la pyramide des besoins de Maslow s’il faut s’en méfier. En abordant le sujet, j’aurais tout de suite prévenu le lecteur des critiques à venir.
Le livre « Vivre ! dans un monde imprévisible » de Frédéric Lenoir s’inscrit dans le temps ordonnée par la crise mondiale du COVID-19. Il nous guide afin de surmonter le ou les traumatismes créés par l’épidémie. Après le chapitre 1, « Se sentir en sécurité », il consacre le deuxième à la résilience.
Dans ce deuxième chapitre, « Entrer en résilience », on trouve cette définition :
(…) La résilience désigne dès lors le processus psychique qui permet à un individu affecté par un traumatisme profond de se reconstruire, de trouver en lui, sans rien nier de ce choc, les ressources nécessaires pour avancer dans la vie. (…)
LENOIR, Frédéric, Vivre ! dans un monde imprévisible – Manuel de résilience pour surmonter les crises, chapitre 2. Entrer en résilience, Le Livre de Poche, 2 juin 2021, p. 30.
Selon les dictionnaires Le Robert – Dico en ligne, la résilience est une « capacité » : « Capacité à surmonter les chocs traumatiques ». La Confédération des associations de proches en santé mentale du Québec va dans le même sens : « La résilience est la capacité, de chacun, à reprendre un nouveau développement psychologique, après avoir vécu une épreuve significative. Les individus résilients vont avoir la capacité de s’adapter de manière flexible et ingénieuse aux situations qu’ils ne peuvent pas contrôler. En effet, ils vont puiser dans leurs qualités personnelles afin de modifier leurs comportements étant donné les nouveaux contextes auxquels ils font face. »
Pour le dictionnaire Larousse, la résilience est une « aptitude » : « Aptitude d’un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques ». Le dictionnaire USITO de l’Université de Sherbrooke (Québec, Canada) parle aussi d’une « aptitude » : « Aptitude à faire face avec succès à une situation représentant un stress intense ainsi qu’à se ressaisir, à s’adapter et à réussir à vivre et à se développer positivement en dépit de ces circonstances défavorables. »
« Processus » ou « Aptitude », la résilience implique nécessairement des « Attitudes », notamment mais pas exclusivement, celle engendrée par le traumatisme et qui vient d’en détrôner une autre désormais désuète. S’il faut parler de processus psychique, ce dernier doit conduire non seulement à un réajustement de ses perceptions et de ses valeurs mais aussi et surtout de son comportement face à l’adversité. Or, les changements de comportement surviennent généralement à la suite d’un traumatisme en raison de la nouvelle attitude qu’il a entraîné. On peut aussi associer les changements de comportement à des révélations soudaines de vérité permettant de se rendre à l’évidence d’une nouvelle compréhension de soi et/ou du monde.
Le processus de résilience fait l’objet de nombreuses recherches et théorie, mais on peut schématiquement évoquer trois étapes principales après le traumatisme : la résistance, l’adaptation et la croissance. Lorsqu’on est déstabilisé et en souffrance, on commence par résister, par se protéger pour éviter ce qui nous affecte. Cette première étape peut être salutaire, car il est souvent nécessaire de lutter contre l’angoisse et les effets destructeurs du traumatisme. Mais elle peut conduire à des mécanismes de défense extrêmes (déni, clivage, refuge dans une bulle psychique protectrice…) qui n’aideront pas la personne à guérir. Pour avancer, il est nécessaire de regarder la réalité en face et de tenter de nous adapter au mieux de la situation. Cette étape est cruciale, dans le processus de résilience, car elle signifie que nous ne sommes pas dans le déni, dans le refus du réel, dans une attitude passive. Nous agissons en prenant acte du caractère inéluctable de l’épreuve que nous traversons, de notre douleur physique ou psychique, et nous cherchons le meilleur moyen de nous adapter à cette situation difficile. La croissance nous conduit plus loin encore : il ne s’agit plus seulement de moins souffrir, mais de s’appuyer sur ce traumatisme pour grandir, évoluer, aller plus loin. La fameuse formule de Nietzsche dans Le Crépuscule des idoles l’exprime très bien : « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ».
LENOIR, Frédéric, Vivre ! dans un monde imprévisible – Manuel de résilience pour surmonter les crises, chapitre 2. Entrer en résilience, Le Livre de Poche, 2 juin 2021, pp. 31-32.
La résistance « car il est souvent nécessaire de lutter contre l’angoisse et les effets destructeurs du traumatisme » ? Résister demande une somme considérable d’énergie à la personne qui, déjà, épuisée par la souffrance voire un mal-être profond, en dispose très peu. Je doute donc de l’efficacité de cette étape au profit d’une bonne hygiène de vie en prescription d’une baisse du stress post-traumatique.
À la suite de la résistance en première étape, voici la deuxième étape : « Pour avancer, il est nécessaire de regarder la réalité en face et de tenter de nous adapter au mieux de la situation. Cette étape est cruciale, dans le processus de résilience, car elle signifie que nous ne sommes pas dans le déni, dans le refus du réel, dans une attitude passive. » Traumatisé et conscient de l’être, on ne peut certainement pas être dans le déni de la cause et de son état. C’est la compréhension qui fait défaut. Nous avons le nez collé sur la réalité et dans l’incapacité de la regarder avec le recul nécessaire. Ainsi, la deuxième étape est de prendre du recul face au traumatisme et notre réaction face à ce dernier.
Pour prendre ce recul face à la réalité, Henri Laborit, médecin chirurgien, neurobiologiste, éthologue, eutonologue et philosophe, propose la fuite dans son livre « Éloge de la fuite » (voir aussi le livre en ligne en accès libres en format PDF). Il faut s’éloigner de la réalité et ainsi prendre du recul face à elle. Aussi bien fuir la vallée pour les sommets.

AVANT-PROPOS
Quand il ne peut plus lutter contre le vent et la mer pour poursuivre sa route, il y a deux allures que peut encore prendre un voilier : la cape (le foc bordé à contre et la barre dessous) le soumet à la dérive du vent et de la mer, et la fuite devant la tempête en épaulant la lame sur l’arrière, avec un minimum de toile. La fuite reste souvent, loin des côtes, la seule façon de sauver le bateau et son équipage. Elle permet aussi de découvrir des rivages inconnus qui surgiront à l’horizon des calmes retrouvés. Rivages inconnus qu’ignoreront toujours ceux qui ont la chance apparente de pouvoir suivre la route des cargos et des tankers, la route sans imprévu imposée par les compagnies de transport maritime.
Vous connaissez sans doute un voilier nommé «Désir ».
LABORIT, Henri, Éloge de la fuite, Collection Folio essais – no7, Éditions Gallimard, 2025 (Éditions Robert Laffont, S.A., Paris, 1976) , Paris, p. 4.
Vue de loin, la réalité nous semblera plus abordable. Il sera plus aisé de s’y adapter.
Cela nous ramène à l’angoisse. Comment donner une « idée de l’Homme » sans parler d’elle? Je pense que l’on n’a pas suffisamment insisté jusqu’ici sur cette idée simple que le système nerveux avait comme fonction fondamentale de nous permettre d’agir. Le phénomène de conscience chez l’homme, que l’on a évidemment rattaché au fonctionnement du système nerveux central, a pris une telle importance, que ce qu’il est convenu d’appeler « la pensée » a fait oublier ses causes premières, et qu’à côté des sensations il y a l’action. Or, nous le répétons, celle-ci nous parait tellement essentielle que lorsqu’elle n’est pas possible, c’est l’ensemble de l’équilibre d’un organisme vivant qui va en souffrir, quelquefois jusqu’à entraîner la mort. Et ce fait s’observe aussi bien chez le rat que chez l’homme, plus souvent chez le rat que chez l’homme, car le rat n’a pas la chance de pouvoir fuir dans l’imaginaire consolateur ou la psychose. Pour nous, la cause primordiale de l’angoisse c’est donc l’impossibilité de réaliser l’action gratifiante, en précisant qu’échapper à une souffrance par la fuite ou par la lutte est une façon aussi de se gratifier, donc d’échapper à l’angoisse.
LABORIT, Henri, Éloge de la fuite, Une idée de l’Homme, Collection Folio essais – no7, Éditions Gallimard, 2025 (Éditions Robert Laffont, S.A., Paris, 1976) , Paris, p. 21.
Personnellement, la première étape de ma fuite consiste et refermé la porte derrière moi, à ne plus permettre à la source du traumatisme de m’atteindre. Je coupe donc tous les liens avec le passé pour me concentrer sur le moment présent. Et je me permets avec un malin plaisir d’en informer cette source. Évidemment, cela fonctionne beaucoup mieux si je ne suis pas moi-même la cause de mon traumatisme. Car, dans ce cas, je ferme la porte à une part de moi-même, ce qui peut s’avérer périlleux.
Envisagée sous cet aspect, la création est bien une fuite de la vie quotidienne, une fuite des réalités sociales, des échelles hiérarchiques, une fuite dans l’imaginaire.
LABORIT, Henri, Éloge de la fuite, Une idée de l’Homme, Collection Folio essais – no7, Éditions Gallimard, 2025 (Éditions Robert Laffont, S.A., Paris, 1976) , Paris, p. 23.
C’est donc dans mon imaginaire que je cherche le meilleur moyen de m’adapter à cette situation difficile.Mais le verbe d’action « adapter » ne me plaît pas réellement puisque je viens de fuit cette situation difficile pour me réfugier dans mon imaginaire créatif. Par ma fuite, j’abandonne cette situation difficile à elle-même et je me concentre sur le nouveau présent réservant mon énergie à la création d’un nouvel avenir.
La troisième étape proposée par Frédéric Lenoir se lit comme suit : « La croissance nous conduit plus loin encore : il ne s’agit plus seulement de moins souffrir, mais de s’appuyer sur ce traumatisme pour grandir, évoluer, aller plus loin. » Personnellement, je ne reconnais aucune source de créativité au traumatisme, donc de m’y appuyer « pour grandir, évoluer, aller plus loin. » Je ne pas de ceux qui cherchent à retourner une situation négative en situation positive. Au diable ! La situation négative. Je la fuis comme la peste.
Mais une étape s’impose avant la fuite : me relever, regarder en arrière pour voir si la situation difficile dans laquelle je me trouve est la conséquence d’une erreur de ma part. Il n’est pas question de vite me relever pour foncer tête baissée vers l’avant. Je ne souhaite pas répéter la même erreur à l’avenir. À elle seule, cette étape me valorise.
Je ne comprends pas l’usage du terme « croissance » dans cette troisième étape. La directive qu’il faille « grandir, évoluer, aller plus loin » et ainsi croître me pèserait sur les épaules comme une injonction. Or, en situation difficile suite à un traumatisme, j’ai besoin de toute ma liberté pour fuir, créer et décider de mon nouvel avenir. Je ne cherche pas nécessairement à être meilleur et, pour ce faire à aller plus loin.
La psychologie prescrit de chercher à être meilleur tout au long de notre vie, un travail sans fin jusqu’à la mort. Un fois au sommet de la montagne, on découvre une autre montagne à gravir plus haute que la première et ainsi de suite. La vie n’est pas une suite d’escalades de montagnes plus hautes les unes que les autres.
Enfin, je n’adhère à l’idée de Nietzsche dans le Crépuscule des idoles à l’effet que « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Je n’ai pas constaté cela au cours de ma vie. Je ne suis pas plus fort que la vie elle-même. Je ne trouve rien qui puisse me rendre plus fort dans les traumatismes que j’ai vécu difficilement à chaque fois, pas plus que quoique ce soit qui me rende plus fort dans le mon moi traumatisé. On peut toujours croire l’affirmation de Nietzsche mais est-ce une vérité universelle ? Certainement pas.
Une des qualité qui peut le mieux nous aider à nous adapter à une situation douloureuse subie, c’est l’humour. L’humour, on le sait depuis Aristote, et notamment l’autodérision (se moquer de soi), permet de mettre le tragique à distance. Puisqu’on ne peut rien changer à la situation pénible ou absurde, mieux vaut en rire ! (…)
LENOIR, Frédéric, Vivre ! dans un monde imprévisible – Manuel de résilience pour surmonter les crises, chapitre 3. S’adapter, Le Livre de Poche, 2 juin 2021, p. 44.
L’humour, le rire, l’ironie sont au cœur d’un courant philosophique dont je me sens très proche : le taoïsme. Apparu en Chine vers le VIe siècle avant notre ère, le taoïsme valorise l’humour comme facteur de détachement. Le rire nous permet de nous détacher d’une situation douloureuse, absurde, inconfortable, par la force de l’esprit. De prendre du recul et donc de faire preuve d’adaptabilité. (…)
LENOIR, Frédéric, Vivre ! dans un monde imprévisible – Manuel de résilience pour surmonter les crises, chapitre 3. S’adapter, Le Livre de Poche, 2 juin 2021, p. 46.
Au Québec l’humour est une industrie culturelle très importante.
Le titre du quatrième chapitre trahit toute philosophie au profit de la psychologie positive et du développement personnel : « Cultiver le plaisir et les émotions positives ».
Lorsque nous sommes fragilisés, angoissés, déstabilisés, il n’y a sans doute pas de meilleur remède que de rechercher ce qui nous procure du plaisir ou de la joie : savourer des mets qu’on aime, faire du sport, cultiver son jardin, s’adonner à une activité créatrice, se promener dans la nature, téléphoner à un ami cher, écouter un morceau de musique qui nous apaise, faire du yoga, méditer, regarder un film qui nous met de bonne humeur, lire des poèmes, savourer un bon verre de vin… Cela m’évoque aussi ce qu’affirme Spinoza dans son livre IV de l’Éthique : « Un affect ne peut être supprimé ou contrarié que par un affect plus fort que l’affect à contrarier3. » Tout est dit : on ne peut quitter une émotion ou un sentiment de peur, de tristesse, de colère, une dépression, qu’en mobilisant une autre émotion ou sentiment positif : du plaisir, de la gratitude, de l’amour, de la joie. De manière générale, mais davantage encore en période de crise, recherchons toute expérience qui nous procure des émotions positives, de la satisfaction de vivre.
____________
NOTE
3 Spinoza, Éthique, IV, proposition 7.
LENOIR, Frédéric, Vivre ! dans un monde imprévisible – Manuel de résilience pour surmonter les crises, chapitre 4. Cultiver le plaisir et les émotions positives, Le Livre de Poche, 2 juin 2021, pp 57-58.
Il n’y a rien qui me tombe plus sur les nerfs, et cela depuis mon adolescence, que la pensée positive.
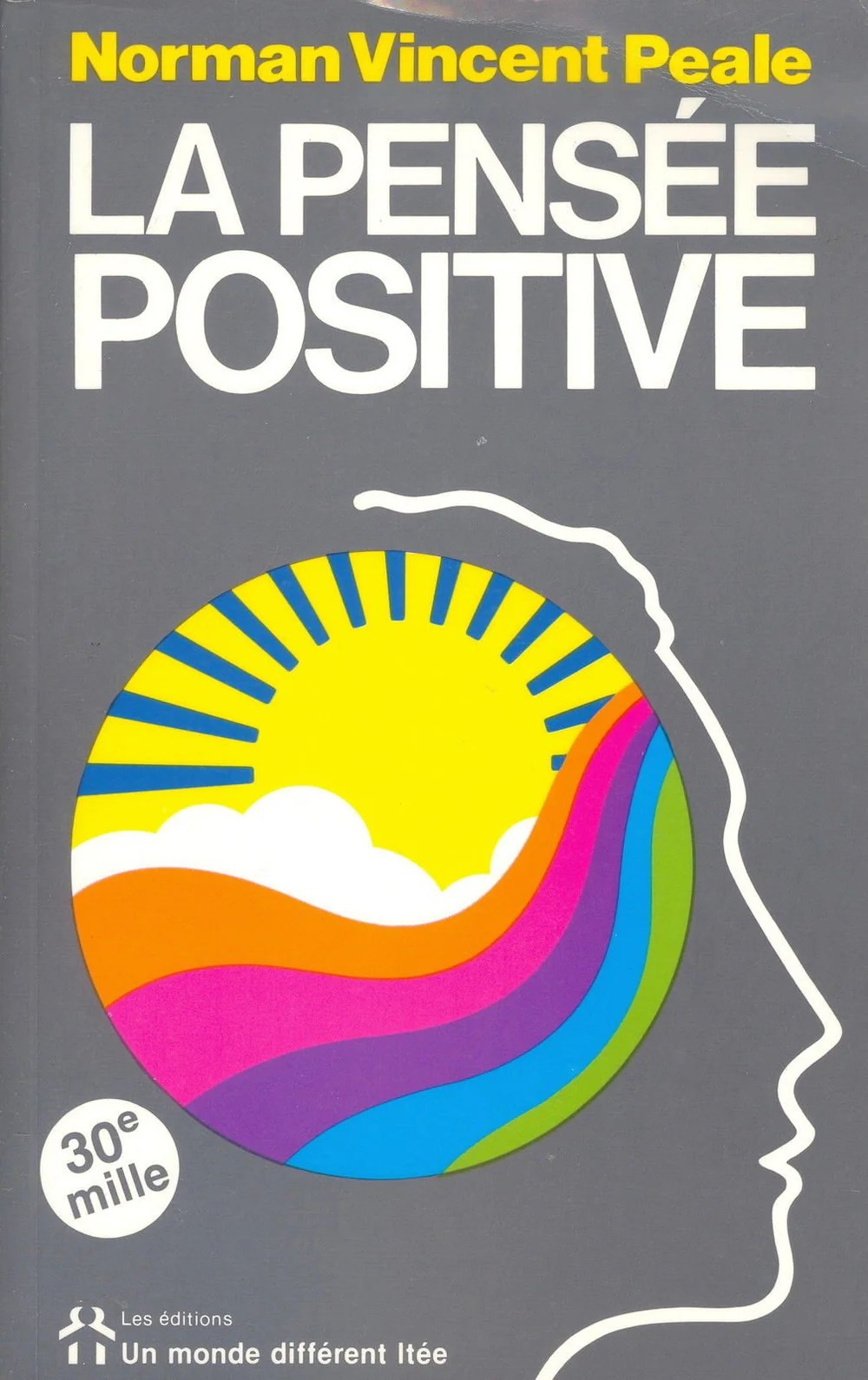
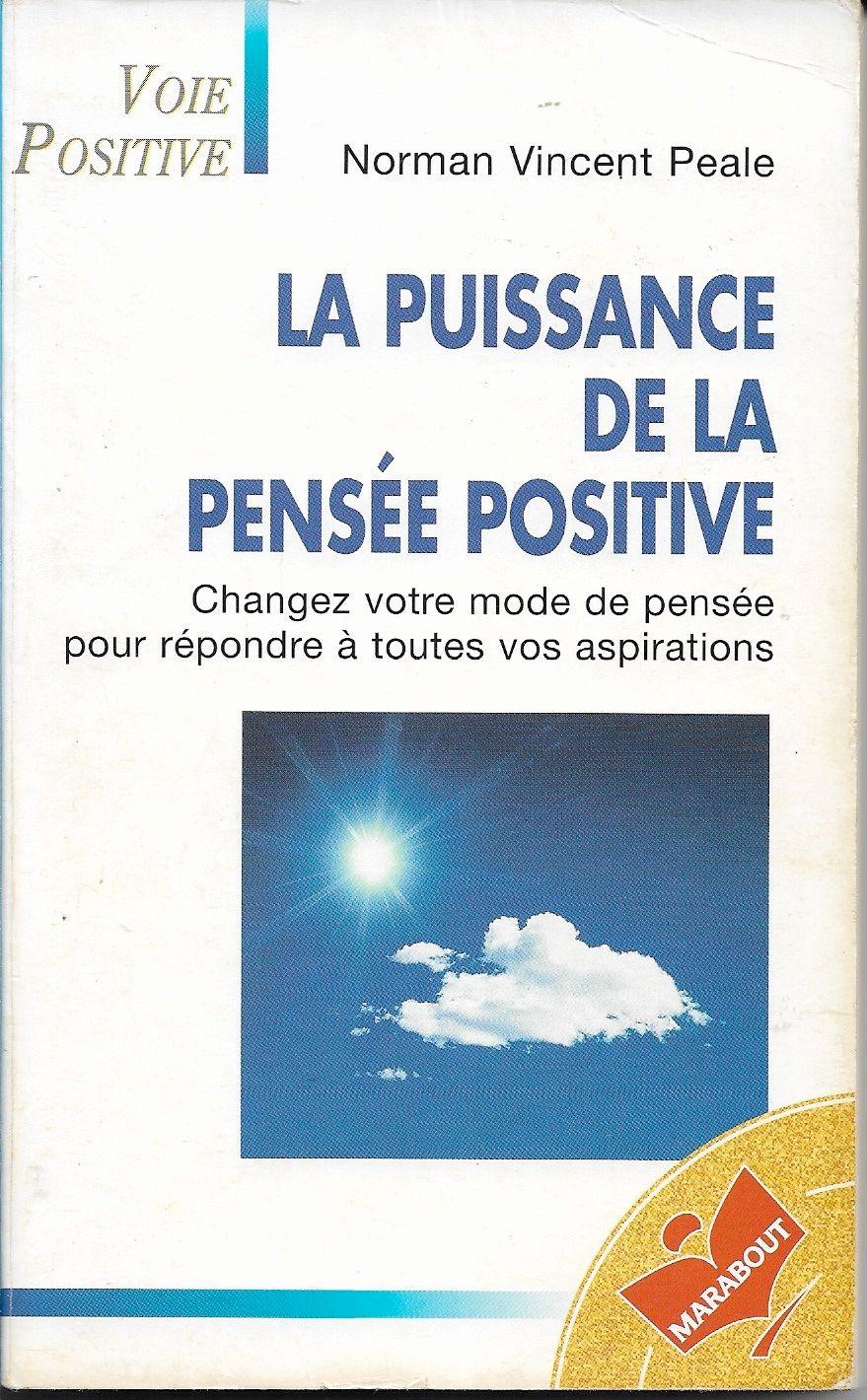
La pensée positive désigne un mouvement pseudo-scientifique créé en 1952 par le pasteur Norman Vincent Peale et véhiculé dans les années 2010 par différents acteurs œuvrant dans le secteur économique du développement personnel. Qui a inventé la pensée positive ? Histoire. La psychologie positive a officiellement commencé aux États-Unis, en 1998, par le discours de Martin Seligman, nommé président de l'Association américaine de psychologie (APA) lors du congrès annuel de cette association. Pensée positive, Wikipédia.
En fait, le terme « psychologie positive » a été inventé par Maslow dans son livre « Motivation et personnalité » (Maslow, 1954). Maslow détestait la préoccupation de la psychologie pour le désordre et le dysfonctionnement, affirmant qu'elle manquait d'une compréhension précise du potentiel humain.
Positive Psychology, 3 Dec 2024, The 5 Founding Fathers and A History of Positive Psychology, 12 Feb 2015 by Jo Nash, Ph.D., Scientifically reviewed by Tiffany Sauber Millacci, Ph.D.
« Sois positif ! » NON ! Je préfère et de loin être réaliste. Quand un malheur traumatisant m’accable, je ne mange pas mes émotions pour me vautrer dans les plaisirs de la table. Franchement, il tel conseil de la part d’un philosophe ! Et je ne vais pas « Ralentir et savourer l’instant » (chapitre 5)… Quel instant ! Celui de ma souffrance ! Celui de la dégustation d’un bon plat ? Ne suis-je pas immobiliser par l’angoisse ? Dans mon cas, j’ai déjà fui.
Puis, Frédéric Lenoir nous invite à « Resserrer les liens » dans le sixième chapitre de ce livre. Il nous laisse croire à une approche philosophique avec la première phrase de ce chapitre : « “L’Homme est un animal social” affirmait Aristote. Il est dans sa nature de vivre en relation étroite avec ses semblables, comme d’ailleurs la plupart des animaux. » Mais la philosophie prend vite le bord au profit de la psychanalyse en remontant à l’enfance, pour ne pas dire, au fœtus.
Le « développeur » personnel propose ensuite de « Donner du sens » dans son septième chapitre.
Après les étapes de résistance et d’adaptation, le processus de résilience – de reconstruction et de croissance intérieure – s’approfondit avec le resserrement de nos liens affectifs et sociaux, mais aussi par notre capacité à donner du sens à notre vie. Je dis bien « donner du sens à notre vie » et non « chercher le sens de la vie ». En effet, il ne s’agit pas tant qu’un questionnement métaphysique sur le sens de la vie humaine, si important soit-il, que de chercher à donner du sens à sa propre existence. Peut-être existe-t-il autant de sens que d’individus, peu importe. Ce qui compte, pour mieux vivre, mais aussi pour se reconstruire après un traumatisme, c’est que chaque individu puisse donner une signification à son existence.
LENOIR, Frédéric, Vivre ! dans un monde imprévisible – Manuel de résilience pour surmonter les crises, chapitre 7. Donner du sens, Le Livre de Poche, 2 juin 2021, p. 87.
Quel philosophe recommande d’éviter « (…) un questionnement métaphysique sur le sens de la vie humaine (…) » lorsque vient le temps de donner du sens à sa vie ? Si je m’accorde aisément avec l’affirmation « Je dis bien “donner du sens à notre vie” et non “chercher le sens de la vie”. » Je crois que la vie n’a pas de sens en elle-même, qu’il faut lui en donner un. Mais, prudence, seul un sens partagé me satisfait par souci de mon humanité et non pas limité à mon existence personnelle. Je suis un Homme avant d’être un individu. Quant à resserrer les liens, aussi bien embrasser l’humanité. Après tout, c’est dans ma nature.
Face à un obstacle ou à une épreuve, nous demeurons libre de faire « contre mauvaise fortune bon cœur », comme le dit si bien l’expression populaire, ou bien de nous « ronger les sangs ». Nous demeurons libres de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, de cherche à nous adapter au mieux, ou pas, à une situation déstabilisante. Et notre plus bel acte de liberté intérieure sera même de savoir utiliser une blessure, une contrainte, une maladie, un échec, un traumatisme de vie pour mobiliser nos ressources intérieures et grandir. C’est le sommet de la résilience, et les personnes qui ont fait ce chemin sont souvent les plus belles et les plus humaines qui soient.
LENOIR, Frédéric, Vivre ! dans un monde imprévisible – Manuel de résilience pour surmonter les crises, chapitre 8. Devenir libre, Le Livre de Poche, 2 juin 2021, p. 103.
Comment un le plus bel acte de liberté intérieure peut être de savoir ? Frédéric Lenoir est-il en train de me dire que je suis libre de savoir ? Savoir « utiliser une blessure, une contrainte, une maladie, un échec, un traumatisme de vie pour mobiliser nos ressources intérieures et grandir ». Utiliser pour mobiliser ? Il me faut mobiliser avant d’utiliser.
Et je dois savoir utiliser ma blessure, ma contrainte, ma maladie, mon échec, mon traumatisme de vie pour grandir. Il vaut mieux faire table rase plutôt que de tourner le fer dans la plaie.
Il fallait bien un chapitre sur la mort et c’est le neuvième : « Apprivoiser la mort ».
Agissons donc avec raison et apprenons à apprivoiser la mort, c’est-à-dire à vivre avec l’idée que nous mourrons tous un jour et qu’elle fait partie intégrante de la vie… ne serait-ce que parce que si la mort n,existait pas, la vie sur Terre serait impossible ! (…)
LENOIR, Frédéric, Vivre ! dans un monde imprévisible – Manuel de résilience pour surmonter les crises, chapitre 9. Apprivoiser la mort, Le Livre de Poche, 2 juin 2021, p. 114.
(…) Si le sage n’a pas peur de la mort, c’est qu’il est dans une profonde acceptation de la vie et de ses lois : la naissance, la croissance, le déclin, la mort. (…)
LENOIR, Frédéric, Vivre ! dans un monde imprévisible – Manuel de résilience pour surmonter les crises, chapitre 9. Apprivoiser la mort, Le Livre de Poche, 2 juin 2021, p. 115.
Chapitre 10, « Agir et consentir » :
(…) Mais nous ne pouvons pas aller jusqu’au bout du processus de guérison intérieure qui si nous apprenons aussi à aimer la vie de manière inconditionnelle. Nous découvrirons alors que le bonheur et la joie sont en nous et non dans les conditions extérieures. Qu’ils résident dans notre capacité d’agir et de réagir, dans le regard que nous portons sur nous-mêmes et sur le monde. Comme le dit encore Épictète dans son Manuel : « Ce qui tourmente les Hommes, ce n’est pas la réalité, mais les jugements qu’ils portent sur elle. » Formule saisissante qui fait écho à celle de Tilopa, un moine bouddhiste du IXe siècle : « Ce ne sont pas les choses qui te lient, mais ton attachement aux choses. » Autrement dit, le bonheur, la sérénité ou la satisfaction de notre existence ne dépendent pas tant des événements toujours aléatoires du monde extérieur (santé, richesse, honneurs, etc.) que de l’harmonie de notre monde intérieur.
LENOIR, Frédéric, Vivre ! dans un monde imprévisible – Manuel de résilience pour surmonter les crises, chapitre 10. Agir et consentir, Le Livre de Poche, 2 juin 2021, pp. 129-130.
L’idée que le bonheur et la joie sont en moi, déjà en moi, ne me plaît du tout. À ce compte, le malheur est aussi en moi, et non pas dans les conditions extérieures. Ça ne tient pas la route. Qui plus est, je ne cherche pas le bonheur et la joie. Je les construis. Mon bonheur, s’il doit loger quelque part, est en l’Autre, dans l’Autre.
Si vous êtes un amateur de développement personnel légèrement épicé de philosophie, le livre Vivres ! dans un monde imprévisible de Frédéric Lenoir est pour vous. Votre bonheur durera le temps de la lecture de ce livre. C’est mieux que rien.








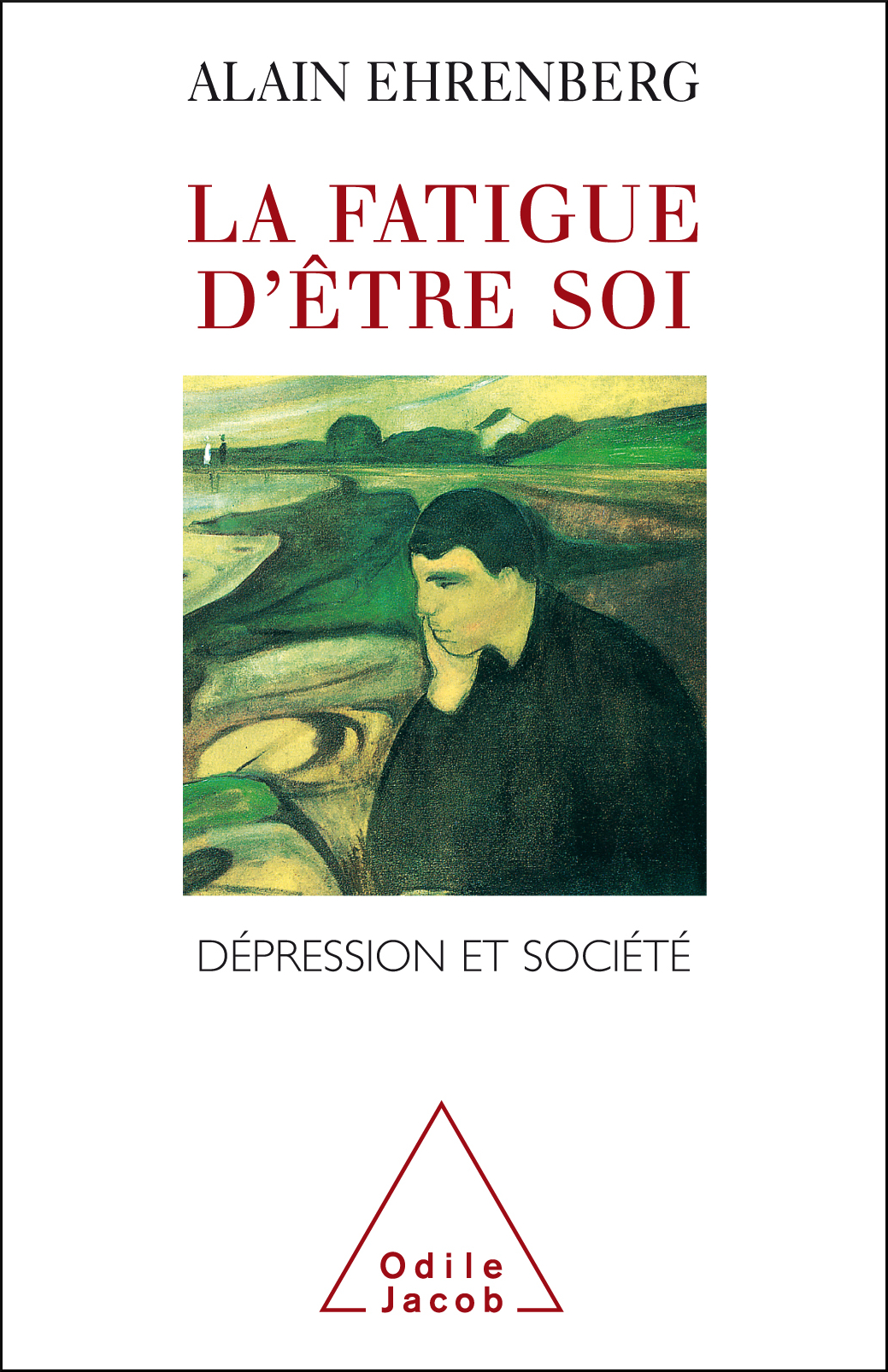

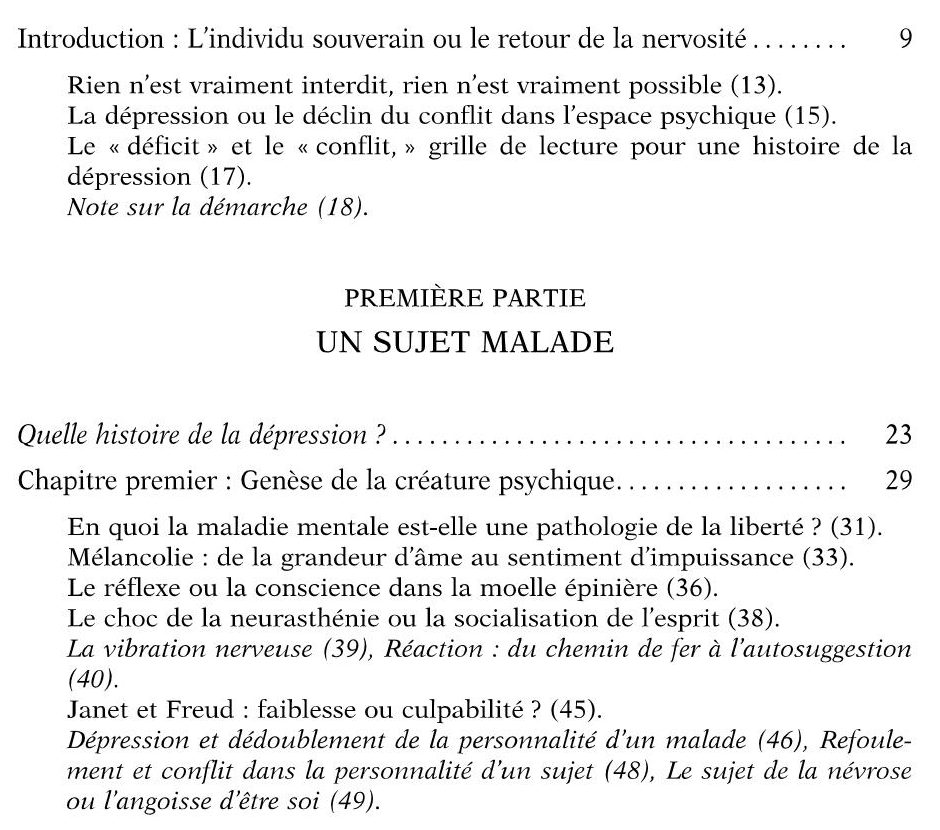
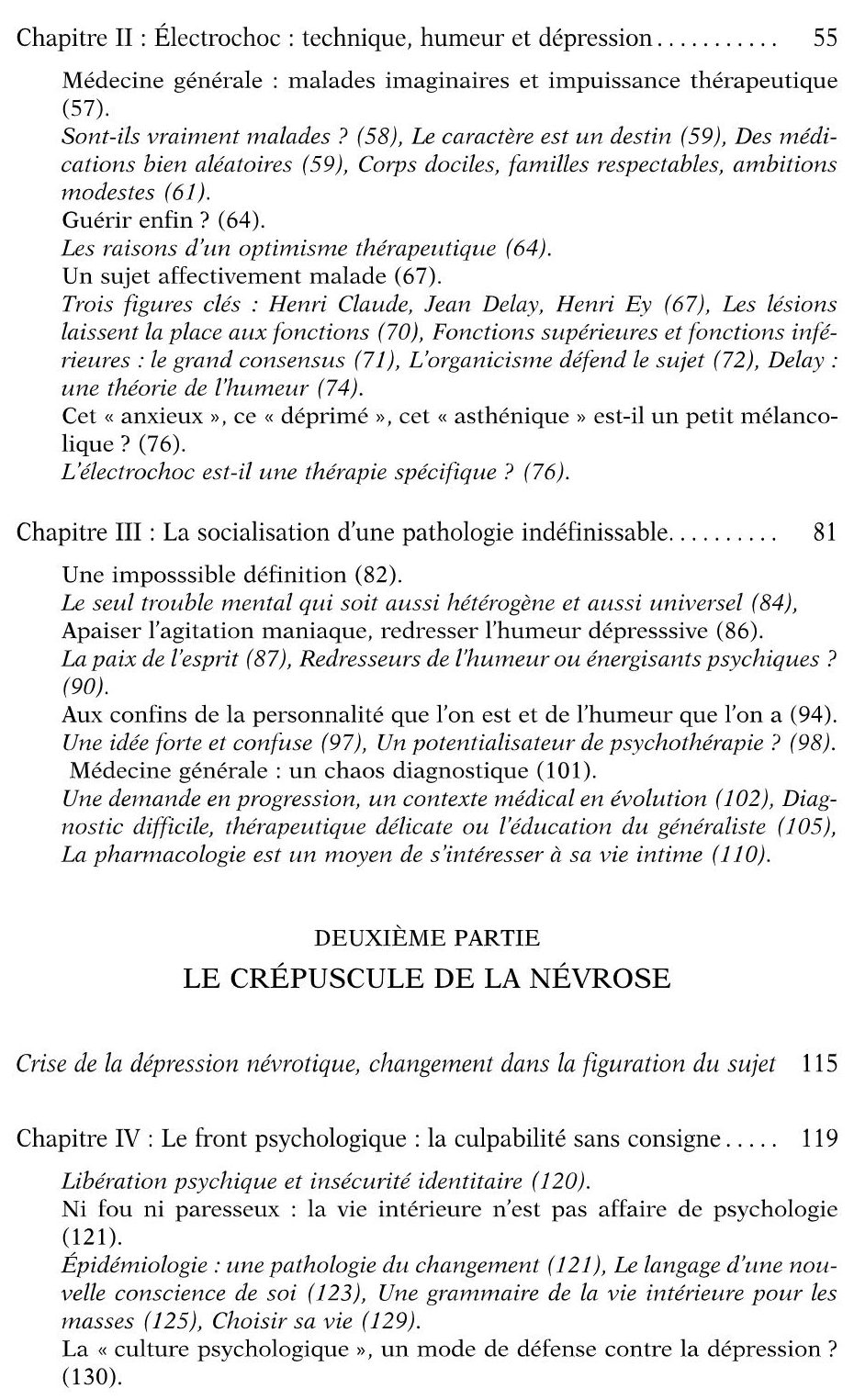
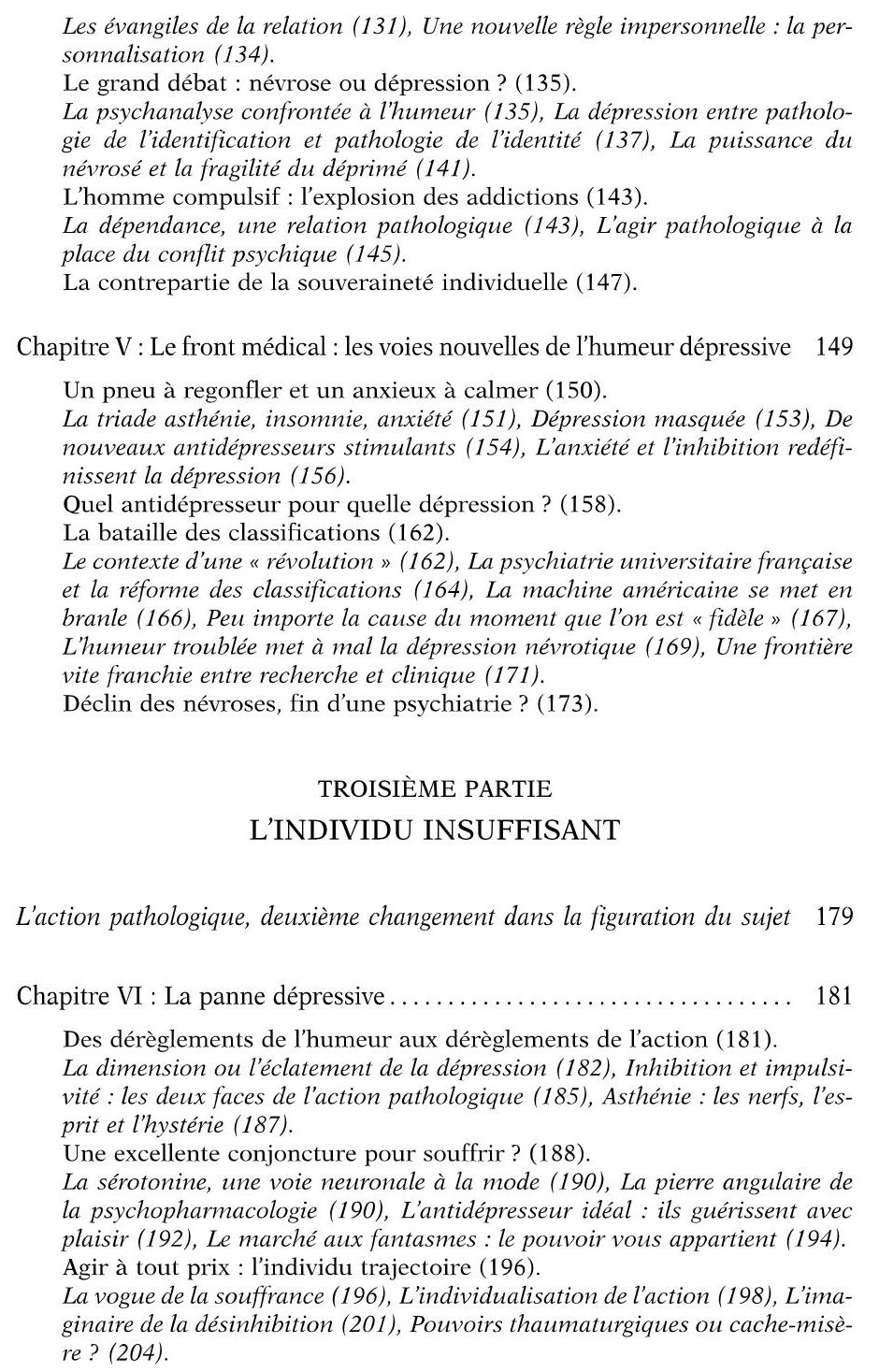
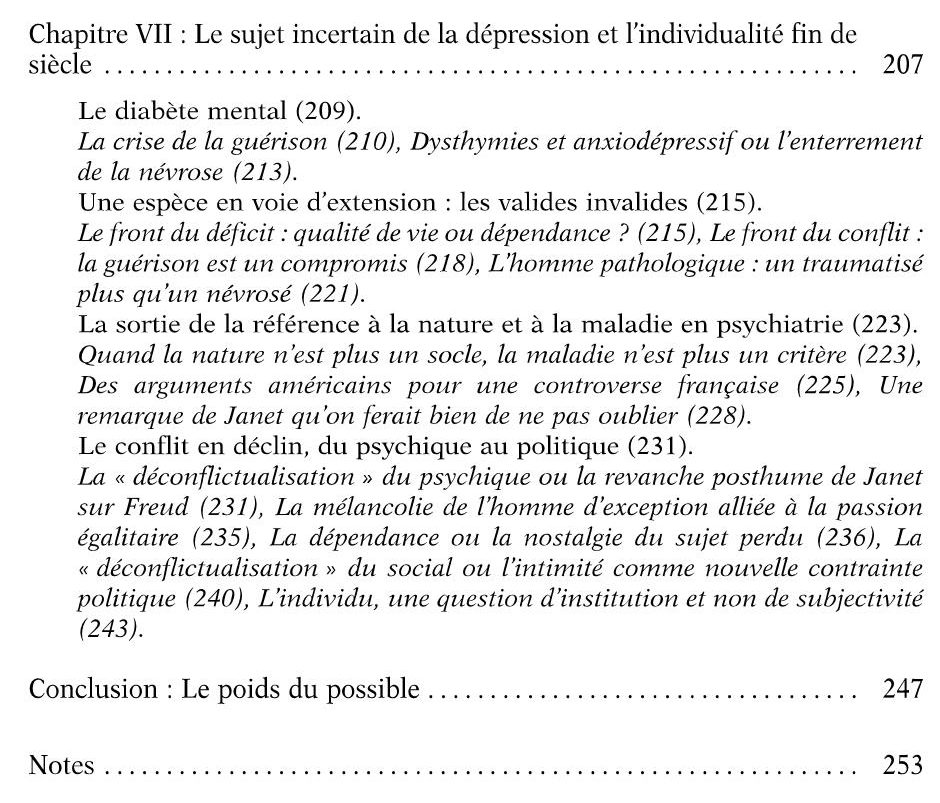

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.