J’ai lu pour vous« Philosophical Praxis — Origin, Relations, and Legacy »par Gerd B. Achenbach,fondateur de la philosophie pratique en 1981.Ce recueil de textes traduit de l’allemand à l’anglais par Michael Picard est enfin disponible depuis 2024. Ce livre est LE GUIDE ESSENTIEL de la philosophie pratique.J’accorde à ce livre cinq étoiles sur cinq.
Pour le bénéfice de nos lecteurs francophones n’ayant pas accès à l’anglais, une traduction en français accompagne le texte original en anglais des extraits et des citations dans cet article. Merci à Lexington Books (An imprint of The Rowman & Littlefield Punlishing Group, Inc.) |
Menu de cette page
- Couvertures
- Données au catalogue
- Texte de présentation (Quatrième de couverture)
- Table des matières
- Extraits de l’œuvre
- Au sujet de l’auteur
- Du même auteur
- Revue de presse
- Mon rapport de lecture
Couvertures

Philosophical Praxis
Origin, Relations, and Legacy
Gerd B. Achenbach – Translated by Michael Picard
Article # 140
Gerd B. Achenbach
Philosophical Praxis
Origin, Relations, and Legacy
Translated by Michael Picard, Lexington Books, 2024
Lexington Books
An imprint of The Rowman & Littlefield Punlishing Group, Inc.
2024
Données au catalogue
Lexington Books
Pages: 210
Trim: 6¼ x 9⅜ (15.88 x 2.18 x 23.65 cm)
978-1-7936-5113-6 • Hardback • April 2024
978-1-7936-5114-3 • eBook • April 2024
Series: Philosophical Practice
Hier der Flyer ![]() mit einem 30% Rabatt-Angebot.
mit einem 30% Rabatt-Angebot.
Présentation
Texte de présentation sur le site web de l’éditeur
Texte original en anglais
Gerd B. Achenbach’s Philosophical Praxis: Origin, Relations, and Legacy, translated by Michael Picard, offers unique insights into the compelling origin and development of what has been called a renaissance of philosophy: a storied trove of thought steeped in tradition, character, and experience, and redeployed in the service of understanding the individual life. Throughout this book, the author explores Philosophical Praxis not only through the tumultuous history of philosophy, but also through psychology, religion, literature, and more. Achenbach’s tone is subtle, humorous, and constantly surprising, demonstrating his intimacy with an expansive spirit of life and leaving behind the narrowness of academic disciplines. As the founder of Philosophical Praxis, Achenbach dissects the challenges faced in current philosophy and psychology and, in doing so, surpasses academic philosophy to reveal the possibility of a new profession for philosophical practitioners seeking to resist the seductions of theory, methods, or solutions, and personify the seriousness of being human.
Source : Lexington Books (An imprint of The Rowman & Littlefield Punlishing Group, Inc.)
Traduction en français avec DeepL
L’ouvrage de Gerd B. Achenbach, Philosophical Praxis : Origin, Relations, and Legacy, traduit par Michael Picard, offre un aperçu unique de l’origine et du développement de ce que l’on a appelé une renaissance de la philosophie : un trésor de pensée imprégné de tradition, de caractère et d’expérience, et redéployé au service de la compréhension de la vie de l’individu. Tout au long de cet ouvrage, l’auteur explore la praxis philosophique non seulement à travers l’histoire tumultueuse de la philosophie, mais aussi à travers la psychologie, la religion, la littérature, etc. Le ton d’Achenbach est subtil, humoristique et constamment surprenant, démontrant son intimité avec un esprit de vie expansif et laissant derrière lui l’étroitesse des disciplines académiques. En tant que fondateur de Philosophical Praxis, Achenbach dissèque les défis auxquels sont confrontées la philosophie et la psychologie actuelles et, ce faisant, dépasse la philosophie académique pour révéler la possibilité d’une nouvelle profession pour les praticiens de la philosophie qui cherchent à résister aux séductions de la théorie, des méthodes ou des solutions, et à personnifier le sérieux de l’être humain.
TEXTE EN QUATRIÈME DE COUVERTURE
Texte original en anglais
“This collection of Gerd Achenbach’s most important writings on Philosophical Practice is a much-awaited milestone in the history of this field. It’s been more than forty years since Achenbach baptized Philosophical Practice and gave it a solid philosophical foundation—in German. In all these years, Philosophical Practice expanded worldwide and took many different forms, while Achenbach’s incipit remained obscure to all those who could not read German. Through his excellent translation of Achenbach’s texts into English (an almost impossible task requiring outstanding linguistic and philosophical skills), Michael Picard marks a turning point in this story and makes an invaluable gift to all those interested in and caring for Philosophical Practice.” — Donata Romizi, University of Vienna
“Achenbach at his best. Thoughtful, witty, and steeped in the European philosophical tradition, he takes us along as he reflects on the philosophical impulses underlying philosophical practice, on what needs it addresses, on what mastering it may be and require, and makes a compelling case for why it matters today. This choice selection of essays, long-awaited and masterfully translated, is a must-read for anyone interested in philosophical counseling and in the therapeutic significance of philosophical thinking more generally.” — Raja Rosenhagen, Ashoka University
« Gerd Achenbach is one of the pioneers of philosophical practice. While his reputation precedes him and some of his works have been translated into English, Philosophical Praxis captures Achenbach’s unique, formidable character, philosophy, and spirit. Michael Picard has contributed an excellent service―a labor of love that comes through in his capturing of Achenbach’s style―in making this valuable contribution to philosophical practice available in English. This is a must read for anyone interested in philosophical practice! » — Rick Repetti, Kingsborough Community College
Philosophical Praxis, launched by Gerd B. Achenbach in 1981, ushers in the first alternative to current therapeutic practices, offering unique insights into the compelling origin and development of a renaissance of philosophy.
Gerd B. Archenbach is chairman of the Society of Philosophical Praxis.
Micheal Picard teaches philosophy at Douglas College in Vancouver, Canada.
Source : Lexington Books (An imprint of The Rowman & Littlefield Punlishing Group, Inc.)
Traduction en français avec DeepL
« Ce recueil des écrits les plus importants de Gerd Achenbach sur la pratique philosophique est un jalon très attendu dans l’histoire de ce domaine. Cela fait plus de quarante ans qu’Achenbach a baptisé la pratique philosophique et lui a donné une base philosophique solide – en allemand. Pendant toutes ces années, la pratique philosophique s’est développée dans le monde entier et a pris de nombreuses formes différentes, tandis que l’incipit d’Achenbach est resté obscur pour tous ceux qui ne savaient pas lire l’allemand. Grâce à son excellente traduction des textes d’Achenbach en anglais (une tâche presque impossible qui exige des compétences linguistiques et philosophiques exceptionnelles), Michael Picard marque un tournant dans cette histoire et fait un cadeau inestimable à tous ceux qui s’intéressent à la pratique philosophique et qui s’en occupent.
— Donata Romizi, Université de Vienne
« Achenbach à son meilleur. Réfléchi, plein d’esprit et imprégné de la tradition philosophique européenne, il nous emmène dans sa réflexion sur les impulsions philosophiques qui sous-tendent la pratique philosophique, sur les besoins auxquels elle répond, sur la maîtrise qu’elle peut être et qu’elle exige, et il explique de manière convaincante pourquoi elle est importante aujourd’hui. Cette sélection d’essais, attendue depuis longtemps et traduite de main de maître, est une lecture incontournable pour tous ceux qui s’intéressent au conseil philosophique et, plus généralement, à la signification thérapeutique de la pensée philosophique.
— Raja Rosenhagen, Université Ashoka
« Gerd Achenbach est l’un des pionniers de la pratique philosophique. Bien que sa réputation le précède et que certains de ses ouvrages aient été traduits en anglais, Philosophical Praxis rend compte du caractère, de la philosophie et de l’esprit uniques et formidables d’Achenbach. Michael Picard a rendu un excellent service – un travail d’amour qui transparaît dans sa façon de saisir le style d’Achenbach – en rendant disponible en anglais cette précieuse contribution à la pratique philosophique. Il s’agit d’une lecture incontournable pour quiconque s’intéresse à la pratique philosophique !
— Rick Repetti, Kingsborough Community College
Philosophical Praxis, lancé par Gerd B. Achenbach en 1981, inaugure la première alternative aux pratiques thérapeutiques actuelles, en offrant un aperçu unique de l’origine fascinante et du développement d’une renaissance de la philosophie.
Gerd B. Archenbach est président de la Society of Philosophical Praxis.
Micheal Picard enseigne la philosophie au Douglas College de Vancouver, au Canada.
Table des matières
Texte original en anglais
Acknowledgments
Translator’s Note
Preface
Prelude
Chapter 1: Short Answer to the Question: What Is Philosophical Praxis?
Chapter 2: Philosophical Praxis Boast a Long Tradition, but No Paragon
Chapter 3: Philosophical Praxis Bears the Insignia of Lebenskönnerschaft
Chapter 4: Conversational Mastery
Chapter 5: The Ground-Rule of Philosophical Praxis
Chapter 6: On Beginnings
Chapter 7: Philosophy as a Profession
Chapter 8: Education and Philosophical Praxis: Søren Kierkegaard and the Question of Who Is a Philosophical Practitioner
Chapter 9: Philosophical Praxis and the Virtues
Chapter 10: What Matters? What Is Important in Truth? What Is Crucial in the End? Guiding Perspectives in Philosophical Praxis
Chapter 11: Character and Destiny: Philosophical Praxis Has Much to Learn from Schopenhauer
Chapter 12: Philosophical Praxis as an Alternative to Psychotherapy and Pastoral Care
Bibliography
About the Author and Translator
Traduction en français avec DeepL
Remerciements
Note du traducteur
Préface
Prélude
Chapitre 1 : Brève réponse à la question : Qu’est-ce que la praxis philosophique ?
Chapitre 2 : La praxis philosophique a une longue tradition, mais pas de parangon
Chapitre 3 : La praxis philosophique porte les insignes de la Lebenskönnerschaft (savoir vivre / compétences de vie ?)
Chapitre 4 : La maîtrise de la conversation
Chapitre 5 : La règle de base de la praxis philosophique
Chapitre 6 : Les débuts
Chapitre 7 : La philosophie en tant que profession
Chapitre 8 : Éducation et praxis philosophique : Søren Kierkegaard et la question de savoir qui est un praticien de la philosophie
Chapitre 9 : Praxis philosophique et vertus
Chapitre 10 : Qu’est-ce qui compte ? Qu’est-ce qui est important dans la vérité ? Qu’est-ce qui est crucial à la fin ? Perspectives directrices de la praxis philosophique
Chapitre 11 : Caractère et destin : La praxis philosophique a beaucoup à apprendre de Schopenhauer
Chapitre 12 : La praxis philosophique comme alternative à la psychothérapie et à la pastorale
Bibliographie
A propos de l’auteur et du traducteur
____________
P.S. : le mot « Lebenskönnerschaft » peut se traduire par « savoir vivre » ou « compétences de vie ».
P.S.: Le mot « praxis » peut se traduire par « pratique ».
Extraits
PHILOSOPHICAL PRACTICE
Series editor: Lydia Amir, Tufts University
The last decades have witnessed a renewed interest in the power of philosophy to address everyday problems, on both an individual and a social scale. The outcome has been a theoretical and practical field called “philosophical practice,” an original approach that highlights the timely and perennial need for philosophy. This series aims to bring to the academic public the best reflections that bear on the relation of philosophy to everyday life and to the contemporary world, as grounded in experience or arguments or both. It honors the founders of this innovative field while calling for new ways of empowering philosophy by demonstrating its relevance to individual and social concerns both inside and outside academia. It thus hopes to strengthen philosophy by bringing its potency to the attention of philosophers and scholars from other disciplines, as well as to students and the general public.
Traduction en français avec DeepL
« Les dernières décennies ont été marquées par un regain d’intérêt pour le pouvoir de la philosophie dans la résolution des problèmes quotidiens, tant à l’échelle individuelle que sociale. Il en est résulté un champ théorique et pratique appelé « pratique philosophique », une approche originale qui met en évidence le besoin actuel et permanent de philosophie. Cette série vise à mettre à la disposition du public universitaire les meilleures réflexions qui portent sur la relation de la philosophie à la vie quotidienne et au monde contemporain, qu’elles soient fondées sur l’expérience ou sur des arguments ou les deux. Elle rend hommage aux fondateurs de ce domaine novateur tout en appelant à de nouvelles façons de renforcer la philosophie en démontrant sa pertinence par rapport aux préoccupations individuelles et sociales, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du monde universitaire. Il espère ainsi renforcer la philosophie en attirant l’attention des philosophes et des chercheurs d’autres disciplines, ainsi que des étudiants et du grand public sur son potentiel. »
Titles in the Series
Philotherapy: An Integration of Psychotherapy, by Aleksandar Fatić
Philosophy in Philosophical Counseling: Unasked Questions, Open Answers, by Ora Gruengard
The Philosophy of Practical Affairs: An Introduction, by Joseph Agassi.
Acknowledgments
Texte original en anglais
Many are owed much and teeming thanks for all the aid that has been extended to help this book come to be. As translator, and on behalf of the author, I would like to recognize them all here. Though they cannot all be named, there are a few who must not go unmentioned.
Let me save the greatest debt of thanks for last, but to begin, no small thanks are due to Douglas College, where I work, for twice granting education leave (an academic year of half-time teaching duties), without which this project could not have gotten off the ground. Thanks are especially due to Dean Carla Hotel and VP-Academic Thor J. Borgford for supporting these semi-sabbaticals, as well as to the education leave committee for trusting in me twice. Much work accomplished during these two periods will appear in planned future publications, so that advance thanks for that are already in order.
To Jana Hodges-Kluck of Lexington Books we owe thanks for her stellar combination of patience and pressure. Thanks are certainly also due to Lydia Amir, who, although general editor of Lexington’s book series in Philosophical Practice, performed something closer to angel-overseer duties. A squad of Douglas College librarians, seemingly ever-ready to help, tracked down references, located existing English translations, painstakingly sought and got permissions to reprint this or that snippet, beleaguered neigh- boring universities with interlibrary loan requests, and more than once stayed open late a few minutes so I could get there to borrow a book. The tireless scholarly communications librarian, Gretchen Goertz; at interlibrary loans, the resourceful Christine Fojas; the persistent associate director of learning resources, Katherine E. Shipley; along with others at Douglas College libraries (e.g., Jacquie Ticknor and Rob Leeson-Stotesbury): all are very well aware of how I have overtaxed and overworked them these past few years, and strangely don’t seem to mind.
Special thanks are due to the poet Robert Gernhardt for his poem, Immer, which appears in translation in chapter 10, and also to his publishers, S. Fischer Verlag, for permission to publish that translation here, which, though lightly-amended, is due to Johannes Litger, whom we also thank.
For permission to print the chapter epigraphs, we are grateful to:
- The Revue de Théologie et de Philosophie, for a translation of a line from an article by Paul Ricœur from “Philosophie après Kierkegaard”;
- Standford University Press, for use of Adrian Del Caro’s translation of a line by Friedrich Nietzsche;
- Reclam, for a quotation I translated from Odo Marquard’s Der Einzelne. Vorlesungen zur Existenzphilosophie;
- Christopher Janaway and Cambridge University Press, for a quotation from the translation by Judith Norman, Alistair Welchman, and Christopher Janaway of volume 1 of Arthur Schopenhauer’s The World as Will and Representation;
- Henry W. Pickford, for permission to quote from his translation of Adorno’s Critical Models: Interventions and Catchwords;
- Polity Books, for permission to quote from Wieland Hoban’s translation of Peter Sloterdijk’s God’s Zeal: The Battle of the Three Monotheisms;
- Frederick Ungar, for a quotation from the Walter D. Morris translation of Thomas Mann’s, Reflections of a Nonpolitical Man;
- Princeton University Press, for a quotation from the David F. Swenson and Lillian Marvin Swenson translation of volume 1 of Søren Kierkegaard’s Either-Or.
Efforts—unfortunately unsuccessful—were made over the course of several months to obtain permission to use as chapter epigraph my own translation of a quotation from a publication by Hartmut von Hentig.
Thanks and perhaps an appeal for pardon are due to my family: my beloved wife, Nilu Nemati, and my long-lost and late-returned son, Arya Nemati Zardalo, who bore my extended absences while my head was in a thesaurus. I thank them for their patience and for their presence.
I have left till last the greatest debt of gratitude we owe. No one did more to make this book not only come to be, but come to be as good as it could be, than did Laura V. Adrian. A resourceful go-between for both author and translator, but also a substantial presence in all our meetings and on every resulting page, Laura richly deserves the book’s dedication and a share in its fate.
____________
P.S.: The link are added by us – Les liens sont ajoutés par nous
Traduction en français avec DeepL
Nombreux sont ceux qui doivent être remerciés pour toute l’aide qu’ils ont apportée à la réalisation de ce livre. En tant que traducteur et au nom de l’auteur, j’aimerais les remercier tous ici. Bien qu’il soit impossible de les nommer tous, il y en a quelques-uns qui ne doivent pas passer inaperçus.
Permettez-moi de garder le plus grand remerciement pour la fin, mais pour commencer, je tiens à remercier le Douglas College, où je travaille, qui m’a accordé à deux reprises un congé d’études (une année académique d’enseignement à mi-temps), sans lequel ce projet n’aurait pas pu voir le jour. Je remercie tout particulièrement la doyenne Carla Hotel et le vice-président académique Thor J. Borgford pour leur soutien à ces congés semi-sabbatiques, ainsi que le comité des congés d’études pour m’avoir fait confiance à deux reprises. Une grande partie du travail accompli au cours de ces deux périodes figurera dans les futures publications prévues, et il convient donc de les remercier d’ores et déjà.
Nous devons remercier Jana Hodges-Kluck, de Lexington Books, pour son excellente combinaison de patience et de pression. Nous remercions également Lydia Amir, qui, bien que rédactrice en chef de la série de livres de Lexington sur la pratique philosophique, a exercé des fonctions plus proches de celles d’un ange surveillant. Une escouade de bibliothécaires du Douglas College, apparemment toujours prêts à aider, a recherché des références, localisé des traductions anglaises existantes, cherché et obtenu laborieusement les autorisations de réimprimer tel ou tel extrait, harcelé les universités voisines avec des demandes de prêt entre bibliothèques et, plus d’une fois, est restée ouverte quelques minutes de plus pour que je puisse emprunter un livre. L’infatigable bibliothécaire chargée des communications savantes, Gretchen Goertz ; la débrouillarde Christine Fojas, chargée des prêts entre bibliothèques ; la tenace directrice adjointe des ressources pédagogiques, Katherine E. Shipley ; ainsi que d’autres personnes des bibliothèques du Douglas College (par exemple Jacquie Ticknor et Rob Leeson-Stotesbury) : tous sont parfaitement conscients de la façon dont je les ai surchargés de travail et de travail ces dernières années, et, étrangement, ne semblent pas s’en préoccuper.
Nous remercions tout particulièrement le poète Robert Gernhardt pour son poème Immer, dont la traduction figure au chapitre 10, ainsi que son éditeur, S. Fischer Verlag, pour avoir autorisé la publication de cette traduction, qui, bien que légèrement modifiée, est due à Johannes Litger, que nous remercions également.
Pour l’autorisation d’imprimer les épigraphes des chapitres, nous sommes reconnaissants à :
- The Revue de Théologie et de Philosophie, for a translation of a line from an article by Paul Ricœur from “Philosophie après Kierkegaard”;
- Standford University Press, for use of Adrian Del Caro’s translation of a line by Friedrich Nietzsche;
- Reclam, for a quotation I translated from Odo Marquard’s Der Einzelne. Vorlesungen zur Existenzphilosophie;
- Christopher Janaway and Cambridge University Press, for a quotation from the translation by Judith Norman, Alistair Welchman, and Christopher Janaway of volume 1 of Arthur Schopenhauer’s The World as Will and Representation;
- Henry W. Pickford, for permission to quote from his translation of Adorno’s Critical Models: Interventions and Catchwords;
- Polity Books, for permission to quote from Wieland Hoban’s translation of Peter Sloterdijk’s God’s Zeal: The Battle of the Three Monotheisms;
- Frederick Ungar, for a quotation from the Walter D. Morris translation of Thomas Mann’s, Reflections of a Nonpolitical Man;
- Princeton University Press, for a quotation from the David F. Swenson and Lillian Marvin Swenson translation of volume 1 of Søren Kierkegaard’s Either-Or.
Des efforts—malheureusement infructueux—ont été déployés pendant plusieurs mois afin d’obtenir l’autorisation d’utiliser, en guise d’épigraphe de chapitre, ma propre traduction d’une citation tirée d’une publication de Hartmut von Hentig.
Des remerciements, voire une demande de pardon, sont sans doute dus à ma famille : ma chère épouse, Nilu Nemati, et mon fils longtemps perdu puis tardivement retrouvé, Arya Nemati Zardalo, qui ont supporté mes longues absences alors que mon esprit était plongé dans un thésaurus. Je les remercie pour leur patience et leur présence.
J’ai gardé pour la fin la plus grande dette de gratitude qui nous incombe. Nul n’a fait davantage pour que ce livre non seulement voie le jour, mais atteigne toute la qualité dont il était capable, que Laura V. Adrian. À la fois intermédiaire ingénieuse entre l’auteur et le traducteur et présence essentielle à chacune de nos rencontres et sur chaque page de ce livre, Laura mérite amplement la dédicace qui lui est adressée ainsi qu’une part de son destin.
Preface
Texte original en anglais
To ‘Upper America’—as I would like to call the northern half of the American continent—belongs the honor in the last century of having originated, within the wide, perhaps over-extended terrain of the schools of psychotherapy, certain essential inspirations and innovations which were later taken up in Europe and adapted to the old European way. This is not to deny that Vienna (above all) and Switzerland are the birthplace of the original forms of all later therapies—Freud’s psychoanalysis, C. G. Jung’s analytical psychology, and Adler’s individual psychology. Significant further developments from this triple root then spread to North America; it is enough to recall the innumerable variants of so-called “humanistic psychology.”
And now it looks as if this back-and-forth inter-continental movement is swinging back again. This time it is the renewal of the practice of philosophy, which in 1981 I called into being as Philosophical Praxis1 in Germany, but which very quickly gained a foothold in the neighboring European countries—first of all in Austria and the Netherlands—and then very soon spread from the old continent across the pond into the ‘New World.’ There it gained attention and recognition in its own right, first in Vancouver, Canada (where in 1994 the First International Congress for Philosophical Practice2 took place at the University of British Columbia), and then shortly thereafter in New York by Lou Marinoff,3 who in 1999 wrote Plato, Not Prozac! Applying Philosophy to Everyday Problems. Thanks in no small part to English being the current lingua franca, this in turn bolstered the presence of Philosophical Praxis worldwide.
It is therefore all the more urgent to make a small selection of writings available in the language now advanced to a near universal idiom—texts that, while founding Philosophical Praxis, initiated a revival of the oldest philosophical impulses. The significance of this latest rebirth of philosophy out of the spirit of its original endeavor to create an exemplary form of life—as understood in antiquity and made contemporary by Pierre Hadot4 and Michel Foucault5—is by no means limited to a mere return in practical terms to the original mission and aspiration of philosophy. Rather, the proper task of this new configuration of philosophy is to establish itself as the first real alternative to ‘therapy-culture.’ Those who might hitherto have gone into therapy will more and more turn to the philosopher-practitioner in their distress. Thus, the practice of philosophy, for the first time ever, opens up the possibility of establishing itself as a proper profession.
From amongst my publications6 devoted to this rebirth of philosophy, or intellectually paving the way for it, I have endeavored to select pieces that would offer philosophically interested people in the Anglo-American world some insight into this pioneering project. And now I am sending these texts, accompanied by friendly greetings, to the Western continent, from which the call to Philosophical Praxis may go out to all parts of the world.
However, I must not hand over the typescript of this book without expressly thanking three people.
First and foremost, to my friend—and companion since we met at the International Congress of Philosophical Praxis in Mexico—Michael Picard, the philosophical practitioner and professor of philosophy at Douglas College in Vancouver, who devoted himself with never-flagging love and veritably angelic patience to the extraordinarily daunting task of translating the texts collected here into subtly tempered English of equal rank. This required not only an extremely sensitive knowledge of the language, but at the same time also confronted him as translator with the almost insurmountable task of bridging—if at all possible, even partially overcoming—the peculiar gulf that separates Anglo-American cultural space and understanding from that of continental Europe. Such a task could hardly be accomplished by even a Hermes. Secondly—and in the same breath, so to speak—my heartfelt thanks go to my wife, Laura V. Adrian, who has been equally tireless in her support of Michael during this months-long translation marathon. In countless meetings, most of which lasted many hours, they jointly wrangled to determine the best rendering in each case. Thanks to her extraordinary expertise in Philosophical Praxis, as well as her truly sublime sense of language, she was called upon to do this as no one else could have.
Last but not least, we would all like to thank our American-Israeli colleague Professor Lydia Amir, both generally for her unparalleled contributions to Philosophical Practice—with worldwide impact—but also particularly for her editorship of this Lexington Books series in Philosophical Practice, which this book, but for unavoidable delays, was to inaugurate.
Gerd B. Achenbach Preface
____________
NOTES
1 Odo Marquard, “Praxis, Philosophische.” In the Historischen Wörterbuch der Philosophie, ed. Joachim Ritter et al., Vol. VII (Basel, 1989), 1307f. Also accessible online at http://www.achenbach-pp.de/.
3 Lou Marinoff, Plato, Not Prozac! Applying Philosophy to Everyday Problems (New York, 1999).
4 Pierre Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique (Paris: Etudes augustiniennes, 1981). Several of Hadot’s books have appeared in English, most notably (translated by Michael Chase): Philosophy as a Way of Life (Oxford: Blackwell, 1995); The Inner Citadel: the Meditations of Marcus Aurelius (Harvard University Press, 1998); What is Ancient Philosophy? (Harvard University Press, 2002). See the bibliography for full details and other works.
5 Michel Foucault, Histoire de la sexualité, vol. 1: La volonté de savoir, 1976, vol. 2: L’usage des plaisirs, 1984, and especially vol. 3: Le souci de soi, 1984. These volumes appeared respectively in English (translated by Robert Hurley) as: The History of Sexuality (New York: Vintage, 1980); The Use of Pleasure (Vintage, 1985); Care of the Self (Vintage, 1986). See the bibliography for full details.
6 Gerd B. Achenbach, Philosophische Praxis (Köln: Verlag für Philosophie/Dinter, 1984, 2nd ed., 1987); with T. H. Macho, Das Prinzip Heilung (Köln: Verlag für Philosophie/Dinter, 1985); Das kleine Buch der inneren Ruhe (Freiburg: Herder, 2000; rev. and exp., 2016); Lebenskönnerschaft (Freiburg: Herder, 2001; Köln: Dinter, 2010); Vom Richtigen im Falschen (Freiburg: Herder, 2003; Köln: Dinter, 2014); Zur Einführung der Philosophischen Praxis (Köln: Dinter, 2010); On Right in Wrong. Trans. by Michael Picard (Lanham, MD: Lexington Books, forthcoming). See the bibliography for full details.
Traduction en français avec DeepL et ChatGPT
C’est à la « Haute Amérique » – comme j’aimerais appeler la moitié nord du continent américain – que revient l’honneur d’avoir été à l’origine, au siècle dernier, sur le vaste terrain, peut-être trop étendu, des écoles de psychothérapie, de certaines inspirations et innovations essentielles qui ont été reprises plus tard en Europe et adaptées à l’ancienne manière européenne. Il ne s’agit pas de nier que c’est à Vienne (surtout) et en Suisse que sont nées les formes originales de toutes les thérapies ultérieures – la psychanalyse de Freud, la psychologie analytique de C. G. Jung et la psychologie individuelle d’Adler. Des développements significatifs de cette triple racine se sont ensuite répandus en Amérique du Nord ; il suffit de rappeler les innombrables variantes de ce que l’on appelle la « psychologie humaniste ».
Or, il semble que ce mouvement intercontinental de va-et-vient soit en train de repartir dans l’autre sens. Cette fois, il s’agit du renouveau de la pratique de la philosophie, que j’ai instaurée en 1981 en Allemagne sous le nom de Praxis philosophique. Celle-ci s’est rapidement implantée dans les pays européens voisins—d’abord en Autriche et aux Pays-Bas—avant de traverser l’Atlantique pour gagner le « Nouveau Monde ». Elle y a suscité attention et reconnaissance, d’abord à Vancouver, au Canada (où s’est tenu en 1994 le premier Congrès international de pratique philosophique à l’Université de la Colombie-Britannique), puis peu après à New York, grâce à Lou Marinoff, qui publia en 1999 Plato, Not Prozac! Applying Philosophy to Everyday Problems. Grâce, en grande partie, au fait que l’anglais est aujourd’hui la lingua franca, cet essor a contribué à la diffusion mondiale de la Praxis philosophique.
Il devient donc d’autant plus urgent de rendre disponible une sélection de textes dans cette langue qui tend désormais à s’imposer comme un idiome quasi universel—des textes qui, tout en fondant la Praxis philosophique, ont initié une renaissance des plus anciennes impulsions philosophiques. L’importance de cette dernière renaissance de la philosophie, conçue comme un art de vivre exemplaire—ainsi qu’elle était comprise dans l’Antiquité et que Pierre Hadot et Michel Foucault l’ont réactualisée—ne se limite en aucun cas à un simple retour aux aspirations originelles de la philosophie sous une forme pratique. La véritable mission de cette nouvelle configuration philosophique est plutôt de s’établir comme la première véritable alternative à la « culture thérapeutique ». Ceux qui, jusqu’ici, se seraient tournés vers la thérapie se tourneront de plus en plus vers le praticien-philosophe dans leur détresse. Ainsi, la pratique de la philosophie ouvre, pour la première fois, la possibilité de se constituer en véritable profession.
Parmi mes publications consacrées à cette renaissance philosophique, ou intellectuellement préparatoires à celle-ci, j’ai tenté de sélectionner des écrits susceptibles d’offrir aux esprits philosophiquement curieux du monde anglo-américain un aperçu de ce projet novateur. Et c’est ainsi que j’envoie aujourd’hui ces textes, accompagnés de salutations amicales, vers le continent occidental, d’où l’appel à la Praxis philosophique pourra se propager aux quatre coins du monde.
Cependant, je ne saurais remettre le manuscrit de ce livre sans exprimer ma gratitude envers trois personnes.
En tout premier lieu, à mon ami et compagnon de route depuis notre rencontre au Congrès international de pratique philosophique au Mexique, Michael Picard, praticien-philosophe et professeur de philosophie au Douglas College de Vancouver. Il s’est consacré avec un amour inlassable et une patience quasi angélique à la tâche redoutable de traduire ces textes dans un anglais finement nuancé et d’égale dignité. Cela exigeait non seulement une connaissance extrêmement sensible de la langue, mais aussi d’affronter le défi quasi insurmontable de combler—ou du moins d’atténuer—le gouffre singulier qui sépare l’espace culturel et intellectuel anglo-américain de celui de l’Europe continentale. Une tâche qu’à peine même un Hermès aurait pu accomplir.
Ensuite—et dans le même souffle, pour ainsi dire—mes plus sincères remerciements vont à mon épouse, Laura V. Adrian, qui a tout autant soutenu Michael au cours de ce marathon de traduction de plusieurs mois. À travers d’innombrables séances de travail, souvent longues de plusieurs heures, ils ont lutté ensemble pour déterminer la meilleure formulation en chaque cas. Grâce à son expertise exceptionnelle en Praxis philosophique ainsi qu’à son sens véritablement sublime de la langue, elle était la personne toute désignée pour ce rôle.
Enfin, nous souhaitons tous exprimer notre gratitude à notre collègue américano-israélienne, la professeure Lydia Amir, tant pour sa contribution inégalée à la pratique philosophique—dont l’impact est mondial—que pour son rôle particulier de directrice de cette collection en Praxis philosophique chez Lexington Books, laquelle devait être inaugurée par cet ouvrage, n’eussent été des retards inévitables.
Prelude
Texte original en anglais
With dubious persistence, voices here and there are raised calling for a ‘theory of Philosophical Praxis.’ And I have made a habit of ignoring such voices with equal and opposite persistence. For what should we say to them, if pre-educated people—nota bene: their pre-education is their problem1—if scientifically trained people think that they cannot know what Philosophical Praxis is until they are in possession of a ‘theory’ of it? These unfortunate friends of theory are like those who find themselves in a most beautiful land- scape, take a look around, then declare that they see nothing because they possess no map of it.
Perhaps we do yet better to construe such persistence as the contemporary rule over our minds of the algorithm, if indeed its reign has not already been instituted within them. Thereunder it holds true: one ‘understands’ only in knowing the schema according to which processes run. We can do no better than the telling analogy of process engineering.
Yet I feel like asking those askers: have any of you who demand a ‘theory’ of Philosophical Praxis ever heard tell of a ‘theory of philosophy’? Unlikely, I should think. Still, it is possible—after all, one does read all sorts of things! In that case, the one who poses the question (and—even more so—the one who is subjected to it) would do us all a favor by leaving such ‘contributions to research’ on the dusty library shelves where they may be abandoned without causing any harm.
No—in the spheres of philosophy the contrary has always held true: the philosopher thinks and at the same time bethinks his thinking and even, within his thinking, the very possibility of thinking as such. Thus not only has he no need of the well-worn rut that keeps the theory-driven man in his predetermined path; on the contrary, such constraints would lie upon him as a yoke, and he would feel as if bound in fetters by the head and limbs. Let us not shy away from one of the leading ideas of the philosophical tradition: whereas others fancy themselves safe and secure at the end of the leash of a chosen theory, the philosopher suffers from the loss of that freedom, without which thinking wastes itself away in mere correctness until it degenerates at last into dull routine, and finally dies.
In order to forestall a widespread misunderstanding: the responsibility of the philosopher is not only, possibly not even primarily, to what he ‘thinks’ but instead to rethink, to become thoughtful, or—to resort to quaint old terms—to become judicious. Under this mandate, wherever possible, he rescues thoughts trapped under rubble, and pries open new springs of dried-up thinking, that they may once again begin to flow.
What’s more: taken in its widest scope, such thinking is not a ring-fenced nature park in which the philosopher would let himself be confined. On the contrary: he feels; senses; looks; detects; suspects; sees coming; distrusts and believes; fears, trembles and hopes; remembers the forgotten; calls attention to the overlooked; insists where others are ‘already further along’; irritates the questions whose answers are already known; keeps calm when the armies march; makes a fuss where others look aside—in sum: he lives, and it does not elude him that, or how, he lives. That is his base, that is where he gathers experiences. But here I break off, though clearly enough this list could be extended ad libitum.
Only one more point to be noted at this juncture: the domain of philosophy is no longer that of ‘knowledge’ [Wissens]—or, as one would say today to preserve generality, ‘putative’ knowledge. It is this that accounts for why it no longer misconceives itself as sister to the sciences, but rather is to be found in the neighborhood of the arts, of music, and of a literature that in its own way aspires to be knowledge [Erkenntnis].
So, instead of glorying in conquests within the narrow, stipulatory quarters of Knowledge,2 a philosophy that must stand the test of practice, in which the figure of the philosopher-practitioner attends to the cares and needs of the people who turn to us—such a philosophy at least comes down to deliberate bearing, learned kindness,3 and a self-wrought constitution; in other words: to being granted entry into the realm of education where we can come to be at home, as well in the here-and-now as in past ages.
What this means in relation to the guest in our practice is that we are challenged to do what the typical academically refined seminar graduate is least able to do. Even as Orpheus once followed his Eurydice, so too the philosophical practitioner must find his way to, and then within, the world in which his guest has entangled himself, or has been entangled, and in which he endures, hoping for a way out.
There we find him and take him with us to where doors are open to him, if he dares to go with us and is able to do so. So we ourselves become for him what, according to Schopenhauer’s deeply thought image, Death is to every rigorous, non-indulgent philosophizing: namely, Apollo Musagetes, Apollo as Leader of the Muses. He, however, does not lead us down into the lightless realm of shadows, but awakens us as one and guides us up into the well-woven vivifying spirit realm, which awaits and now warmly welcomes and receives the philosophers.
What, finally, will I then say, if there continues to be a demand for a ‘theory of Philosophical Praxis,’ as can be assumed with sad certainty?
I will say: The reply must be efforts toward a philosophy of Philosophical Praxis, the pieces of which are nothing but essays (in the literal sense) put together to form a polyphonic fugue.
It may also be said, however, that the essays I gather here are harvest bounty, as they certainly did not fall by chance to one who over a period of forty years labored to harrow, sow, and reap, which has been both an honor and a limitation. The individual—to speak exactly, the unique—preconditions that I as a particular being bring forward have bathed the newly opened terrain in a light, the color of which is completely tempered personally. This rules out that any training in theory could suffice for a subordinate practice, or for the creation of application-oriented methods as a helping hand to zealous ‘practitioners.’
At the same time, the texts in this book are so many contributions to a conversation that has already been going on for decades, first in the form of a series of colloquia organized with international participation by the Gesellschaft für Philosophische Praxis founded in 1982 in Bergisch Gladbach;4 but then above all in the ever-expanding context of the (so far) seventeen international congresses on Philosophical Praxis.5
It was to be expected that straight away—as per usual: as soon as academics meet on the public scene—‘trends’ emerged, in the worst case even so-called ‘schools,’ which may offer a certain identity-insurance to those who find shelter there, even if a truly independent, self-responsible, especially philosophically imbued thinking has always eschewed such comforts.6
With fitting seriousness, however, it ought at least to be noted that Philosophical Praxis is attracting attention in seemingly philosophically distant but practically engaged, scientifically ambitious circles; for instance, when it comes to providing a ‘philosophical foundation’ for the ‘counseling professions’7 or entering into conversation with psychotherapeutically oriented practitioners.8
Most significantly, however, the importance of Philosophical Praxis is now increasingly being perceived in medical circles, where doubts about the ‘scientific turn’ that occurred in the nineteenth century are emerging and, in the wake of this, a renewed insistent interest in philosophy in practical terms is emerging.9
It remains to be seen to what extent Philosophical Praxis will succeed in being taken up with prestige at high schools—as is already the case at numerous universities worldwide,10 though so far not yet in its ‘home country.’
The conviction may even be argued for: however much Philosophical Praxis has to learn from academic philosophy, there is very likely far more that university-established philosophy has to learn to its own benefit from the experiences in Philosophical Praxis, if only it opens itself to them. Undoubtedly there are already plenty of confidence-building examples. For it suffices only to recall Montaigne, Pascal, Spinoza, Schopenhauer, Kierkegaard, and Nietzsche, to show that the fire of philosophy often first blazed outside the walled-in academy before advancing as a revitalizing force into the well-kept fortress of higher learning.
And it is the spirit that scales all walls.
From Vienna, May 2023
____________
NOTES
1 Pre-education—Vorbildung; pre-educated—vorgebildete. This mocking concept ought to be understood over against the central role in Achenbach (and in this book) of Bildung (education, culture, self-formation); see especially chapter 8, notes 3, 8 and 30–33. The notion may also be profitably juxtaposed with Vorbild, the paragon, standard-bearer or role model, the existence of which for the philosophical practitio- ner Achenbach denies (as for example in the very title of chapter 2).
2 Narrow, stipulatory quarters of Knowledge—ausbedungenen Wissensquartieren.
3 Kindness—Gesonnenheit. An Achenbach construction derived from the expression, “wohl gesonnnen,” meaning well-disposed. It is a benevolent solicitude toward a situated individual. “Self-wrought constitution” is “erlangte Verfassung.”
4 See the documentation of the early years in the Kleine Chronik der Philosophische Praxis, 1981–1995, which is available online at https://www.achenbach-pp.de.
5 In Vancouver (1994), Leusden/Netherlands (1996), New York (1997), Bergisch Gladbach (1998), Oxford (1999), Oslo (2001), Copenhagen (2004), Seville (2006), Carloforte/Italy (2008), Leusden (2010), Chuncheon/Korea (2012), Athens (2013), Belgrade (2014), Bern (2016), Mexico City (1018), Petersburg (2021), and Timisoara/ Romania (2023); see the website at https://icpp.site/.
6 Donata Domizi, Philosophische Praxis. Eine Standortbestimmung, Information Philosophie, Heft 4 (2019), 86–94.
7 See, for example: Luitgard Brem-Gräser, Handbuch der Beratung für helfende Berufe, 3 vols. (Munich-Basel: 1993), most notably volume 1, pages 121–131.
8 See psycho-logik. Jahrbuch für Psychotherapie, Philosophie und Kultur. Pub- lished since 2006 in Freiburg-München by Karl Alber Verlag.
9 A representative selection: Klaus Dörner, Der gute Arzt. Lehrbuch der ärztli- chen Grundhaltung, 2nd ed. (Stuttgart: Schattauer, 2003), therein especially: Sorge um mich selbst. / Das gute Leben / Medizin als Philosophie / Philosophische Grundhaltung des Arztes. But see also the volumes edited by Giovanni Maio, Auf den Menschen hören. Für eine Kultur der Aufmerksamkeit in der Medizin (Freiburg- Basel-Vienna: Herder, 2017) and Vertrauen in der Medizin. Annäherungen an ein Grundphänomen menschlicher Existenz (Freiburg-Basel-Vienna: Herder, 2023). One may also consult G. B. Achenbach, “Aussichten auf ein Ende des kalten Krieges im Reich der Medizin. Philosophisches Plädoyer für eine praktische Weisheit, die den Streit der Theorien schlichtet,” in Patientenorientierung und Professionalität, edited by Peter F. Matthiessen, 2nd expanded ed. (Bad Homburg: Verlag Akademishe Schriften, 2011); and G. B. Achenbach, “Der Patient und sein Arzt,” in Ärztekammer Nordrhein: Kommunikation, 117. Deutscher Ärztetag (Düsseldorf: 2014), 67–92.
10 Thus, among others, in the University of Tokyo, Kyungpool National Uni- versity, Korea Counseling Graduate University, Catholic University of Portugal, Ca’Foscari University for Venice, University of Roma 3, Université de Liège, Uni- versity of Vienna, Timisoara University/Romania, Institute of Psycoanalysis/Russia, Milkwaukee School of Engineering/USA, Universidad Vasco de Quiroga/Mexico, National University of Buenos Aires, Universidad de Chile, and University of the State of Rio de Janeiro. (List incomplete.)
Traduction de l’anglais au français avec ChatGPT
Avec une persistance douteuse, des voix s’élèvent ici et là pour réclamer une « théorie de la Praxis philosophique ». Et j’ai pris l’habitude d’ignorer ces voix avec une persistance tout aussi résolue. Que devrions-nous leur répondre, si des personnes préformées—nota bene : leur préformation est leur problème—si des personnes formées scientifiquement estiment qu’elles ne peuvent savoir ce qu’est la Praxis philosophique tant qu’elles ne disposent pas d’une « théorie » à son sujet ? Ces malheureux amis de la théorie ressemblent à ceux qui, se trouvant dans un paysage des plus magnifiques, regardent autour d’eux et déclarent ne rien voir parce qu’ils ne possèdent aucune carte du lieu.
Peut-être vaut-il mieux encore interpréter une telle persistance comme le signe de la domination contemporaine de l’algorithme sur nos esprits, si tant est que son règne n’y soit pas déjà établi. Selon cette logique, on ne « comprend » qu’en connaissant le schéma selon lequel les processus s’exécutent. Nous ne saurions trouver meilleure analogie que celle de l’ingénierie des processus.
J’ai pourtant envie de demander à ceux qui réclament une « théorie » de la Praxis philosophique : l’un d’entre vous a-t-il jamais entendu parler d’une « théorie de la philosophie » ? J’en doute fort. Il se peut, bien sûr—après tout, on lit de tout ! Mais dans ce cas, celui qui pose la question (et—plus encore—celui qui en est la cible) nous rendrait à tous service en laissant ces « contributions à la recherche » sur les rayonnages poussiéreux des bibliothèques, où elles peuvent être abandonnées sans causer le moindre dommage.
Non—dans le domaine de la philosophie, c’est l’inverse qui a toujours prévalu : le philosophe pense et, en même temps, réfléchit à sa pensée et même, dans sa pensée, à la possibilité même de penser. Ainsi, non seulement il n’a nul besoin de l’ornière qui maintient l’homme obsédé par la théorie sur son chemin prédéterminé, mais, bien au contraire, un tel carcan serait pour lui un joug, une entrave qui le lierait tête et membres. N’hésitons pas à rappeler l’une des idées directrices de la tradition philosophique : tandis que d’autres se croient en sécurité, attachés à la laisse d’une théorie choisie, le philosophe souffre de la perte de cette liberté, sans laquelle la pensée se réduit à une simple conformité jusqu’à dégénérer en routine stérile, puis s’éteindre.
Afin de prévenir tout malentendu répandu : la responsabilité du philosophe ne réside pas uniquement, et peut-être même pas principalement, dans ce qu’il « pense », mais dans sa capacité à repenser, à devenir réfléchi, ou—pour reprendre d’anciens termes devenus rares—à faire preuve de jugement. Sous cette exigence, il secourt, chaque fois que possible, les pensées ensevelies sous les décombres, et rouvre de nouvelles sources de pensée taries, afin qu’elles recommencent à couler.
Mieux encore : pris dans son acception la plus large, un tel penser n’est pas un parc naturel délimité dans lequel le philosophe se laisserait enfermer. Au contraire, il ressent ; il perçoit ; il observe ; il détecte ; il soupçonne ; il anticipe ; il se méfie et il croit ; il craint, tremble et espère ; il se souvient de l’oublié ; attire l’attention sur ce qui a été négligé ; insiste là où d’autres « sont déjà plus loin » ; perturbe les questions dont les réponses sont déjà établies ; garde son calme quand les armées marchent ; fait du bruit là où d’autres détournent le regard—en somme : il vit, et il ne lui échappe ni le fait qu’il vit, ni la manière dont il vit. Voilà son socle, c’est là qu’il puise son expérience. Mais je m’arrêterai ici, bien que cette liste puisse manifestement être poursuivie ad libitum.
Une dernière remarque s’impose cependant à ce stade : le domaine de la philosophie ne relève plus de la « connaissance » (Wissen)—ou, pour parler en termes contemporains plus généraux, de la « pseudo-connaissance ». C’est précisément pour cette raison qu’elle ne se méprend plus elle-même comme une sœur des sciences, mais qu’elle se situe désormais dans le voisinage des arts, de la musique et d’une littérature qui, à sa manière, aspire à être une forme de connaissance (Erkenntnis).
Ainsi, au lieu de s’enorgueillir de conquêtes dans l’étroite enceinte de la Connaissance, une philosophie qui doit faire ses preuves dans la pratique, où le praticien-philosophe s’occupe des préoccupations et des besoins de ceux qui viennent à lui, repose au moins sur une posture délibérée, une bienveillance cultivée et une constitution forgée par soi-même ; en d’autres termes : sur une entrée accordée dans le domaine de l’éducation, où l’on peut véritablement se sentir chez soi, autant dans le présent que dans les âges passés.
Appliqué à l’invité de notre pratique, cela signifie que nous sommes mis au défi d’accomplir ce dont le diplômé académique raffiné est le moins capable. Tout comme Orphée suivait jadis son Eurydice, le praticien-philosophe doit, lui aussi, retrouver le chemin du monde dans lequel son invité s’est embourbé, ou a été embourbé, et dans lequel il demeure, espérant une issue.
C’est là que nous le trouvons et l’emmenons vers un lieu où des portes lui sont ouvertes, s’il ose nous suivre et s’il en est capable. Ainsi, nous devenons pour lui ce que, selon l’image profondément méditée de Schopenhauer, la Mort est pour tout philosophe rigoureux et intransigeant : à savoir, Apollon Musagète, Apollon chef des Muses. Cependant, celui-ci ne nous mène pas vers l’obscur royaume des ombres, mais nous éveille un à un et nous guide vers le lumineux royaume de l’esprit vivifiant, qui attend les philosophes et les accueille chaleureusement.
Que dirai-je enfin, si la demande d’une « théorie de la Praxis philosophique » persiste, comme on peut tristement le présumer ?
Je dirai : La réponse doit être un effort vers une philosophie de la Praxis philosophique, dont les fragments ne sont rien d’autre que des essais (au sens propre du terme) formant ensemble une fugue polyphonique.
On peut également dire que les essais que je rassemble ici sont le fruit d’une récolte, puisqu’ils ne sont certainement pas tombés par hasard entre les mains de celui qui, pendant quarante ans, a labouré, semé et moissonné—ce qui a été à la fois un honneur et une contrainte. Les conditions individuelles—ou, pour être exact, uniques—que j’apporte en tant qu’être singulier ont baigné ce terrain nouvellement ouvert d’une lumière dont la teinte est entièrement marquée par ma personne. Cela exclut qu’une formation théorique puisse suffire à une pratique subordonnée ou à la création de méthodes applicatives mises à la disposition de praticiens zélés.
En même temps, les textes de ce livre constituent autant de contributions à une conversation qui dure depuis des décennies, d’abord sous la forme d’une série de colloques internationaux organisés par la Gesellschaft für Philosophische Praxis, fondée en 1982 à Bergisch Gladbach ; puis, surtout, dans le cadre toujours plus large des dix-sept congrès internationaux (jusqu’à présent) sur la Praxis philosophique.
Il était à prévoir que, dès l’instant où des universitaires se rencontrent sur la scène publique, des « tendances » émergent, voire, dans le pire des cas, des « écoles », offrant un certain refuge identitaire à ceux qui s’y abritent, même si une pensée véritablement indépendante, responsable et surtout philosophique a toujours fui ces conforts.
Cependant, il convient au moins de noter avec le sérieux approprié que la Praxis philosophique attire l’attention de cercles a priori éloignés de la philosophie, mais engagés dans la pratique et ambitieux scientifiquement.
Et c’est bien l’esprit qui franchit tous les murs.
Vienne, mai 2023
Chapter 1
Texte original en anglais
Short Answer to the Question: What Is Philosophical Praxis?
One must make something new to see anything new.
—Lichtenberg1
I started the world’s first Philosophical Praxis in 1981,2 and coined the term that same year.3 In 1982 the Society for Philosophical Praxis was instituted in Bergisch Gladbach near Cologne; later it became the international umbrella organization for numerous national societies. So much for the institutional part. Now for the question: What, in short, is Philosophical Praxis?
The philosophical life-counseling that takes place in Philosophical Praxis establishes itself as an alternative to psychotherapies. It is an adaptation for those who, tormented by their sorrows or problems, and unable to ‘come to terms’ with their lives, find themselves somehow ‘stuck.’ Philosophical Praxis is for people beset by life-questions that they can neither solve nor get rid of, or for those who are able to prove themselves equal to everyday life, but nevertheless feel ‘under-burdened,’ perhaps because they suspect that their reality does not correspond to their potential. Others turn to Philosophical Praxis when they are not satisfied merely to exist or muddle through, but demand instead to examine their life, to see clearly its contours, its whence and why and whither-to.
Their need is often simply to reflect on the unique circumstances, the peculiar entanglements, and the often oddly ambiguous course of our lives. Briefly put, people seek out practicing philosophers because they want to understand and to be understood. They almost never arrive with the Kantian question “What ought I do?”4 but rather with the question of Montaigne, which runs: “What am I doing?”5 Perhaps in the background, operative as an insight, lurks that most ancient philosophical wisdom—namely the maxim of Socrates, that only the examined life is worth living. It may make its presence felt as a shadowy fear that a life so ‘lifeless’ is hardly even lived at all, and instead somehow ‘wasted,’ ‘forfeit,’ ‘squandered’—a life about to undo itself. Schopenhauer:
Most people, when they look back at the end, find that they have lived their whole life through provisionally, and are amazed to see that what they allowed to pass by so unappreciated and unenjoyed was their very life, the very thing in whose expectation they lived. And so the course of one’s life, as a rule, is such that, made a fool of by hope, one dances into the arms of death.6
Whoever has shared this terrifying prospect may through philosophical reflection find the burden of life appear like a promise [Verheißung]; for the philosophical attitude to life is in fact—like a promise—a respectful overburdening that lends gravity to our existence, a sense to our being here, and a meaning to our present.
Usually there are distinctive occasions which bring the guest to the decision to consult the philosophical practitioner. Commonly they involve disappointments, unforeseen or at least unexpected experiences, clashes with other people, strokes of fate, the experiences of failure, importunate or just plain blah life-outcomes. In such circumstances, one assumes (however unclearly) the task of Philosophical Praxis, as outlined by Sir Karl Popper before the practice even existed:
We all have our philosophies, whether or not we are aware of this fact, and our philosophies are not worth very much. But the impact of our philosophies upon our actions and our lives is often devastating. This makes it necessary to try to improve our philosophies by criticism. This is the only apology for the continued existence of philosophy which I am able to offer.7
If we are to be concise here, we must ask: in what way do practicing philosophers help their visitors along? The usual way to frame the question is con- fusing: ‘what method do practical philosophers follow?’ To speak correctly, philosophy works not with, but at best upon methods. Obedience to method is the pride of the sciences, not the point of philosophy. Philosophical thinking does not move along ready-made paths; it looks anew in each case for the ‘right way.’ Rather than deploy well-worn thought-routines, it sabotages them to clarify itself.
It is not a matter of leading guests of Philosophical Praxis on a philosophically predetermined course, but rather of helping them along their own way. Incidentally, this presupposes on the part of the philosopher the ability to appreciate others without necessarily agreeing with them; indeed, as Goethe said, in a way that “neither approves nor censures.”8
Philosophy cannot simply be ‘applied,’ as if the concerns brought by the guest could be ‘treated’ with a dose of Plato, or Hegel or whomever else. Philosophical readings are not remedies to be prescribed. Does the patient go to the doctor to take in a medical lecture? Nor should the visitor to Philosophical Praxis be taught by the philosopher, still less deceived by clever words, and certainly not served up with theories. The question is whether the philosopher, through their own reading, has become wise and understanding and attentive, whether they have acquired in this way a sensitivity for the otherwise well-overlooked, and learned to become at home in wayward and offbeat thinking, feeling, and judgment. For only as co-thinker and sympathizer can one liberate visitors from their loneliness—or forlornness—and thus perhaps to move them to other appraisals of life and its circumstances.
Isn’t it the same for psychologists and psychotherapists? For the pastor, too? The question inevitably arises—a sign of our yet blooming therapeutic culture—as to the boundary between Philosophical Praxis and psychotherapies. The psychologist and psychotherapist are specialists, specially trained to perceive the specific in a special way, specifically psychogenic or psycho- logically conditioned disorders. Where they are not specialists, they are dilettantes. Paradoxically, the philosopher is a specialist in the non-special, both the general and the plain (as well as in the rich tradition of reasoned thought), but also in the contradictory and the deviant, with particular emphasis on the individual and the unique.
In this way, the philosopher in practice takes visitors seriously: not in the grips of any theory (that is, not through schematic understanding) and not as a mere ‘instance of a rule,’ but as this very one. No value scale is held over above the visitor, not even that of health. The question is whether visitors are living up to themselves or, to paraphrase Nietzsche’s famous words, whether they have become who they are.
It should be added that Philosophical Praxis by no means only takes the form of individualized consultations. It also supports companies, organizations and associations in their attempts to find their mission, sound principles and orienting guidelines.
____________
NOTES
1 Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbücher, Heft J, 1756–1770, No. 1770. Picard Translation.
2 See Odo Marquard, “Praxis, Philosophische.” In the Historischen Wörterbuch der Philosophie, ed. Joachim Ritter et al., Vol. VII (Basel, 1989), 1307f.
3 This chapter was previously translated by Dr. Patrick Neubauer. That translation was consulted but little used and not relied upon.
4 “1) What can I know? 2) What should I do? And 3) What may I hope?” Imman- uel Kant, The Critique of Pure Reason. Trans. by Paul Guyer and Allen W. Wood. (CUP, 1998), A805/B833.
5 What Achenbach calls “the question of Montaigne” is not the question “Que sçais-je?” or, “What do I know?” that Montaigne took “as a motto, inscribed over a pair of scales” (Apology for Raymond Sebond, in The Complete Essays of Mon- taigne, Donald Frame translation [Standford University Press, 1958], 392–393), and which is often called ‘the question of Montaigne.’ That question, as Montaigne tells us, expresses his dalliance with “the Pyrrhonian philosophers.” But the ques- tion Achenbach considers to be far more characteristic of Montaigne than even his motto arises often enough in the Essays, and is decidedly less epistemic; it asks after self-understanding in action: ‘What am I actually doing?’ (“Was tue ich eigentlich?”). Montaigne: “I do not make it my business to tell the world what it should do—enough others do that—but what I do in it.” Essays, I, 142. Look also to “On some verses of Virgil,” Essays, III for illustration: “My philosophy is in action, in natural and present practice, little in fancy” (639–640); or “I am hungry to make myself known, and I care not to how many, provided it be truly” (643); and “I owe a complete portrait of myself to the public. The wisdom of my lesson is wholly in truth, in freedom, in real- ity; disdaining, in the list of its real duties, those petty, feigned, customary, provincial rules, altogether natural, constant, and universal; of which propriety and ceremony are daughters, but bastard daughters” (677).
6 Arthur Schopenhauer, On the doctrine of the nothingness of existence, §145. In Parerga and Paralipomena: Short Philosophical Essays, 2. Trans. by Adrian Del Caro and Christopher Janaway (CUP: 2014), 304.
7 Karl Popper, Objective Knowledge: An evolutionary Approach (Clarendon, 1972), 33. The passage, Popper’s “excuse” for doing philosophy, is preserved in the Revised edition of 1979, reprinted 1994. Achenbach cites the German translation, Objektive Erkenntnis. Ein evolutionärer Entwurf (Hamburg: Hoffmann Und Campe Verlag, 1973), 44.
8 Achenbach Note: With regard to his novel, Die Leiden des jungen Werther, which some of his contemporaries had expected to display a “didactic purpose,” Goethe notes: “the true work of art has none. It neither approves nor censures, but instead develops sentiments and actions in sequence, and thereby illuminates and instructs.” Goethe, From My Life: Poetry and Truth, Part 3. Vol. 4 of Goethe: Col- lected Works (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994), 433. Thus does Goethe describe what is also the mission of Philosophical Praxis.
Traduction de l’anglais au français avec ChatGPT
Chapitre 1
Réponse brève à la question : qu’est-ce que la Praxis philosophique ?
Il faut créer du nouveau pour voir du nouveau.
— Lichtenberg
J’ai fondé la première Praxis philosophique au monde en 1981, et j’ai forgé ce terme la même année. En 1982, la Société pour la Praxis philosophique fut instituée à Bergisch Gladbach, près de Cologne ; elle devint plus tard l’organisation faîtière internationale de nombreuses sociétés nationales. Voilà pour l’aspect institutionnel. Passons maintenant à la question : en bref, qu’est-ce que la Praxis philosophique ?
Le conseil philosophique de vie qui se pratique dans la Praxis philosophique se présente comme une alternative aux psychothérapies. Il s’adresse à ceux qui, tourmentés par leurs peines ou leurs problèmes, et incapables de « s’accommoder » de leur existence, se retrouvent d’une manière ou d’une autre dans une impasse. La Praxis philosophique concerne ceux qui se débattent avec des questions existentielles qu’ils ne parviennent ni à résoudre ni à écarter, ou encore ceux qui, bien que capables de faire face au quotidien, se sentent « sous-chargés », peut-être parce qu’ils pressentent que leur réalité ne correspond pas à leur potentiel. D’autres encore s’adressent à la Praxis philosophique non pas parce qu’ils se satisfont simplement d’exister ou de se débrouiller tant bien que mal, mais parce qu’ils exigent d’examiner leur vie, d’en voir clairement les contours, l’origine, la raison d’être et la destination.
Leur besoin est souvent simplement de réfléchir aux circonstances uniques, aux enchevêtrements singuliers et au cours souvent étrangement ambigu de nos existences. En résumé, les gens consultent les philosophes praticiens parce qu’ils veulent comprendre et être compris. Ils n’arrivent presque jamais avec la question kantienne : « Que dois-je faire ? », mais plutôt avec celle de Montaigne : « Que fais-je ? » Peut-être, en arrière-plan, opère une intuition qui relève de la plus ancienne sagesse philosophique—à savoir la maxime socratique selon laquelle seule une vie examinée mérite d’être vécue. Celle-ci peut se manifester sous la forme d’une peur diffuse, celle qu’une vie trop « inerte » ne soit en réalité qu’à peine vécue, qu’elle soit en quelque sorte « gaspillée », « abandonnée », « dilapidée »—une vie en train de se défaire elle-même.
Schopenhauer l’exprime ainsi :
La plupart des hommes, lorsqu’ils regardent en arrière à la fin de leur vie, réalisent qu’ils l’ont vécue entièrement à titre provisoire et s’étonnent de voir que ce qu’ils ont laissé passer sans l’apprécier ni en jouir, c’était précisément leur propre existence, cette chose même dont ils avaient toujours attendu l’avènement. Ainsi, en règle générale, le cours de la vie est tel que, dupé par l’espoir, on danse dans les bras de la mort.
Quiconque a éprouvé cette perspective terrifiante peut, par la réflexion philosophique, voir le poids de la vie se transformer en promesse (Verheißung), car l’attitude philosophique envers l’existence est en effet — comme une promesse — une charge respectueuse qui confère à notre existence une gravité, un sens à notre présence ici-bas et une signification à notre présent.
Il y a souvent des circonstances marquantes qui amènent l’invité à prendre la décision de consulter un praticien-philosophe. Ce sont généralement des déceptions, des expériences inattendues, des conflits avec autrui, des coups du sort, des échecs, des désillusions ou encore des résultats de vie qui laissent un sentiment de vide. Dans de telles situations, on suppose — bien que confusément — que la mission de la Praxis philosophique pourrait être celle qu’évoquait Karl Popper avant même que cette pratique n’existe :
Nous avons tous une philosophie, que nous en soyons conscients ou non, et nos philosophies ne valent souvent pas grand-chose. Mais l’impact de nos philosophies sur nos actions et sur nos vies est souvent dévastateur. C’est pourquoi il est nécessaire d’essayer d’améliorer nos philosophies par la critique. Voilà la seule justification que je puisse offrir à l’existence continue de la philosophie.
Si nous voulons être concis ici, nous devons poser la question suivante : comment les philosophes praticiens aident-ils leurs visiteurs ? La façon habituelle de poser cette question est source de confusion : « Quelle méthode suivent les philosophes praticiens ? » Or, il faut parler avec justesse : la philosophie ne travaille pas avec des méthodes, mais tout au plus sur elles. L’obéissance à une méthode est l’apanage des sciences, non de la philosophie. La pensée philosophique ne suit pas des chemins tout tracés ; elle cherche, à chaque fois, la voie juste. Plutôt que de s’appuyer sur des routines intellectuelles toutes faites, elle les sabote pour mieux se clarifier.
Il ne s’agit donc pas de conduire les invités de la Praxis philosophique sur un itinéraire philosophique prédéterminé, mais bien de les aider à avancer sur leur propre chemin. Cela suppose chez le philosophe la capacité d’apprécier autrui sans nécessairement être d’accord avec lui ; en effet, comme le disait Goethe, « ni n’approuver ni condamner ».
La philosophie ne peut être simplement « appliquée », comme si les préoccupations de l’invité pouvaient être « traitées » par une dose de Platon, de Hegel ou de tout autre penseur. Les lectures philosophiques ne sont pas des remèdes à prescrire. Un patient va-t-il voir un médecin pour assister à une conférence médicale ? De même, l’invité de la Praxis philosophique ne doit pas être instruit par le philosophe, encore moins être trompé par des jeux de mots habiles, et certainement pas être servi en théories.
La véritable question est de savoir si le philosophe, à travers ses propres lectures, est devenu sage, compréhensif et attentif, s’il a acquis une sensibilité pour ce qui est habituellement ignoré, et s’il a appris à se sentir chez lui dans les pensées, sentiments et jugements atypiques ou marginaux. Car seul un co-penseur et un sympathisant peut libérer les visiteurs de leur solitude — ou de leur isolement intérieur — et peut-être ainsi les amener à une nouvelle appréciation de leur vie et de leur situation.
Philosophie et psychothérapie : une frontière ?
N’est-ce pas le cas aussi des psychologues et des psychothérapeutes ? Et des pasteurs ? Cette question surgit inévitablement — signe de notre culture encore largement dominée par le paradigme thérapeutique — et interroge la frontière entre la Praxis philosophique et les psychothérapies.
Le psychologue et le psychothérapeute sont des spécialistes, spécialement formés à percevoir le spécifique d’une manière spécialisée, c’est-à-dire les troubles d’origine psychogène ou psychologique. Lorsqu’ils ne sont pas spécialistes, ils sont des dilettantes. Paradoxalement, le philosophe est un spécialiste du non-spécifique, du général et du simple (ainsi que d’une tradition riche de pensée raisonnée), mais aussi du contradictoire et du singulier, avec une attention particulière portée à l’individuel et à l’unique.
En ce sens, le philosophe praticien prend ses visiteurs au sérieux : non pas à travers le prisme d’une théorie (c’est-à-dire non pas par une compréhension schématique), ni comme un simple « cas » illustratif d’une règle, mais en tant qu’individu en soi. Aucune échelle de valeur ne lui est imposée, pas même celle de la santé. La question n’est pas de savoir si l’invité est « normal », mais s’il est fidèle à lui-même—ou, pour paraphraser Nietzsche, s’il est devenu ce qu’il est.
Enfin, la Praxis philosophique ne se limite pas aux consultations individuelles. Elle accompagne également des entreprises, des organisations et des associations dans leur quête de mission, de principes fondateurs et de repères orientants.
About the Author and Translator
AUTHOR
Dr. Gerd B. Achenbach was born 1947 in Hameln, Germany, and is the founder of the Philosophical Praxis as well as the founder and chairman of the first Society of Philosophical Praxis (GPP e.V., 1982). He is author of several books (Die reine und die praktische Philosophie, Das Prinzip Heilung, Vom Richtigen im Falschen, Lebenskönnerschaft, Liebe—der göttliche Wahn, Das kleine Buch der inneren Ruhe, Philosophie der Philosophischen Praxis), taught at numerous universities, and has been a keynote speaker on various international congresses.
Traduction en français avec DeepL
Gerd B. Achenbach est né en 1947 à Hameln, en Allemagne. Il est le fondateur de la Praxis philosophique ainsi que le fondateur et le président de la première société de Praxis philosophique (GPP e.V., 1982). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages (Die reine und die praktische Philosophie, Das Prinzip Heilung, Vom Richtigen im Falschen, Lebenskönnerschaft, Liebe-der göttliche Wahn, Das kleine Buch der inneren Ruhe, Philosophie der Philosophischen Praxis), a enseigné dans de nombreuses universités et a été l’orateur principal de divers congrès internationaux.
TRANSLATOR
Michael Picard teaches philosophy at Douglas College in Vancouver, Canada. He holds an MSc and PhD in philosophy from Massachusetts Institute of Technology and is a longtime animator of public participatory philosophy, as well as creator of the web app and game Tug of Logic. Picard is author of This Is Not a Book (2007) and How to Play Philosophy (2022).
Traduction en français avec DeepL
Michael Picard enseigne la philosophie au Douglas College de Vancouver, au Canada. Il est titulaire d’une maîtrise et d’un doctorat en philosophie du Massachusetts Institute of Technology et est un animateur de longue date de la philosophie participative publique, ainsi que le créateur de l’application web et du jeu Tug of Logic. Picard est l’auteur de This Is Not a Book (2007) et de How to Play Philosophy (2022).
About Dr. Gerd B. Achenbach
(German-to-English translation with DeepL)
Dr. Gerd B. Achenbach is the Founder of Philosophical Practice, which he established in 1981 and which has since developed into a worldwide movement.
Born in Hameln in 1947. Doctorate in 1981 [“Selbstverwirklichung oder: Die Lust und die Notwendigkeit”] with Odo Marquard.
Married to Laura Achenbach, father of eight children: Alef, Hanne, Friederike, Alma, Cara, Valentin, Anna and Otto.
1981 Founds the world’s first philosophical practice in Bergisch Gladbach/Refrath.
1982 Founding of the Gesellschaft für Philosophische Praxis GPP e.V., the later International Society for Philosophical Practice, of which he is a teaching practitioner and from its founding in 1982 onwards its Chairman of the Board, until he gave up this position in the fall of 2003 to make way for younger people.
2004: Founding of the “Gesellschaft für Philosophische Praxis” (GPP) in Bergisch Gladbach, whose board he has chaired ever since.
Since 2003: Scientific Advisory Board of the “Gesellschaft zur Erforschung und Förderung angewandten Philosophierens e.V.”.
2006-2009: Scientific Advisory Board of the German Mining Museum Bochum.
Since 2007: Scientific Advisory Board of the journal “psycho-logik” – Yearbook for Psychotherapy, Philosophy and Culture (Alber-Verlag)
Since 2015: Scientific Advisory Board of the “University Course Philosophical Practice” at the University of Vienna.
Teaches at various universities, including in Klagenfurt, Vienna and Berlin.
2018: Awarded the “Reconocimiento por la travectoria en la práctica filosófica, Ira edicion, Mexico 2018”/“Acknowlegdment for the trayectory in philosophical practice; 1st edition 15th ICPP, Mexico 2018” (translated: “In recognition of the achievement of having put philosophical practice on track” [ICPP = International Conference on Philosophical Practice].
Read this text in its original German
Web site : Dr. Gerd B. Achenbach.
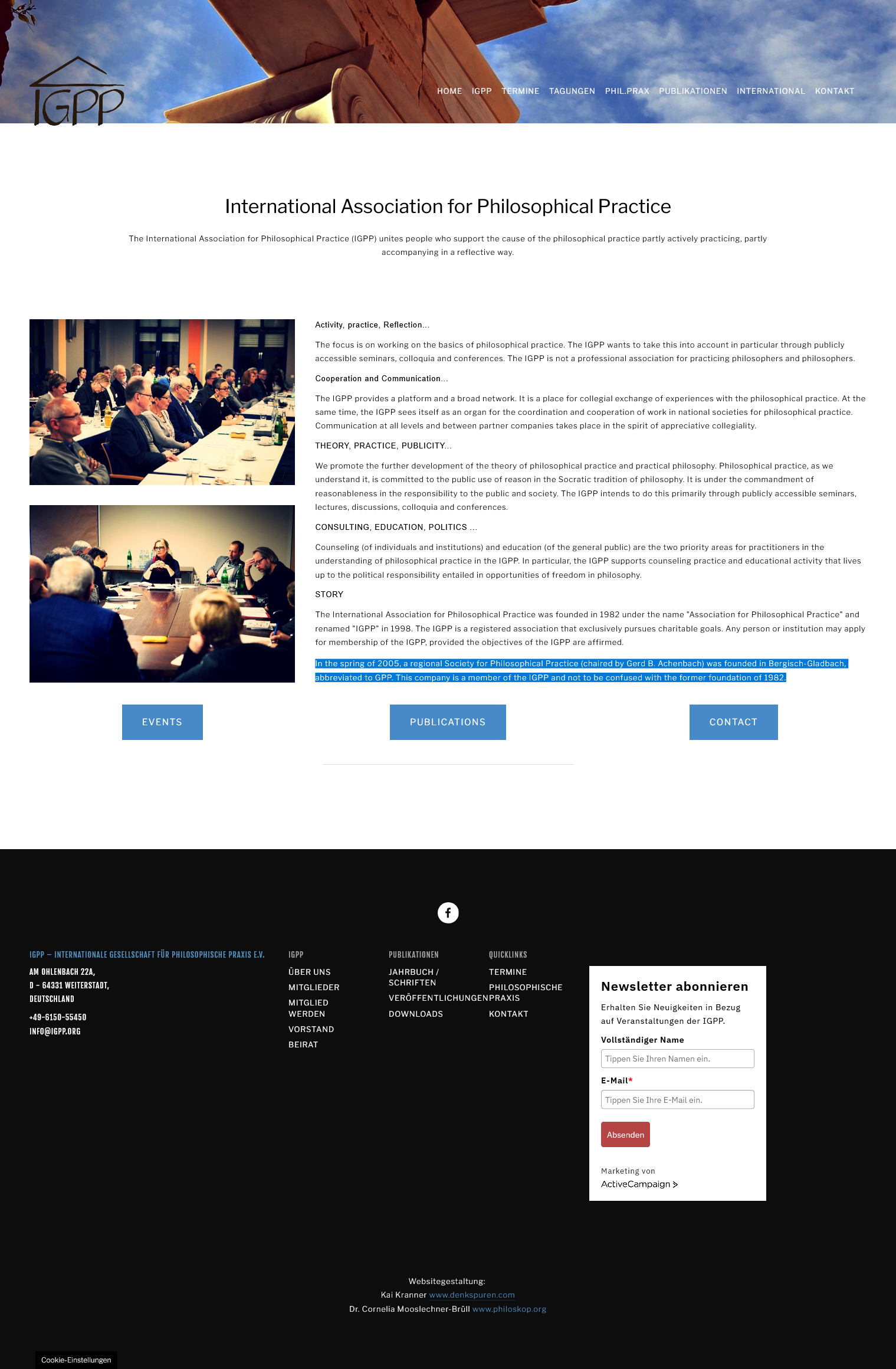
By the same author
What matters? ? What is important in truth? What is crucial in the end? – Leading principles in philosophical practice. ![]() (Lecture at the opening of the 15th International Colloquium on Philosophical Practice in Mexico on June 25, 2018.)
(Lecture at the opening of the 15th International Colloquium on Philosophical Practice in Mexico on June 25, 2018.)
What is Philosophical Practice?
On Wisdom in Philosophical Pracice ![]() Lecture for the „Third International Conference on Philosophical Practice”, New York, July 1997, published in: Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines, Spring, 1997. Vol. XVII, No. 3, p. 5 – 20
Lecture for the „Third International Conference on Philosophical Practice”, New York, July 1997, published in: Inquiry: Critical Thinking Across the Disciplines, Spring, 1997. Vol. XVII, No. 3, p. 5 – 20
Philosophical Practice opens up the Trace of „Lebenskönnerschaft” ![]() Lecture for the „ 6th International Conference on Philosophical Practice”, Oslo, 2001
Lecture for the „ 6th International Conference on Philosophical Practice”, Oslo, 2001
Philosophical Practice – A Question of Bildung? Lecture for the „International Conference on Philosophical Practice”, Kopenhagen, 2004
Book Review

Mon rapport de lecture
Philosophical Praxis
Origin, Relations, and Legacy
Gerd B. Achenbach
Translated by Michael Picard
Lexington Books, 2024
NOTE IMPORTANTE
Les numéros de page des citations dans ce rapport de lecture sont celles de la version originale anglaise imprimée
D’entrée de jeu, Gerd D. Archenbach reconnaît à l’Amérique du Nord l’origine « des écoles de psychothérapie, de certaines inspirations et innovations essentielles qui ont été reprises plus tard en Europe et adaptées à l’ancienne manière européenne ». Il est question d’un premier mouvement intercontinental de « la « Haute Amérique » – comme j’aimerais appeler la moitié nord du continent américain – » vers l’Europe. Il note un deuxième mouvement, cette fois, de l’Europe à l’Amérique du Nord.
Il ne s’agit pas de nier que c’est à Vienne (surtout) et en Suisse que sont nées les formes originales de toutes les thérapies ultérieures – la psychanalyse de Freud, la psychologie analytique de C. G. Jung et la psychologie individuelle d’Adler. Des développements significatifs de cette triple racine se sont ensuite répandus en Amérique du Nord ; il suffit de rappeler les innombrables variantes de ce que l’on appelle la « psychologie humaniste ».
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Préface, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), p. xvii.
Enfin, écrit Gerd B Archenbac, « (…) il semble que ce mouvement intercontinental de va-et-vient soit en train de repartir dans l’autre sens. »
Cette fois, il s’agit du renouveau de la pratique de la philosophie, que j’ai instaurée en 1981 en Allemagne sous le nom de Praxis philosophique. Celle-ci s’est rapidement implantée dans les pays européens voisins—d’abord en Autriche et aux Pays-Bas—avant de traverser l’Atlantique pour gagner le « Nouveau Monde ». Elle y a suscité attention et reconnaissance, d’abord à Vancouver, au Canada (où s’est tenu en 1994 le premier Congrès international de pratique philosophique à l’Université de la Colombie-Britannique), puis peu après à New York, grâce à Lou Marinoff, qui publia en 1999 Plato, Not Prozac! Applying Philosophy to Everyday Problems. Grâce, en grande partie, au fait que l’anglais est aujourd’hui la lingua franca, cet essor a contribué à la diffusion mondiale de la Praxis philosophique.
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Préface, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), p. xvii.
Il n’en demeure pas moins que les textes de Gerd B. Archenbach annonçant et explicitant ce « renouveau de la pratique de la philosophie » sont demeurés, à quelques exceptions près, dans sa langue maternelle, l’allemand. La traduction formelle en anglais ne viendra qu’en 2024. Gerd B. Archenbach écrit :
Il devient donc d’autant plus urgent de rendre disponible une sélection de textes dans cette langue qui tend désormais à s’imposer comme un idiome quasi universel—des textes qui, tout en fondant la Praxis philosophique, ont initié une renaissance des plus anciennes impulsions philosophiques. L’importance de cette dernière renaissance de la philosophie, conçue comme un art de vivre exemplaire—ainsi qu’elle était comprise dans l’Antiquité et que Pierre Hadot et Michel Foucault l’ont réactualisée—ne se limite en aucun cas à un simple retour aux aspirations originelles de la philosophie sous une forme pratique. La véritable mission de cette nouvelle configuration philosophique est plutôt de s’établir comme la première véritable alternative à la « culture thérapeutique ». Ceux qui, jusqu’ici, se seraient tournés vers la thérapie se tourneront de plus en plus vers le praticien-philosophe dans leur détresse. Ainsi, la pratique de la philosophie ouvre, pour la première fois, la possibilité de se constituer en véritable profession.
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Préface, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), pp. xvii-xviii.
Dans cet citation, Gerd B. Archenbach, parlant de la praxis philosophique qu’il a initiée en 1981, précise que « L’importance de cette dernière renaissance de la philosophie, conçue comme un art de vivre exemplaire (…) ne se limite en aucun cas à un simple retour aux aspirations originelles de la philosophie sous une forme pratique. »
Il est donc question d’une « nouvelle configuration philosophique » dont la « mission » est de « s’établir comme la première véritable alternative à la “culture thérapeutique” ».
Parmi mes publications consacrées à cette renaissance philosophique, ou intellectuellement préparatoires à celle-ci, j’ai tenté de sélectionner des écrits susceptibles d’offrir aux esprits philosophiquement curieux du monde anglo-américain un aperçu de ce projet novateur. Et c’est ainsi que j’envoie aujourd’hui ces textes, accompagnés de salutations amicales, vers le continent occidental, d’où l’appel à la Praxis philosophique pourra se propager aux quatre coins du monde.
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Préface, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), p. xvii.
Dans son « Prelude » (anglais à traduire en français par « Introduction », ce qui vient habituellement à la suite de la préface), Gerd B. Archenback dénonce vivement la quête d’une théorie de la pratique philosophique.
Avec une persistance douteuse, des voix s’élèvent ici et là pour réclamer une « théorie de la Praxis philosophique ». Et j’ai pris l’habitude d’ignorer ces voix avec une persistance tout aussi résolue. Que devrions-nous leur répondre, si des personnes préformées—nota bene : leur préformation est leur problème—si des personnes formées scientifiquement estiment qu’elles ne peuvent savoir ce qu’est la Praxis philosophique tant qu’elles ne disposent pas d’une « théorie » à son sujet ? Ces malheureux amis de la théorie ressemblent à ceux qui, se trouvant dans un paysage des plus magnifiques, regardent autour d’eux et déclarent ne rien voir parce qu’ils ne possèdent aucune carte du lieu.
Peut-être vaut-il mieux encore interpréter une telle persistance comme le signe de la domination contemporaine de l’algorithme sur nos esprits, si tant est que son règne n’y soit pas déjà établi. Selon cette logique, on ne « comprend » qu’en connaissant le schéma selon lequel les processus s’exécutent. Nous ne saurions trouver meilleure analogie que celle de l’ingénierie des processus.
(…)
Non—dans le domaine de la philosophie, c’est l’inverse qui a toujours prévalu : le philosophe pense et, en même temps, réfléchit à sa pensée et même, dans sa pensée, à la possibilité même de penser. Ainsi, non seulement il n’a nul besoin de l’ornière qui maintient l’homme obsédé par la théorie sur son chemin prédéterminé, mais, bien au contraire, un tel carcan serait pour lui un joug, une entrave qui le lierait tête et membres. N’hésitons pas à rappeler l’une des idées directrices de la tradition philosophique : tandis que d’autres se croient en sécurité, attachés à la laisse d’une théorie choisie, le philosophe souffre de la perte de cette liberté, sans laquelle la pensée se réduit à une simple conformité jusqu’à dégénérer en routine stérile, puis s’éteindre.
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Prelude, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), p. xxi.
Personnellement, j’ai observé chez certains philosophes praticiens une approche fondée sur différentes théories dont la mise en pratique témoigne de cette perte de liberté relevée par Gerd B. Archesbach : « (…) tandis que d’autres se croient en sécurité, attachés à la laisse d’une théorie choisie, le philosophe souffre de la perte de cette liberté, sans laquelle la pensée se réduit à une simple conformité jusqu’à dégénérer en routine stérile, puis s’éteindre ».
Afin de prévenir tout malentendu répandu : la responsabilité du philosophe ne réside pas uniquement, et peut-être même pas principalement, dans ce qu’il « pense », mais dans sa capacité à repenser, à devenir réfléchi, ou — pour reprendre d’anciens termes devenus rares— à faire preuve de jugement. Sous cette exigence, il secourt, chaque fois que possible, les pensées ensevelies sous les décombres, et rouvre de nouvelles sources de pensée taries, afin qu’elles recommencent à couler.
Mieux encore : pris dans son acception la plus large, un tel penser n’est pas un parc naturel délimité dans lequel le philosophe se laisserait enfermer. Au contraire, il ressent ; il perçoit ; il observe ; il détecte ; il soupçonne ; il anticipe ; il se méfie et il croit ; il craint, tremble et espère ; il se souvient de l’oublié ; attire l’attention sur ce qui a été négligé ; insiste là où d’autres « sont déjà plus loin » ; perturbe les questions dont les réponses sont déjà établies ; garde son calme quand les armées marchent ; fait du bruit là où d’autres détournent le regard — en somme : il vit, et il ne lui échappe ni le fait qu’il vit, ni la manière dont il vit. Voilà son socle, c’est là qu’il puise son expérience. Mais je m’arrêterai ici, bien que cette liste puisse manifestement être poursuivie ad libitum.
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Prelude, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), p. xxii.
Bref, à l’instar du philosophe, le philosophe praticien se doit de chérir sa liberté, de ne pas se laisser formaté par une quelconque théorie ou, pis encore, une méthodologie donnée.
J’insiste : « (…) la responsabilité du philosophe ne réside pas uniquement, et peut-être même pas principalement, dans ce qu’il “pense” ». On ne consulte donc pas un philosophe praticien pour savoir ce qu’il pense.
À la question en titre du premier chapitre de son recueil de textes, Réponse brève à la question : qu’est-ce que la Praxis philosophique, Gerd B. Archenbach écrit :
Le conseil philosophique de vie qui se pratique dans la Praxis philosophique se présente comme une alternative aux psychothérapies. Il s’adresse à ceux qui, tourmentés par leurs peines ou leurs problèmes, et incapables de « s’accommoder » de leur existence, se retrouvent d’une manière ou d’une autre dans une impasse. La Praxis philosophique concerne ceux qui se débattent avec des questions existentielles qu’ils ne parviennent ni à résoudre ni à écarter, ou encore ceux qui, bien que capables de faire face au quotidien, se sentent « sous-chargés », peut-être parce qu’ils pressentent que leur réalité ne correspond pas à leur potentiel. D’autres encore s’adressent à la Praxis philosophique non pas parce qu’ils se satisfont simplement d’exister ou de se débrouiller tant bien que mal, mais parce qu’ils exigent d’examiner leur vie, d’en voir clairement les contours, l’origine, la raison d’être et la destination.
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Chapitre 1 – Réponse brève à la question : qu’est-ce que la Praxis philosophique, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), p. 1.
Depuis, la création de cette Observatoire de la philothérapie en 2020, j’ai souvent remarqué la crainte quasi-systématique de certains philosophes praticiens à confronter la philothérapie à la psychychothérapie. Gerd B. Archenbach est pourtant très clair à ce sujet : « Le conseil philosophique de vie qui se pratique dans la Praxis philosophique se présente comme une alternative aux psychothérapies ». Le livre de Lou Marinoff, avec lequel j’ai découvert la pratique philosophique à l’aube des années 2000, est tout aussi clair et sans équivoque face à la psychologie : « Platon, pas Prozac! ».
Il décrit le besoin des personnes en consultation philosophique en ces termes :
Leur besoin est souvent simplement de réfléchir aux circonstances uniques, aux enchevêtrements singuliers et au cours souvent étrangement ambigu de nos existences. En résumé, les gens consultent les philosophes praticiens parce qu’ils veulent comprendre et être compris. Ils n’arrivent presque jamais avec la question kantienne : « Que dois-je faire ? », mais plutôt avec celle de Montaigne : « Que fais-je ? » Peut-être, en arrière-plan, opère une intuition qui relève de la plus ancienne sagesse philosophique—à savoir la maxime socratique selon laquelle seule une vie examinée mérite d’être vécue. Celle-ci peut se manifester sous la forme d’une peur diffuse, celle qu’une vie trop « inerte » ne soit en réalité qu’à peine vécue, qu’elle soit en quelque sorte « gaspillée », « abandonnée », « dilapidée »—une vie en train de se défaire elle-même.
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Chapitre 1 – Réponse brève à la question : qu’est-ce que la Praxis philosophique, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), pp. 1-2.
J’insiste aussi sur ce point : « En résumé, les gens consultent les philosophes praticiens parce qu’ils veulent comprendre et être compris ».
À la question « Pourquoi consulte-t-on un philosophe praticien ? » Gerd B. Archenbach donne cette réponse.
Il y a souvent des circonstances marquantes qui amènent l’invité à prendre la décision de consulter un praticien-philosophe. Ce sont généralement des déceptions, des expériences inattendues, des conflits avec autrui, des coups du sort, des échecs, des désillusions ou encore des résultats de vie qui laissent un sentiment de vide. Dans de telles situations, on suppose — bien que confusément — que la mission de la Praxis philosophique pourrait être celle qu’évoquait Karl Popper avant même que cette pratique n’existe :
Nous avons tous une philosophie, que nous en soyons conscients ou non, et nos philosophies ne valent souvent pas grand-chose. Mais l’impact de nos philosophies sur nos actions et sur nos vies est souvent dévastateur. C’est pourquoi il est nécessaire d’essayer d’améliorer nos philosophies par la critique. Voilà la seule justification que je puisse offrir à l’existence continue de la philosophie.
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Chapitre 1 – Réponse brève à la question : qu’est-ce que la Praxis philosophique, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), p. 2.
La personnes en consultation philosophique a déjà une philosophie, qu’elle en soit ou non consciente, il ne s’agit donc pas de la nier mais d’en dresser les contours pour la soumettre à une critique constructive. Vouloir lui imposer une autre philosophie ne contitue pas une démarche souhaitable. Aucune méthode n’est de mise :
Si nous voulons être concis ici, nous devons poser la question suivante : comment les philosophes praticiens aident-ils leurs visiteurs ? La façon habituelle de poser cette question est source de confusion : « Quelle méthode suivent les philosophes praticiens ? » Or, il faut parler avec justesse : la philosophie ne travaille pas avec des méthodes, mais tout au plus sur elles. L’obéissance à une méthode est l’apanage des sciences, non de la philosophie. La pensée philosophique ne suit pas des chemins tout tracés ; elle cherche, à chaque fois, la voie juste. Plutôt que de s’appuyer sur des routines intellectuelles toutes faites, elle les sabote pour mieux se clarifier.
Il ne s’agit donc pas de conduire les invités de la Praxis philosophique sur un itinéraire philosophique prédéterminé, mais bien de les aider à avancer sur leur propre chemin. Cela suppose chez le philosophe la capacité d’apprécier autrui sans nécessairement être d’accord avec lui ; en effet, comme le disait Goethe, « ni n’approuver ni condamner ».
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Chapitre 1 – Réponse brève à la question : qu’est-ce que la Praxis philosophique, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), pp. 2-3.
Il faut donc au philosophe praticien « la capacité d’apprécier autrui sans nécessairement être d’accord avec lui ; en effet, comme le disait Goethe, « ni n’approuver ni condamner ». Bref, éviter de juger ! Cette capacité d’apprécier autrui repose, à mon humble avis, sur l’amour de son prochain et l’empathie.
La philosophie ne peut être simplement « appliquée », comme si les préoccupations de l’invité pouvaient être « traitées » par une dose de Platon, de Hegel ou de tout autre penseur. Les lectures philosophiques ne sont pas des remèdes à prescrire. Un patient va-t-il voir un médecin pour assister à une conférence médicale ? De même, l’invité de la Praxis philosophique ne doit pas être instruit par le philosophe, encore moins être trompé par des jeux de mots habiles, et certainement pas être servi en théories.
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Chapitre 1 – Réponse brève à la question : qu’est-ce que la Praxis philosophique, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), p. 3.
Ce passage du livre PHILOSOPHICAL PRAXIS de Gerd B. Archenbach est l’un des plus importants de son recueil de textes. La consultation philosophique ne consiste pas en un cours de philosophie, pas qu’en en exercice visant à prendre en défaut de contradiction ou de logique l’invité.
La véritable question est de savoir si le philosophe, à travers ses propres lectures, est devenu sage, compréhensif et attentif, s’il a acquis une sensibilité pour ce qui est habituellement ignoré, et s’il a appris à se sentir chez lui dans les pensées, sentiments et jugements atypiques ou marginaux. Car seul un co-penseur et un sympathisant peut libérer les visiteurs de leur solitude—ou de leur isolement intérieur—et peut-être ainsi les amener à une nouvelle appréciation de leur vie et de leur situation.
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Chapitre 1 – Réponse brève à la question : qu’est-ce que la Praxis philosophique, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), p. 3.
Wow ! Nous sommes loin, très loin, à l’opposé de la majorité des propos de la littérature francophone européenne au sujet de la philosophie pratique. En témoigne ces extraits de l’article « J’ai testé une consultation de philosophie » de Psychologie Magazine :
J’ai testé une consultation de philosophie
La consultation philosophique est l’occasion d’une mise à l’épreuve de vos idées reçues. Le manque d’écoute, l’incapacité à dérouler lentement le fil d’une réflexion cohérente, le malaise face aux questions que vous posez indiquent que vous avez frappé à la mauvaise porte.
(…)
Il existe très peu de véritables consultants en philosophie ; en revanche, certains animateurs de cafés philo reçoivent en « cabinet ». L’un d’eux m’a reçue gentiment. Après avoir pris quelques notes sur ce qui m’a conduit à le consulter, son verdict est tombé : « Dans votre cas, je préconise Epictète et Spinoza ! » Le temps d’un bref topo sur leur pensée, il m’a abreuvée d’exemples pour tenter d’éclaircir mon problème. J’ai eu l’impression d’assister à un cours de philo du lycée, en plus brouillon. A la fin, j’ai eu droit à quelques devoirs : « Prendre cinq maximes du “Manuel” d’Epictète, les reformuler avec vos mots. Justifier tout, puis contredire tout. » Cinquante euros pour cela me paraît excessif… N’est pas « philosophe libéral » qui veut.
Source : Benhamou, Olivia, J’ai testé une consultation de philosophie, Psychologie Magazine, 30 juillet 2009.
Ou encore cet extrait de l’article « La consultation philosophique, une alternative au rendez-vous chez le psy ? » de Madame Figaro :
(…) Pour le philosophe Oscar Brenifier, elle (consultation philosophique) s’adresse aux personnes qui ont accès à la « rationalité ». » Il y a des gens que je renvoie vers une thérapie au bout de dix minutes, car il y a trop de douleur. Il y a aussi ceux qui veulent se raconter, or ce n’est pas le principe de la consultation philosophique « , explique-t-il, en précisant qu’il ne » soigne pas une pathologie « , contrairement aux médecins. » Quand vous vous demandez quel est le sens de votre vie, vous n’êtes pas malade « , tempête-t-il.
Quand Oscar Brenifier affirme « Il y a aussi ceux qui veulent se raconter, or ce n’est pas le principe de la consultation philosophique », il se prive de la contextualisation de la question ou de la situation à laquelle son client veut trouver une réponse.
Un tel philosophe praticien se prive aussi de la prise recul que permet très souvent le simple fait de s’entendre mettre des mots sur nos idées en cours de verbalisation. Les uns entendent pour la toute première fois l’expression de leurs idées sur leur question ou sur leur situation dans leur propre langage. Les autres s’apperçoivent que leurs idées ne tiennent pas la route lorsqu’ils s’écoutent parler. L’écoute revet une importance capitale dans une consultation philosophique.
Dans le deuxième chapitre, La praxis philosophique a une longue tradition, mais pas de parangon, Gerd B. Archenbach situe la pratique philosophique dans notre présent plutôt que dans le passé de sa tradition.
Bien entendu, ici comme ailleurs, ce n’est pas le passé qui nous enseigne le présent, mais plutôt le présent qui nous éclaire sur le passé — de même que la galerie des ancêtres de la praxis philosophique ne nous montre pas le chemin, mais (bien au contraire) la praxis philosophique s’étend en arrière et, avec de nouveaux et d’autres intérêts, ravive les perspectives de la préhistoire philosophique. (…)
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Chapitre 2 – La praxis philosophique a une longue tradition, mais pas de parangon, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), p. 6.
Nous avons « de nouveaux et d’autres intérêts ». Ce n’est pas le passé qui éclaire le présente mais le présent qui éclaire le passé. Reconnaître l’apport historique de la tradition va de soi mais s’y ancrer en mimant l’apport des philosophes du passé sera une erreur… méthodologique.
Et pourtant, après avoir été libérée de la stricte adhésion au monopole chrétien sur le salut, une philosophie a émergé, précurseur de la praxis philosophique. Je fais ici référence à l’intelligence sceptique de Montaigne et à son raffinement de vie auto-réflexif. Ici, la philosophie est entièrement réinstallée : au lieu d’aller de l’avant comme une sorte de commandant sur le chemin de notre vie (nous ordonnant le bon chemin en aboyant toutes sortes d’ordres, de règles et de devoirs incontournables, avec comme point d’arrivée rien de moins que la perfection), la philosophie, pour Montaigne, suit plutôt derrière, généralement tranquillement et sans se faire remarquer. Il est rare que l’homme la recherche, et encore, uniquement pour essayer de clarifier la vie avec son aide. « Mes mœurs sont naturelles » 14, écrit Montaigne dans l’« Apologie de Raymond Sebond » :
Je n’ai fait appel à aucune discipline pour les ériger; mais, si faibles qu’elles soient, quand il m’est venu à l’esprit de les exposer à la vue du monde, et que pour les exposer à la lumière dans un habit un peu plus décent, je suis allé les orner de raisons et d’exemples, j’ai été étonné par hasard de les trouver conformes à tant de discours et d’exemples philosophiques. Je n’ai jamais su quel était le régime de ma vie jusqu’à ce qu’elle soit presque usée et dépensée; une nouvelle figure — un philosophe non prémédité et accidentel.15
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Chapitre 2 – La praxis philosophique a une longue tradition, mais pas de parangon, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), pp. 8-9.
Ce passage entre parenthèses nous en dit très long : « (nous ordonnant le bon chemin en aboyant toutes sortes d’ordres, de règles et de devoirs incontournables, avec comme point d’arrivée rien de moins que la perfection) ». La philosophie n’est pas là pour nous ordonner comment vivre, nous imposer des règles à respecter et des devoirs à accomplir et encore de nous dicter un objectif de perfection. La liberté de l’invité (du client) importe tout autant que celle du philosophe praticien. Le philosophe praticien doit faire preuve de sagesse et, à ce titre, il est un seul accomplissement, être un sage responsable de sa liberté. Il se doit de donner l’exemple.
« La galerie des ancêtres de la praxis philosophique n’est aujourd’hui ni complète ni fermée » sur l’Antiquité et « (…) depuis au moins le début de l’époque moderne, les pionniers et les prédécesseurs de la praxis philosophique sont nombreux et peuvent être nommés. » « Et ils sont intéressants précisément parce qu’ils constatent que les calculs de leur vie ne fonctionnent plus rondement et sans reste, de sorte qu’ils sont devenus gênés même pour donner des conseils. »
Il faut citer Karl Philipp Moritz, le jeune ami de Goethe, qui a publié de 1783 à 1793 le « Magazin zur Erfahrungsseelenkunde » sous le titre Gnothi Sauton (ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ) — encore aujourd’hui un trésor d’observations pour le praticien de la philosophie. Vient ensuite, de Copenhague, le Danois Søren Kierkegaard qui, dans son livre Either-Or, a romancé une longue et exemplaire consultation philosophique, menée au nom de B, magistrat du tribunal et de la ville, sur un ton tout à fait distinct de celui de la droiture grossière de la bourgeoisie ou de la complaisance spirituelle du personnel clérical au sol, mais avec une « Liberté du Chrétien “24 jusqu’alors inouïe contre toutes les ordonnances supérieures, sous la devise ”la seule chose salutaire, c’est toujours qu’une personne par rapport à sa propre vie n’est pas son oncle, mais son père. « 25
Schopenhauer a également sa place dans ce spectacle. Malgré ses efforts pour couler une fois de plus une métaphysique globale dans un moule unique, il n’a pas seulement regardé de près, mais a réorienté le regard lui-même d’un point de vue pratique (et avec une intention sotériologique subtile), ce qui a donné lieu à des fragments d’une philosophie populaire de premier ordre.
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Chapitre 2 – La praxis philosophique a une longue tradition, mais pas de parangon, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), p. 10.
Les références à Arthur Schopenhauer se multiplient sous la plume de Gerd B. Archenbach.
À tout le moins, nous devons à Schopenhauer le fait que la philosophie n’ait pas été complètement oubliée en dehors des cercles académiques — à lui et à Nietzsche, qui, malgré tous les doutes soulevés par son large impact, a été une véritable tempête de feu (qui fait toujours rage, comme nous le voyons encore aujourd’hui), et pas seulement de la cendre savante.
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Chapitre 2 – La praxis philosophique a une longue tradition, mais pas de parangon, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), p. 10.
De son analyse de la tradition et son influence, Gerd B. Archenbach écrit :
Il faut donc admettre que les idées aussi sont mortelles. Et si un projet de vie philosophique, arraché à son contexte temporel, s’efforçait de se revêtir du pathos de la validité éternelle, il serait instantanément déshonoré.
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Chapitre 2 – La praxis philosophique a une longue tradition, mais pas de parangon, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), p. 11.
Permettez-moi de revenir sur l’importance de l’écoute par le sage.
(…) Il faut veiller à ce que la vie, qui se comprend en parlant et en s’exprimant, même si c’est de façon provisoire et ténue, ne se laisse pas contaminer par le silence mou, le désintérêt arrogant des intellectuels distants ou l’ignorance apparemment supérieure, qui se la joue cool, comme si tout était dans le rétroviseur.
C’est là que résident les dangers auxquels les personnes prétendument expérimentées succombent trop facilement. La philosophie, qui s’oppose à cette posture critique, n’abandonne pas le questionnement, même lorsque les réponses ne viennent pas. Mais la philosophie ne « cherche » pas non plus sans raison des réponses qu’elle n’espère secrètement plus trouver, comme l’affirme un autre cliché; elle s’attache plutôt à la question, afin de la révolutionner si possible. Elle dédaigne de servir les besoins tels qu’ils se présentent, mais s’efforce plutôt de différencier les besoins eux-mêmes — dans le vieux vocabulaire — pour les « cultiver ».
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Chapitre 2 – La praxis philosophique a une longue tradition, mais pas de parangon, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), p. 14.
Gerd B. Archenbach propose une autre question en fin de chapitre :
Enfin, la Praxis philosophique soulève une nouvelle question philosophique : ne serait-il pas possible, voire nécessaire, que la philosophie ravive sa communauté séculaire d’intérêt et d’action avec la médecine ? En ce qui concerne cette question, j’ai l’impression qu’elle est plus souvent abordée par des médecins qui ont reconnu la signification philosophique de leurs évaluations et de leurs interventions que par des philosophes qui comprennent comment la maladie, ou une maladie particulière, et finalement le patient individuel, représentent un défi pour la compréhension philosophico-médicale et pour la mise en pratique de la philosophie.
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Chapitre 2 – La praxis philosophique a une longue tradition, mais pas de parangon, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), p. 16.
Aujourd’hui, on retrouve des philosophes en milieu hospitalier auprès des patients et du personnel. Un pas en avant.
Jérôme Bouvy, Philosophe hospitalier
Après des études en philosophie à l’UNamur et quelques années en tant qu’enseignant, Jérôme Bouvy est devenu le premier philosophe hospitalier au sein du Grand Hôpital de Charleroi. Ses missions : faire entrer la philosophie en tant que pratique vivante au cœur du quotidien de son institution et accompagner les travailleurs en quête de sens dans leur travail.
Omalius : Vous êtes philosophe hospitalier, pouvez-vous nous en dire plus sur ce métier ?
Jérôme Bouvy : Il y a trois ans, le Grand Hôpital de Charleroi a souhaité travailler sur la perte de sens à l’hôpital. De nombreuses questions agitent ce milieu depuis toujours, et cela s’est accentué plus récemment suite à la pandémie qui a notamment révélé beaucoup de souffrance éthique chez les soignants. Le rôle d’un philosophe hospitalier, face à ces nombreux questionnements, est alors d’ouvrir des espaces de réflexion au sein de l’institution. Mon travail vise donc à déployer des pratiques réflexives, en particulier dans un environnement où la recherche de sens peut être prégnante, comme c’est souvent le cas dans le domaine de la santé. Mon objectif est d’encourager les membres du personnel hospitalier à prendre le temps de penser de manière critique et à partager leurs préoccupations afin de favoriser un dialogue constructif. Une des spécificités de ma fonction est que je ne m’adresse pas directement aux patients. Je suis engagé pour travailler avec les membres du personnel, qu’ils soient soignants, informaticiens, comptables… cela représente plus de 200 métiers.
On trouve aussi une « Chaire de Philosophie à l’Hôpital ».
Chaire de Philosophie à l’Hôpital
Depuis janvier 2016, la Chaire de Philosophie à l’Hôpital se déploie, après avoir été créée à l’Hôtel-Dieu de Paris, dans différents lieux hospitaliers et de soin, et aujourd’hui au sein du GHU-Paris, Psychiatrie et Neurosciences. Cette chaire hospitalo-académique, liée à la Chaire Humanités du Conservatoire National des Arts et Métiers et dirigée par la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury, a pour but la diffusion des connaissances scientifiques et philosophiques à destination des étudiants, des professionnels de santé, des patients et du grand public, au travers d’activités d’enseignement, de formation, de recherche, d’expérimentation et d’organisation d’évènements. La Chaire de Philosophie à l’Hôpital fonctionne en « creative commons », en mettant à disposition ses travaux, pour mieux inventer la fonction soignante en partage et l’alliance efficiente des humanités et de la santé.
Source : Chaire de philosophie à l’Hôpital.
UN PHILOSOPHE À L’HÔPITAL
GUILLAUME DURAND
A l’hôpital se croisent des existences singulières, des histoires ordinaires et des destins parfois bouleversants. Face aux choix cruciaux que nous imposons le réel, il s’agit toujours de préserver notre liberté. Plus que du soin, on vient y trouver du sens. Faut-il s’acharner à vouloir vivre ou accepter de partir ? Peut-on supporter de voir les yeux de son fils, donneur d’organes, dans le regard d’un autre ? Aujourd’hui plus que jamais, les questions se complexifient : que répondre à cette jeune femme qui désire se faire ligaturer les trompes pour raisons écologiques ? Faut-il aider les couples abstinents sexuels à devenir parents ? Pour être au cœur de ces dilemmes, Guillaume Durand a choisi de diriger la consultation d’éthique clinique au Centre hospitalier de Saint-Nazaire. Son expérience unique nous prouve que soigner est l’un des plus forts enjeux de notre humanité.
Source : Flammarion.
P.S. : Voir aussi : Consultation philosophique avec Guillaume Durand, philosophe à l’hôpital, Radio France, 22 octobre 2021.
La philosophie peut-elle jouer un rôle dans l’accompagnement du malade ?
Par Éric Delassus
Aujourd’hui, pour aider tous ceux de nos semblables qui traversent une épreuve pénible et sont plongés soudainement dans un malheur qui peut leur paraître tout aussi absolu qu’absurde, le recours à la psychologie est devenu une pratique courante et, il est vrai, apportant le plus souvent un soutien non négligeable aux personnes ayant subi un traumatisme important ou vivant une situation dont le caractère traumatisant s’inscrit dans la durée, ce qui est le cas de celui qui est atteint d’une maladie grave, pouvant être handicapante et dont l’issue peut être incertaine voire fatale.
Cependant, si un soutien psychologique peut indéniablement aider le malade à mieux supporter sa condition et à mieux lutter contre l’affection dont il est victime, ne serait-il pas envisageable également d’apporter au patient un soutien par la philosophie ?
En effet, la souffrance morale à laquelle est confronté le malade relève-t-elle toujours d’une réelle pathologie pouvant donner lieu à une démarche psychothérapeutique ?
Alors que la psychologie aide le malade à mieux se situer et à mieux comprendre sa manière de réagir par rapport à son histoire particulière, la philosophie ne pourrait-elle pas lui permettre de mieux appréhender sa condition du point de vue de l’universel, afin de mieux affronter la question du sens d’une existence dont le caractère fragile vient soudain s’imposer en mettant le sujet, de manière souvent brutale, en face de la finitude de l’existence humaine ?
Le recours à la philosophie dans le cadre d’un soutien aux malades ne peut cependant être envisagé sans qu’auparavant ait été développée une réflexion sur le sens même de la philosophie et sur la place qu’occupe l’éventualité de la maladie dans la condition humaine en général.
Reste à savoir comment cette pratique philosophique
en milieur hospitalier se réalise concrètement.
Dans le titre du troisième chapitre de son recueil de textes, Gerd B. Archenbac introduit un mot de son cru : « La praxis philosophique porte l’insigne de la Lebenskönnerschaft ». « (…) je peux facilement relier Lebenskönnerschaft à la notion de vertu (…) » souligne-t-il.
Pendant ce temps, la question essentielle reste exclue, celle-là même qui nous invite à un malaise philosophique salutaire. Il s’agit de la question de savoir à quoi se résume d’abord et finalement la vie, ce que serait une vie prise au sérieux. Seuls ceux dont la vie prend la forme d’une réponse à cette question trouvent la gaieté qui naît du calme, la souplesse qui naît d’une compréhension judicieuse. C’est à ces personnes que se consacre la Praxis philosophique. Elle les accueille sous le signe de la Lebenskönnerschaft.
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Chapitre 3 – La praxis philosophique porte l’insigne de la Lebenskönnerschaft, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), p. 25.

J’ai demandé à ChatGPT de me traduire le mot allemand « Lebenskönnerschaft » en français et voici les réponses.
Le mot allemand « Lebenskönnerschaft » est un terme assez rare et poétique, composé de :
« Leben » = vie
« Könnerschaft » = maîtrise, savoir-faire, expertise
Donc, « Lebenskönnerschaft » peut se traduire en français par :
👉 « la maîtrise de la vie » ou « l’art de savoir vivre », selon le contexte.
Il évoque l’idée d’une compétence ou d’un savoir profond pour bien vivre, pour naviguer avec sagesse, créativité ou sérénité à travers les défis de la vie.
Souhaitez-vous une traduction plus littéraire, philosophique ou pratique ?
OUI
Parfait, en optant pour une traduction philosophique, on peut approfondir le sens du mot « Lebenskönnerschaft » en le reliant à une idée plus existentielle et humaniste.
Une bonne traduction philosophique serait :
👉 « l’art de vivre avec maîtrise »,
ou encore :
👉 « la sagesse pratique de la vie »
👉 « la virtuosité dans l’existence »
Il s’agit de bien plus que de simplement « savoir vivre » : c’est une forme de compétence existentielle, une capacité à habiter sa vie avec intelligence, sens, justesse et profondeur, dans l’esprit des philosophies antiques (comme l’eudaimonia chez les Grecs) ou de penseurs comme Nietzsche ou Michel de Montaigne.
Ce mot évoque une maîtrise intuitive, expérimentée et incarnée de la vie, non pas technique ou académique, mais forgée par l’expérience, la réflexion et le courage d’être soi.
Souhaites-tu que je développe ça dans un petit texte philosophique ou une citation originale ?
OUI
La Lebenskönnerschaft, ou l’art de vivre avec maîtrise
Il est des savoirs que l’on n’enseigne pas dans les livres. La Lebenskönnerschaft — cette maîtrise de la vie — n’est pas une compétence que l’on acquiert par diplômes ou par recettes. Elle est un art subtil, une forme de sagesse incarnée, forgée lentement à travers les épreuves, les joies, les chutes et les recommencements.
Celui qui possède la Lebenskönnerschaft ne cherche pas à tout contrôler, mais sait danser avec l’incertitude, embrasser l’imprévisible, et reconnaître dans chaque instant un lieu possible de vérité. Il ne fuit pas l’absurde, mais le transfigure en sens. Il ne cherche pas la perfection, mais la justesse — dans ses gestes, ses paroles, ses silences.
C’est une virtuosité existentielle, discrète et profonde, comme un art de vivre sans masque, au plus près de soi, au plus proche des autres. Une philosophie vécue, à mi-chemin entre Montaigne, Nietzsche et le stoïcisme, où chaque jour devient une page blanche à habiter pleinement.
Maîtriser sa vie, non pas pour en faire une réussite selon les critères extérieurs, mais pour en faire une œuvre fidèle à son être — voilà peut-être le véritable sens de la Lebenskönnerschaft.
Qu’elle est votre source ?
Après quelques recherches, il apparaît que le terme « Lebenskönnerschaft » a été introduit par le philosophe allemand Gerd B. Achenbach, fondateur de la première pratique philosophique en 1981 . Il utilise ce terme pour décrire une forme de maîtrise de la vie, une compétence pratique et existentielle visant à vivre avec sagesse et authenticité . Ce concept est central dans son ouvrage intitulé « Lebenskönnerschaft », publié en 2001 .
Il me semble que la meilleure trauction de « Lebenskönnerschaft », est « compétences de vie ». Gerd B. Archenbach insiste sur la distinction de « Lebenskönnerschaft » à ne pas confondre avec « art de vivre ».
The aim of the art of life is happiness; Lebenskönnerschaft aims at being
worthy of happiness.
Life-artists shape their lives; the Lebenskönner prove themselves in life. Artists of life win over; the Lebenskönner stands upon what is right.
Artists of life are flexible; the Lebenskönner is upright.
Artists of life attach a meaning to their life; the Lebenskönner lives up to one.
The art of living seeks joy in life; Lebenskönnerschaft seeks to survive a vain, pale and wrongful life.
The one knows to makes virtue out of necessity; the other proves virtue in need.
The art of life flees shadow and seeks light; Lebenskönnerschaft flees twi- light, seeks both light and shadow.
Artists of life give an answer to life’s questions; the Lebenskönner seeks the question to which life is the answer.5
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Chapitre 3 – La praxis philosophique porte l’insigne de la Lebenskönnerschaft, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), p. 25.
Traduction en français avec DeepL
Le but de l’art de vivre est le bonheur; la Lebenskönnerschaft vise à être digne du bonheur.
Les artistes de la vie façonnent leur vie, les Lebenskönner font leurs preuves dans la vie. Les artistes de la vie séduisent; les Lebenskönner s’en tiennent à ce qui est juste.
Les artistes de la vie sont flexibles; le Lebenskönner est droit.
Les artistes de la vie donnent un sens à leur vie; le Lebenskönner en donne un.
L’art de vivre recherche la joie de vivre; la Lebenskönnerschaft cherche à survivre à une vie vaine, pâle et erronée.
L’un sait faire de la vertu par nécessité, l’autre prouve la vertu par besoin.
L’art de la vie fuit l’ombre et cherche la lumière; Lebenskönnerschaft fuit le crépuscule, cherche à la fois la lumière et l’ombre.
Les artistes de la vie donnent une réponse aux questions de la vie; le Lebenskönner cherche la question à laquelle la vie est la réponse.5
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Chapitre 3 – La praxis philosophique porte l’insigne de la Lebenskönnerschaft, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), p. 25.
Gerd B. Archenbach consacre le quatrième chapitre de son recueil à la communication sous le titre « La maîtrise de la conversation ». Ce sujet revêt une très grande importance à mes yeux depuis mon adolescence. Je m’inscris dans cette génération croyant que tout problème peut être solutionner avec une meilleure communication. Gerd B. Archenback introduit ce chapitre en ces mots :
Parler de maîtrise de la conversation [Gesprächskönnerschaft], c’est d’abord en introduire l’idée même dans la conversation. En effet, j’entends ici introduire ce terme — calqué sur celui de Lebenskönnerschaft, avec lequel il a un air de famille évident — comme une entrée dans la conversation sur la conversation. Tel est l’objet de l’étude qui suit.
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Chapitre 4 – La maîtrise de la conversation, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), p. 35.
Parler avec aisance ne signifie que l’on sait communiquer et encore moins converser avec l’Autre. Étudier la communication interpersonnelle m’apparaît essentiel dans la philosophie pratique. Gerd B. Archenbach écrit « l’écoute doit être maîtrisée », « elle n’est pas un don naturel ».
L’ÉCOUTE EST L’ÂME DE LA CONVERSATION
Un proverbe allemand dit : « On apprend à parler plus tôt qu’à écouter ». Et, d’ailleurs, à entendre plus tôt qu’à écouter. L’ouïe est un don de la nature; la capacité d’écoute, en revanche, est une ressource dont peu de gens disposent. En effet, elle n’est pas un don naturel, mais doit être cultivée pour devenir une compétence. En d’autres termes, l’écoute doit être maîtrisée, être capable d’écouter [zuhören zu können] est l’essence même de la maîtrise de la conversation.
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Chapitre 4 – La maîtrise de la conversation, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), p. 36.
« Ce qui importe, ajoute Gerd B. Archenbach, c’est de comprendre l’écoute non pas comme une pure passivité ou une simple réception, mais, comme une activité ». Mais encore faut-il en avoir le désir et la volonté.
Gerd B. Archenbach appelle à la prudence « car, pour parler exactement, on ne peut pas savoir comment l’autre se comprend lui-même; même dans le meilleur des cas, c’est plutôt une question de conjecture. »
Pourquoi une telle prudence ? N’y a-t-il pas des tas de théories prêtes à décoder l’être humain ? Certes, mais ne perdons pas de vue qu’au mieux, c’est « L’être humain » que nos théories décodent, et non pas et jamais celui-là même avec lequel nous conversons. Dans tous les cas, ce n’est qu’avec lui que la conversation est possible. On ne peut pas converser avec l’humanité, mais seulement avec un humain.
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Chapitre 4 – La maîtrise de la conversation, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), p. 38.
Gerd B. Archenbach parle de « conversation en quête de conseils » dont il cerne les contours en donnant la parole à Blaise Pascal et à Walter Benjamin.
Quand on veut corriger avec avantage, et faire voir à un autre qu’il se trompe, il faut remarquer de quel côté il regarde la chose, car de ce côté elle est ordinairement vraie, et lui avouer cette vérité, mais lui découvrir le côté où elle est fausse. Il en est satisfait, car il voit qu’il ne s’est pas trompé, et qu’il a seulement manqué de voir tous les côtés.
Blaise Pascal, Pensées. Traduites par W.F. Trotter
(New York : E. P. Dutton, 1958), n° 9.
Ne cherchez pas à dissuader. Quiconque se voit demander son avis ferait bien de commencer par découvrir l’opinion de son interlocuteur, puis de l’approuver. Personne n’est facilement persuadé de la plus grande intelligence d’un autre, et peu de gens demandent des conseils avec l’intention de suivre ceux d’un autre. Le fait est qu’ils ont déjà [pris leur décision dans l’intimité de leur esprit] et qu’ils souhaitent maintenant l’entendre de l’extérieur, l’accepter comme le « conseil » d’un autre. C’est cette confirmation qu’ils recherchent, et ils ont raison de le faire. En effet, il est très risqué d’entreprendre de mettre en œuvre ses propres décisions sans les faire passer par les échanges de la conversation, comme à travers un filtre. C’est pourquoi celui qui demande conseil est déjà à mi-chemin d’une décision; et si ce qu’il projette de faire est une erreur, il vaut mieux lui apporter un soutien sceptique que de le contredire avec conviction.
Walter Benjamin
Légèrement adapté de Walter Benjamin, Selected Writings, vol. 2, part 2, 19311934. Ed. par Michael W. Jennings, Howard Eiland et Gary Smith (Cambridge, MA : Belknap, 1999), 588. Voir la Séquence d’Ibiza, avril-mai 1932. J’ai (le traducteur Michael Picard) dû ajouter les mots « prendre leur décision dans l’intimité de leur propre esprit » pour souligner l’intention de « im Stillen schon gefaßt », une phrase à laquelle Achenbach fait spécifiquement référence plus tard, mais qui n’est pas rendue littéralement dans la traduction existante. Achenbach cite les Gesammelte Schriften, vol. IV/1, 403.
Blaise Pascal et Walter Benjamin cités par : ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Chapitre 4 – La maîtrise de la conversation, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), p. 41.
P.S.: Nous ajoutons ces références :
La confrontation dans la pratique philosophique de conseil n’a pas sa place : « (…) il vaut mieux lui apporter un soutien sceptique que de le contredire avec conviction » (Walter Benjamin).
Si ces citations de conseils attirent et retiennent mon attention depuis les premières ligne de mon rapport de lecture, c’est en raison de mon expérience avortée de formation au conseil philosophique avec Oscar Brenifier. Je vous réfère donc à mon article « Article # 12 – Fin du chapitre : Oscar Brenifier, philosophe praticien ».
Article # 41
La philothérapie – Un état des lieux
par Serge-André Guay
Observatoire québécois de la philothérapie8. Un peu de psychothérapie dans la philothérapie
L’histoire révèle un lien étroit entre la psychologie et la philosophie, la première ayant été longtemps considérée comme une branche de la seconde. Malheureusement, ce lien est plutôt ténu entre la philothérapie et la psychothérapie. Or, le philothérapeute doit être un fin psychologue lors de la consultation avec son client, non seulement pour établir une relation de confiance et prouver sa bienveillance, mais aussi et surtout pour identifier les biais cognitifs chez son client. Or, rare trouve-t-on en philothérapie une attention portée à ces biais cognitifs, principal obstacle à la logique nécessaire à la quête de sens.
Les chercheurs Xiaojun Ding (Xi’an Jiaotong University) et Feng Yu (Wuhan University) écrivent :
Le quatrième aspect est la relation entre la pratique philosophique et d’autres disciplines ou professions d’aide telles que le conseil psychologique et la thérapie. Une mission importante de la pratique philosophique contemporaine au début de son émergence était de remettre en question les présupposés théoriques ainsi que les méthodes et les effets du conseil et de la thérapie psychologiques. La plupart des chercheurs considèrent le conseil philosophique comme une alternative au conseil et à la thérapie psychologiques, visant à fournir aux personnes des conseils pour une vie rationnelle de manière autonome et à éviter l’utilisation de tout moyen psychothérapeutique (Achenbach 1998 ; Marinoff 2002 ; Raabe 2010). Cependant, Russell (2001) soutient qu’il n’y a pas de distinction claire et sans ambiguïté entre le conseil philosophique et la psychothérapie, ne serait-ce qu’en comparant ce que font les conseillers philosophiques et les psychothérapeutes et pourquoi ils le font. Amir (2004) souligne également qu’une partie décisive du conseil philosophique est la connaissance et l’expérience psychologiques pertinentes des conseillers philosophiques ; sinon, les conseillers philosophiques seront très probablement perdus dans leur propre labyrinthe philosophique.
Source : Ding, X.; Yu, F. Philosophical Practice as Spiritual Exercises towards Truth, Wisdom, and Virtue. Religions 2022, 13, 364. https://doi.org/10.3390/rel13040364. Les auteurs : Xiaojun Ding, Department of Philosophy, School of Humanities and Social Sciences, Xi’an Jiaotong University, China. Feng Yu, Department of Psychology, School of Philosophy, Wuhan University, China. Article distributed under the Creative Commons Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
Le philothérapeute se doit de disposer d’une connaissance psychologique des relations interpersonnelles pour servir adéquatement son client en consultation. Dans leurs propos ci-dessous, le chercheurs Xiaojun Ding (Xi’an Jiaotong University) et Feng Yu (Wuhan University) parle aussi de l’expérience psychologique pertinente des philothérapeutes.
Entreprendre une consultation philosophique exige donc de prendre grand soin de ne pas éveiller les mécanismes de défense du client, plus souvent qu’autrement de nature psychologique. La provocation tout comme la répression des émotions et des justifications poussent ces mécanismes de défense à entrer en action et engendrer des frustrations ne facilitant pas le dialogue.
Source et lire la suite: Article # 41 – La philothérapie – Un état des lieux par Serge-André Guay, Observatoire québécois de la philothérapie.
Le chapitre 5, « La règle du jeu de la praxis philosophique », Gerd B. Archenback nous introduit à son sujet en ces mots :
La praxis philosophique est confrontée à une exigence qui a été étrangère à la philosophie académique : au lieu de présenter aux gens les problèmes de base qui préoccupent le philosophe académique, la praxis philosophique doit se calibrer sur les thèmes, les problèmes et les formulations de questions qui accablent les autres, ceux qui, dans leur besoin, se sont tournés vers la philosophie pour obtenir de l’aide. Ce n’est donc pas la philosophie qui ouvre le bal, mais les questions posées au philosophe.
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Chapitre 5 – La règle du jeu de la praxis philosophique, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), p. 51.
Plus loin, Gerd B. Archenbac nous invite a porter attention au philosophe Bertrand Russel et à son livre « Problèmes de la philosophie » et, plus particulièrement au chapitre “La valeur de la philosophie” :
(…) Intitulé « La valeur de la philosophie », ce chapitre (en contradiction louable avec le ton initial, dans lequel nous reconnaissons le pathos de la philosophie fondationnaliste) expose une philosophie si peu prétentieuse, si sceptiquement sage, si vivement orientée vers la vie, qu’il est difficile d’en imaginer une qui soutiendrait mieux les aspirations de la Praxis philosophique.
Sans prétendre examiner le chapitre dans son intégralité, je soulignerai au moins quelques passages particulièrement mémorables, passages que j’admets joyeusement avoir trouvés inspirants. Son tout premier point décrivant l’utilité unique et caractéristique de la philosophie suppose déjà qu’elle est totalement distincte du profit que nous tirons avant tout de la recherche scientifique et technique. La philosophie, affirme-t-il, tire son efficacité, à la différence des autres sciences, « de ses effets sur la vie de ceux qui l’étudient ». 25
____________
NOTE
25. Russell, Problems, 89. Russell conclut : « L’utilité n’appartient pas à la philosophie », bien que, comme nous le verrons plus tard, il parle de “son utilité pour montrer des possibilités insoupçonnées” (91).
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Chapitre 5 – La règle du jeu de la praxis philosophique, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), p. 60.
Il revient donc au philosophe praticien de pouvoir confesser les effets de la philosophie sur sa propre vie, le moment conversationnel venu. Et on parle des effets « sur la vie », non pas seulement en sa conscience, son intellect, son esprit, mais aussi et surtout dans son comportement dans son quotidien. L’invité (le client) doit se trouver en conversasion avec un philosophe, un philosophe lui-même philosophe, un exemple de ce qu’est un vrai philosophe. Il ne suffit pas de philosopher pour être philosophe mais d’ÊTRE philosophe dans son âme et son corps, dans ses idées, certainement, dans son compotement, nécessairement. Et cela dès le premier contact avec l’invité (le client).
Gerd B. Archenbach cite donc un passage du chapitre “La valeur de la philosophie” du livre « Problèmes de la philosophie » de Bertrand Russel :
L’homme qui n’a aucune teinture de philosophie traverse la vie emprisonné dans les préjugés dérivés du sens commun, des croyances habituelles de son âge ou de sa nation, et des convictions qui ont grandi dans son esprit sans la coopération ou le consentement de sa raison délibérée. Pour un tel homme, le monde tend à devenir défini, fini, évident; les objets communs ne suscitent aucune question et les possibilités inconnues sont rejetées avec mépris. Dès que nous commençons à philosopher, au contraire, nous découvrons que même les choses les plus quotidiennes conduisent à des problèmes auxquels on ne peut donner que des réponses très incomplètes. La philosophie, bien qu’incapable de nous dire avec certitude quelle est la vraie réponse aux doutes qu’elle soulève, est en mesure de suggérer de nombreuses possibilités qui élargissent notre pensée et la libèrent de la tyrannie de la coutume. Ainsi, tout en diminuant notre sentiment de certitude quant à ce que sont les choses, elle augmente considérablement notre connaissance de ce qu’elles peuvent être; elle supprime le dogmatisme quelque peu arrogant de ceux qui n’ont jamais voyagé dans la région du doute libérateur, et elle entretient notre sens de l’émerveillement en montrant des choses familières sous un aspect peu familier.27
____________
NOTE
27. Russell, Problèmes, 91.
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Chapitre 5 – La règle du jeu de la praxis philosophique, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), pp. 60-61.
Le chapitre 6, « Sur les commencements » traite de l’amorce de la conversation.
Dans la praxis philosophique, ce n’est pas la philosophie qui commence. Dans la praxis philosophique, c’est l’invité qui fait le commencement. Pour illustrer cette relation par une image tirée du jeu d’échecs, je dirais que le visiteur choisit les pièces blanches. C’est-à-dire que celui qui vient à nous commence.
Mais si nous devions penser cela comme une règle, la première chose et l’ouverture ne serait précisément pas le visiteur, mais au début il y aurait la règle, cette direction, ou — pour le dire formellement — le cadre. N’y a-t-il pas là une contradiction ? C’est évident. Mais on peut y remédier.
Je modifie la phrase d’introduction et je dis : Moi, le praticien de la philosophie, je dois faire le début pour que le visiteur puisse commencer. Ou encore : je commence par lui faciliter le début en lui rendant le début possible. Je n’ouvre pas la conversation, mais j’ouvre l’espace qui doit être ouvert à l’invité, afin qu’il puisse à son tour entamer la conversation.
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Chapitre 6 – Sur les commencements, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), p. 65.
Consacrer tout un chapitre aux commencements avec l’invité démontre à quel point il faut l’accueillir avec bienveillance et une solidarité exemplaire.
REMARQUES FINALES
Le commencement ne se fait pas par la compréhension d’un problème. Ce qui est montré au début, c’est plutôt si nous avons compris le problème du début, si, dès le début, nous nous comprenons nous-mêmes. (C’est ce que nous appelons la connaissance de soi [Umgangswissen]).
Le commencement ne se fait pas non plus à partir du problème que l’autre personne est censée avoir. Nous commençons par notre invité, et seulement ensuite, en second lieu, par ses problèmes.
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Chapitre 6 – Sur les commencements, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), p. 78.
L’invité devant vous est d’abord un individu et non pas d’abord le problème qu’il porte à votre attention. La maxime « Vous n’aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression » (David Swanson) s’applique en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance. Pour les commencements, le philosophe praticien doit prendre garde de ne pas déclencher les mécanismes de défense de son invité.
Dans le huitième chapitre, « La philosophie comme professions », Gerd B. Archenbach affirme d’entrée de jeu et sans dérour que « Non seulement la praxis philosophique n’est pas une nouvelle thérapie, mais elle n.est absolument pas une thérapie.3 » « (3. Note d’Achenbach : je ne propose ici qu’un court extrait d’une première conférence sur la praxis philosophique que j’ai donnée à l’université d’Osnabrück en 1982. Pour la version complète, voir Gerd B. Achenbach, Zur Einführung der Philosophischen Praxis (Cologne : Dinter, 2010), 147-159.) » Voilà qui m’interroge sur le nom que j’ai donné à cette observatoire « Observatoire de la philothérapie ». Mais le débat au sujet de l’aspect thérapeutique de la philosophie pratique reste ouvert.
Pour le dire brièvement, en une phrase qui, amplifiée philosophiquement, ferait jaillir toute la philosophie de la Praxis philosophique : La praxis philosophique est une conversation libre.
Mais qu’est-ce que cela signifie ? Ou du moins : Qu’est-ce que cela signifie, si une amplification complète de cette affirmation ne peut être réalisée pour le moment ? Cela signifie que la praxis ne s’embarrasse pas de systèmes philosophiques, ne construit pas de philosophie, n’administre pas d’idées philosophiques, ne prescrit pas de philosophe. Elle se contente de mettre la pensée en mouvement : elle philosophe.
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Chapitre 7 – La philosophie comme profession, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), p. 84.
Là, je suis ravi ! Une conversation LIBRE. J’entends OUVERTE, NON DIRIGÉE ! Il ne s’agit d’une conversation sur tout et n’importe quoi pour le défoulement de l’invité et du philosophe praticien.
En journalisme, une seule question est de mise et sera servie en commencement de l’entrevue par l’intervieweur à l’interviewé. Un entretien dit professionnel ne portera donc pas sur tout et n’importe. Quoi, les questions s’enchaineront toujours à partir des réponses données librement.
Évidemment, cette procédure ne s’applique pas à conversion de la philosophie pratique mais il faut ici en retenir un lien avec le dialogue socratique.
Malheureusement, certains philosophes praticiens se lancent dans le dialogue socratique avec une grande violence qui tue toute les possibilités d’une conversation. Personnellement, j’ai eu l’impression, lors d’ateliers tenus en ligne à l’initiative de philosophes praticiens, que ces derniers voulaient prendre en défaut de contradiction chacun des participants, comme s’il était question pour eux de remporter un trophée. Donner une telle impression devrait préoccuper haut plus point le philosophe praticien comme l’obstétricien devrait se préoccuper de la première impression qu’il donne à sa patiente lors de l’accouchement.
L’art du questionneur
François Renaud, professeur, département de philosophie, Université de Moncton (Nouveau-Brunswick, Canada)
Extrait
Le dialogue, conçu par Socrate lui-même comme un échange entre égaux, apparaît comme un idéal qui n’est pas réalisé dans les dialogues (dits socratiques). Le principe de réciprocité des rapports dialectiques, qui permet à chaque interlocuteur de questionner et de répondre, reste purement formel. En réalité, seul Socrate connaît l’art du questionnement et ses diverses stratégies. Le dialogue socratique constitue d’abord et avant tout un dialogue pédagogique. Le but ultime du dialogue, soit la pleine formation philosophique (et donc la pleine indépendance) de l’interlocuteur n’est jamais atteint: l’interlocuteur reste au stade de l’apprenti, dépendant (et souvent récalcitrant) par rapport au maître (Szlezk 1987). En remplissant les deux rôles à la fois, celui de questionneur et de répondeur, Socrate démontre qu’il peut au besoin se passer de l’interlocuteur malgré ses déclarations contraires à cet effet (cf. 519d7-el). De plus, en formulant et la question et la réponse, Socrate prédétermine les propos de l’autre (cf. Loraux 1998). À cet égard, la méthode de Socrate peut apparaître manipulative, voire autocratique. Certains commentateurs n’hésitent pas à opposer le dialogue socratique à la discussion ouverte et équilibrée, qu’ils associent par exemple à Protagoras (cf. Havelock 1958).
Les intéressés peuvent se référer aux propos de Gerd B, Archenbach au sujet de dialogue socratique au sous titre « OBSTETRIQUES : UN BREF RETOUR SUR SOCRATE » (OBSTETRICS: A BRIEF LOOK BACK AT SOCRATES) au chapitre 4 « La maîtrise de la conversation », page 43.
Le huitième chapitre du receuil de Gard B. Archenbach, « Éducation et praxis philosophique — Søren Kierkegaard et la question de savoir qui est un praticien de la philosophie ». En introduction, il cite Nietzsche et ajoute :
La seule critique possible d’une philosophie, et la seule qui prouve quelque chose, est d’essayer de voir si l’on peut vivre selon cette philosophie, et cela n’a jamais été enseigné dans aucune université. La seule pensée qui y est enseignée est la critique des mots sur les mots.
― Friedrich Nietzsche3
« La question qui se pose à nous4 est de savoir si — et si oui, de quelle manière — la praxis philosophique est une pratique d’éducation [Bildung].
Puisque cette question est posée à Copenhague, nous pourrions tout aussi bien nous interroger sur la relation entre la praxis philosophique et Søren Kierkegaard lui-même. Dans ce contexte, nous pourrions même justifier le titre « Praxis philosophique sur les traces de Søren Kierkegaard », puisque le Danois est certainement appelé à devenir l’une des principales sources d’orientation de notre philosophie pratique, si ce n’est pas déjà le cas. J’ajoute : Pour moi, il compte en effet parmi les plus importants contributeurs et incitateurs d’idées.
____________
NOTES
2. Friedrich Nietzsche, Unfashionable Observations. Dans les Œuvres complètes de Friedrich Nietzsche, II. Traduit par Richard T. Gray (Stanford, CA : Stanford University Press, 1995), 246. Utilisé avec l’autorisation de l’auteur.
3. Le mot allemand Bildung est notoirement impossible à traduire; c’est pourquoi, dans les travaux universitaires, il est parfois laissé sans traduction. Ici, malgré ses limites, le mot « éducation » est utilisé pour Bildung tout au long du texte, à quelques exceptions près, notamment dans les citations de traductions existantes de sources qui utilisent d’autres mots (tels que « culture » ou « image » ou « forme »). Les termes « autoformation », « éducation » ou « enculturation » ont des connotations plus appropriées dans de nombreux contextes, mais la cohérence semblait importante. Ces interprétations alternatives valides montrent clairement ce qui devient évident dans ce chapitre, à savoir que le terme « éducation » ne doit en aucun cas être considéré comme une éducation formelle ou une accréditation. Voir également le chapitre 7 ci-dessus sur la « Praxis philosophique en tant que profession ».
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Chapitre 8 – Éducation et praxis philosophique, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), p. 89.
P.S.: Nous vous suggérons ces références :
- Søren Kierkegaard, Wikipédia.
- The Concept of Irony With Continual Reference to Socrates. Traduit par Howard et Edna Hong (Princeton, NJ : Princeton University Press, 1989), InternetArchive.
Le neuvième chapitre, « La praxis philosophique et les vertus », Gerd B. Archenbach présente la vertu comme un « art de vivre » dont le philosophe praticien doit lui-même faire l’expérience.
Ainsi, pour résumer ces premières considérations, je dirai que la vertu est un art qui s’acquiert et se développe tout au long de la vie : La vertu, en tant qu’art de vivre acquis tout au long de la vie, est au centre même de la praxis philosophique. Car c’est ce que les visiteurs de la pratique recherchent pour eux-mêmes — le savoir-faire pour bien mener sa vie, ou au moins mieux — que le philosophe-praticien recherche également, si cette recherche ne constitue pas déjà la philosophie en tant que telle dans son plus grand sérieux. Il en est ainsi depuis Socrate. Il en a été ainsi (historiquement à mi-chemin entre Socrate et nous) pour mon ami Michel de Montaigne : « Notre grand et glorieux chef-d’œuvre est de vivre convenablement. Toutes les autres choses — gouverner, amasser, construire — ne sont que de petits appendices et des accessoires, tout au plus ».4 Et, pour citer un témoin contemporain très respecté, il en est encore ainsi aujourd’hui, comme l’atteste avec désinvolture le philosophe Hilary Putman : « la question philosophique centrale est de savoir comment vivre »5.
____________
4. Michel de Montaigne, Les Essais complets de Montaigne, traduits par Donald M. Frame (Standford, Standford University Press, 1958), 851. La citation originale est la traduction allemande de Tietz (Zürich : Diogenes, 1992), vol. 3, 428.
5. Le contexte immédiat est remarquable et contient une qualification, plus précisément une attribution, qu’Achenbach supprime. Putnam écrit : « pour James, comme pour Socrate, la question philosophique centrale est de savoir comment vivre » (italiques dans l’original). Mais le contexte plus large montre clairement que Putnam lui-même approuve le point de vue qu’il attribue ici à d’autres. La suite mérite également d’être citée : « Mais pour James, comme pour Socrate et ses successeurs, l’opposition entre la philosophie qui s’intéresse à la façon de vivre et la philosophie qui s’intéresse à des questions techniques difficiles est une fausse opposition ». Hilary Putnam, Pragmatisme : An open question (Oxford : Blackwell, 1995), 22.
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Chapitre 9 – La praxis philosophique et les vertus, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), p. 104.
Le dixième chapitre pose trois questions en titre : « Qu’est-ce qui est important ? Qu’est-ce qui est important dans la vérité ? Qu’est-ce qui est crucial en fin de compte ? ». Une seule citation s’impose :
Voici donc la thèse selon laquelle l’important n’est pas ce que Socrate a dit aux gens, mais ce qui compte, c’est ce qu’il était lui-même. J’ai affirmé cette thèse afin d’en élucider une autre, à savoir : ce que nous disons à ceux qui viennent nous rendre visite dans notre pratique est secondaire; bien plus crucial est ce que nous avons nous-mêmes « laissé dire ».22
____________
NOTE
22. Il y a une allusion à l’Eingelassenheit; voir chapitre 4.
ARCHENBACH, Gerd B., Philosophical praxis, Chapitre 10 – Qu’est-ce qui est important ? Qu’est-ce qui est important dans la vérité ? Qu’est-ce qui est crucial en fin de compte ?, Lexington Books (An imprint of Rowman & littlefield), p. 119.
Le onzième chapitre, « Caractère et destin – La pratique philosophique a beaucoup à apprendre de Schopenhauer », et le douzième chapitre, « La praxis philosophique comme alternative à la psychothérapie et à la pastorale » ferment la marche proposée par cet ouvrage.
- Article #130 – L’art de se connaître soi-même, Arthur Schopenhauer, Rivages poche, 2015
- Voir le site web offrant les oeuvres d’Arthur Schopenhauer en libre téléchargement.
En guise de conclusion de ce rapport de lecture
Les propos du fondateur d’une innovation, en l’occurence ici ceux de Gard B. Archenbach sur la Paxis pilosophique, et dans ce cas sur des dizaines d’années d’expérimentation, offre aux lecteurs de boire à la source une eau pure avant toute autre interprétation et misinterprétation.
Tout ce que j’ai lu dans ce livre, je ne le retrouve pas dans la littérature francophone. Aussi, je me demande si la praxis philosophique dans le monde francophone n’évolue pas dans un ghetto en raison de la barrière de la langue, dans ce cas, celle entre l’allemand et le français. Aujourd’hui, la traduction de l’allemand à anglais d’une douzaine d’interventions de Gerd B. Archenbach, fondateur de la praxis philosophique, ouvre une porte à une plus grande diffusion de son expérience auprès de la population maîtrisant l’anglais.
Pour ma compréhension personnelle et puisque je ne me maîtrise pas l’anglais suffisamment pour en capter toutes nuances, j’ai traduit de l’anglais au français ce recueil de texte avec des logiciels spécialisés, d’où les extraits et les citations traduits dans ce rapport de lecture pour le bénéfice du monde francophone.
Ma lecture de « Philosophical Praxis – Origin, Relations, and Legacy » de Gerd B. Achenbach me donne beaucoup à penser. Il s’agit, pour moi, d’une nouvelle compréhension de la pratique philosophique dans sa version originale.
Mon premier contact avec la pratique philosophique a lieu en l’an 2000 lors de la parution de la traduction de l’anglais au français du livre « Platon, pas Projac ! » de Lou Marinoff. Je comprends alors que la philosophie peut nous aider à mieux vivre en se proposant comme piste de résolution de nos problèmes personnels et professionnel. La découverte m’enchante.
Puis, en 2020, je découvre la « philothérapie » dans la francophonie européenne à de nombreux livres portant en titre cette nouvelle appellation de la philosophie pratique. La théorie exposée dans ces publications me semble presque parfaite. Seules quelques propos soulèveront des appréhensions et seront l’objet de mes critiques, notamment, le copinage avec la psychologie qui sera le sujet de mon deuxième article le 11 octobre 2020.
J’ai déjà une dent contre la psychologie en raison de son manque d’efficacité depuis ma lecture en 1989 du livre « Séduction psychologique – Échec de la psychologie moderne » du psychologue américain William Kirk Kilpatrick. On peut imaginer ma réaction à la lecture du livre « Happycratie » en 2018.
Notez que l’appellation « philothérapie » dispraîtra presqu’entièrement de la bibliographie francophone européenne au fil des ans. On ne veut plus associer la pratique philosophique à une « thérapie »; un débat fait rare à savoir si la philosophie possède ou non un aspect thérapeutique.
Ce débat restera et demeure encore aujourd’hui ouvert mais il cédera sa place à une confrontation directe de la pratique philosophique avec le développement personnnel, du moins dans la francophonie européenne :
- Article # 63 – Contre le développement personnel. Thiery Jobard, Éditions Rue de l’échiquier, 2021
- Article # 65 – Développement (im)personnel – Le succès d’une imposture, Julia de Funès, Éditions de l’observatoire/Humensis, 2019
- Article # 81 – L’empire des coachs – Une nouvelle forme de contrôle social, Roland Gori et Pierre Le Coz, Éditions Albin Michel, 2006
- Article #106 – Crise de soi – Construire son identité à l’ère des réseaux sociaux et du développement personnel, Thierry Jobard, coll. Amorce, Éditions 10/18, 2024
- …
J’observe que la pratique philosophique dans le monde francophone européen souffre d’un manque de balises parce qu’elle éjecte les émotions de l’invité (le client) et lui manque ainsi de respect.
Mon expérience avec Oscar Brenifier, fondateur de l’Institut de philosophie pratique en France, sera désastreuse.
Mais cet accident ne m’empêche pas de conserver mon intérêt pour la philosophie pratique et je poursuis mes lectures et la publication de mes rapports de lecture.
De temps à autre, je consulte le site web de Gerd B. Archenbach jusqu’au jour, eurêka, j’apprends la publication en anglais de son livre « Philosophical praxis ». Ma lecture de ce recueil de texte me réconcilie avec la philosophie pratique parce qu’il place la personne (l’invité – le client) en priorité avec le plus grand des respects.
Je conseille à tous le livre Philosophical Praxis, Origin, Relations, and Legacy de Gerd B. Achenbach , traduit par Michael Picard, et paru chez Lexington Books – An imprint of The Rowman & Littlefield Punlishing Group, Inc. en 2024. Ce livre mérite cinq étoiles sur cinq.

Acheter ce livre auprès de Rowman & Littlefield Punlishing Group

Cliquez ici pour acheter ce livre sur le site web leslibraires.ca




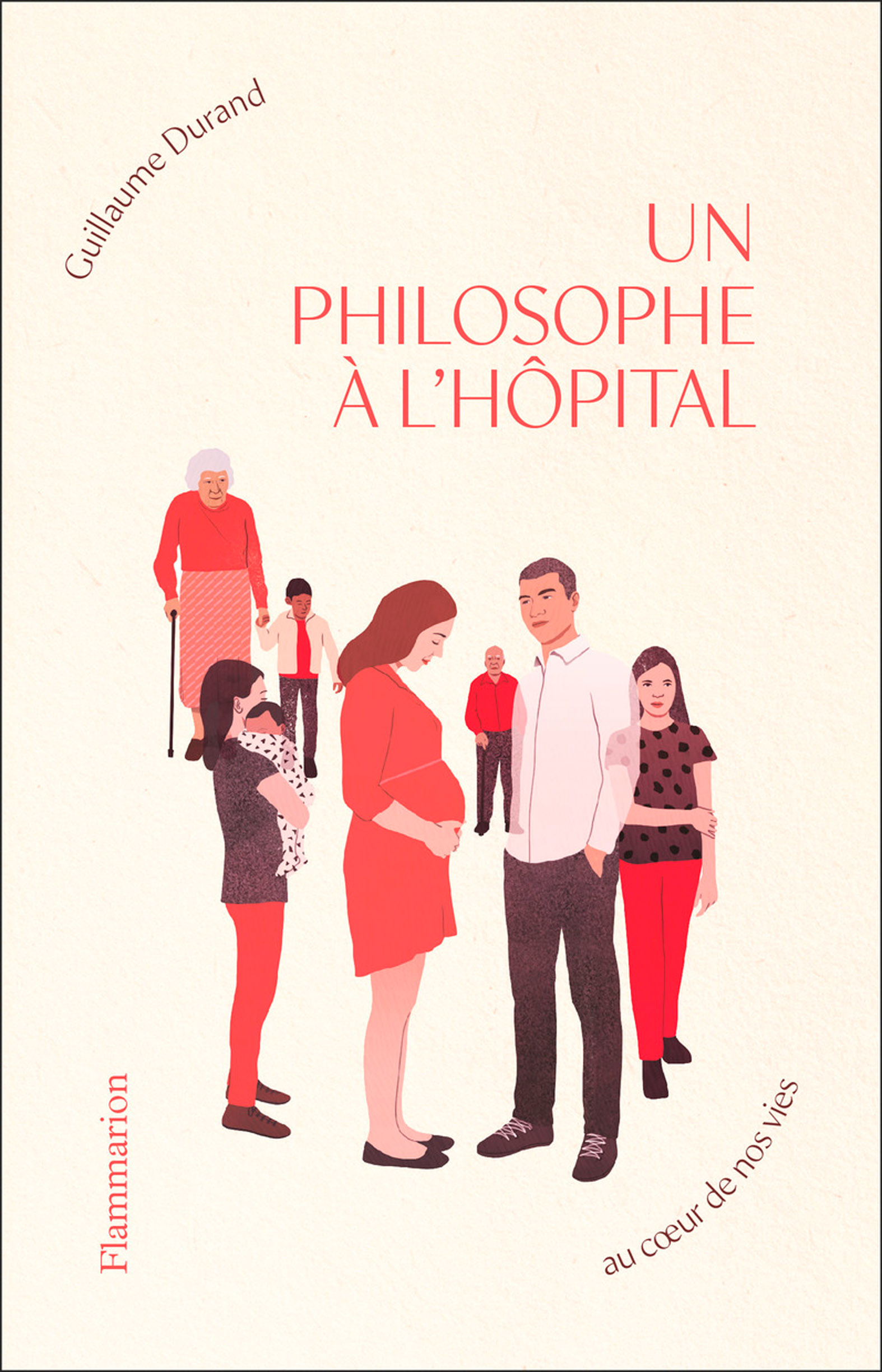




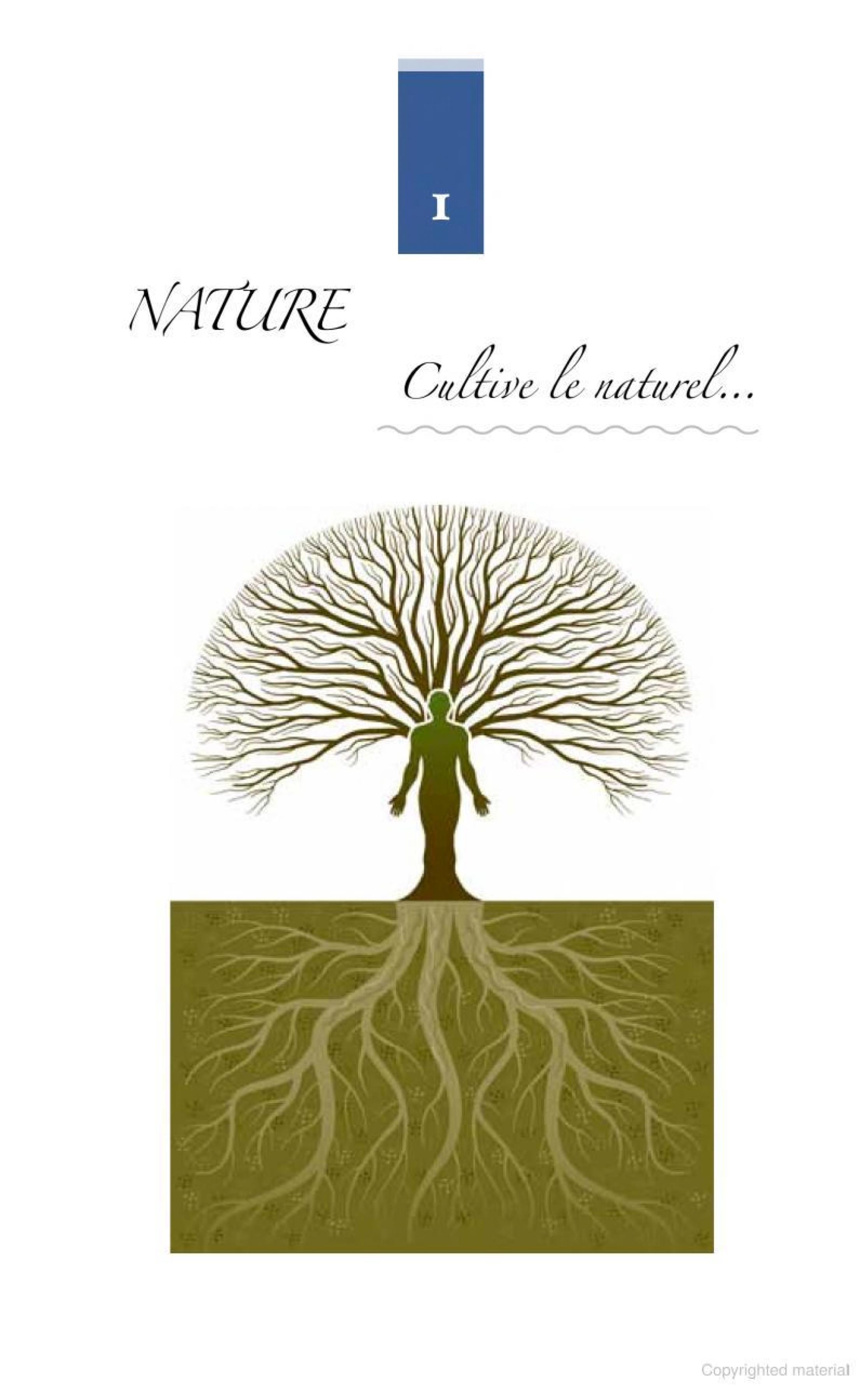
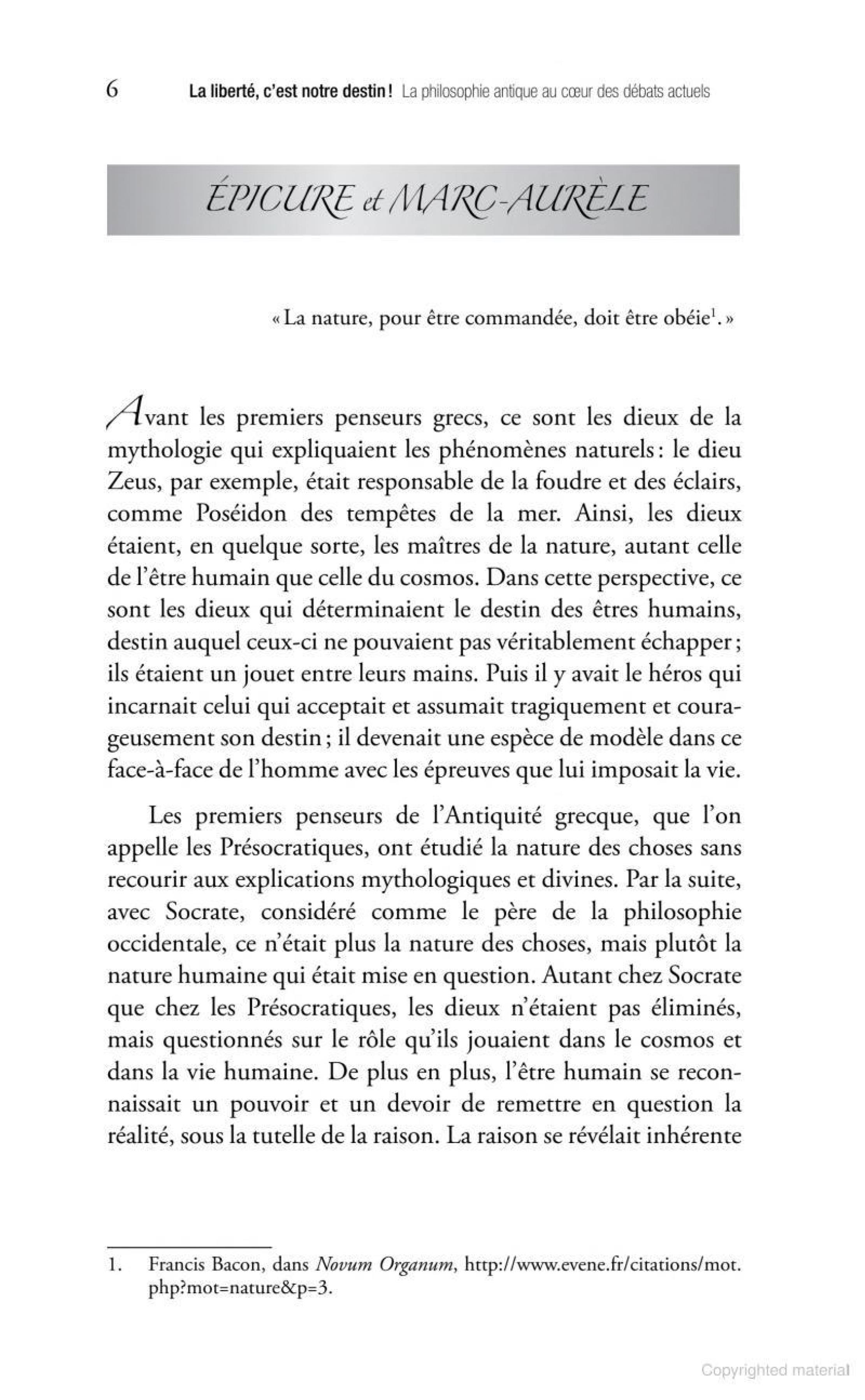

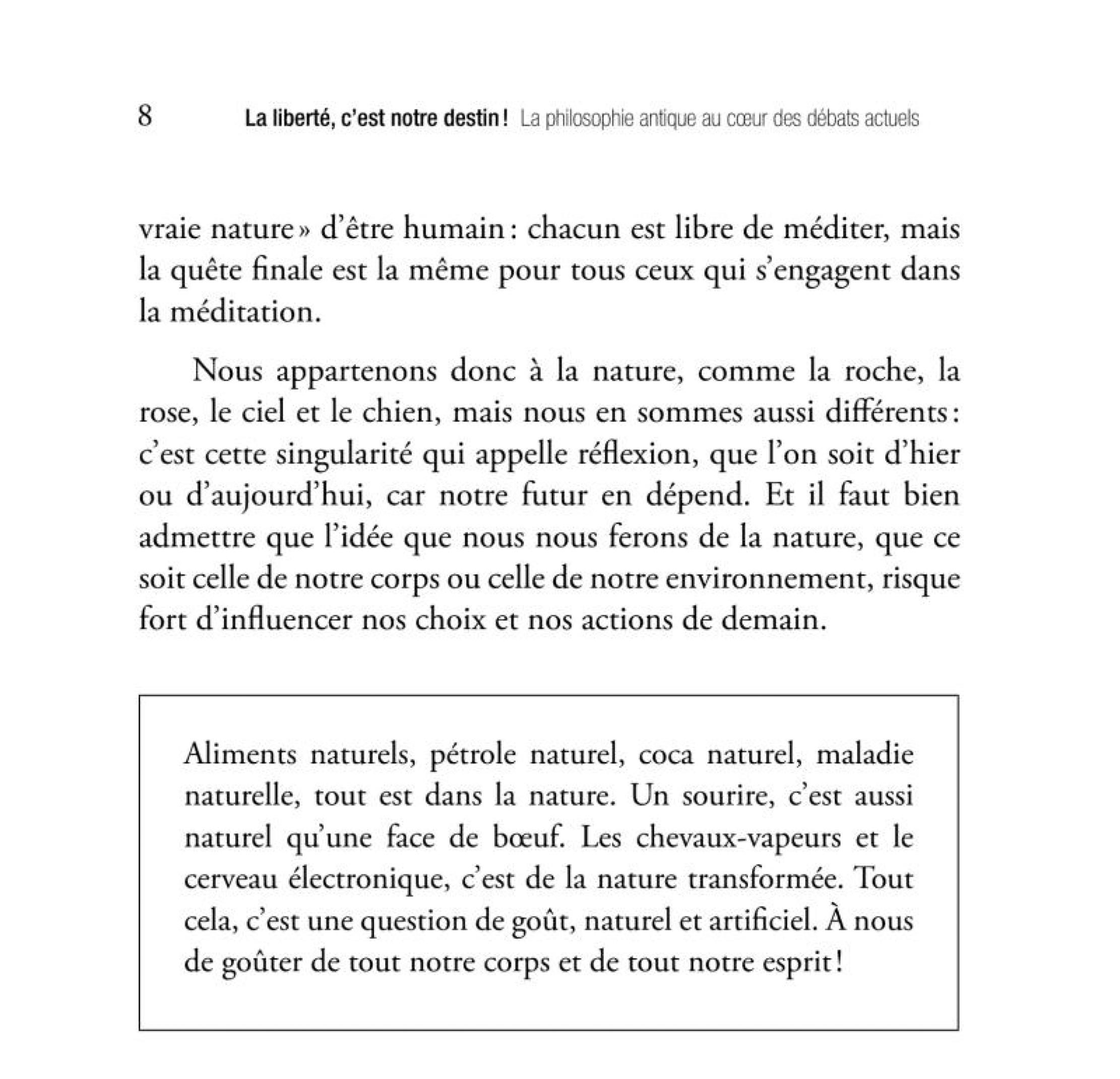



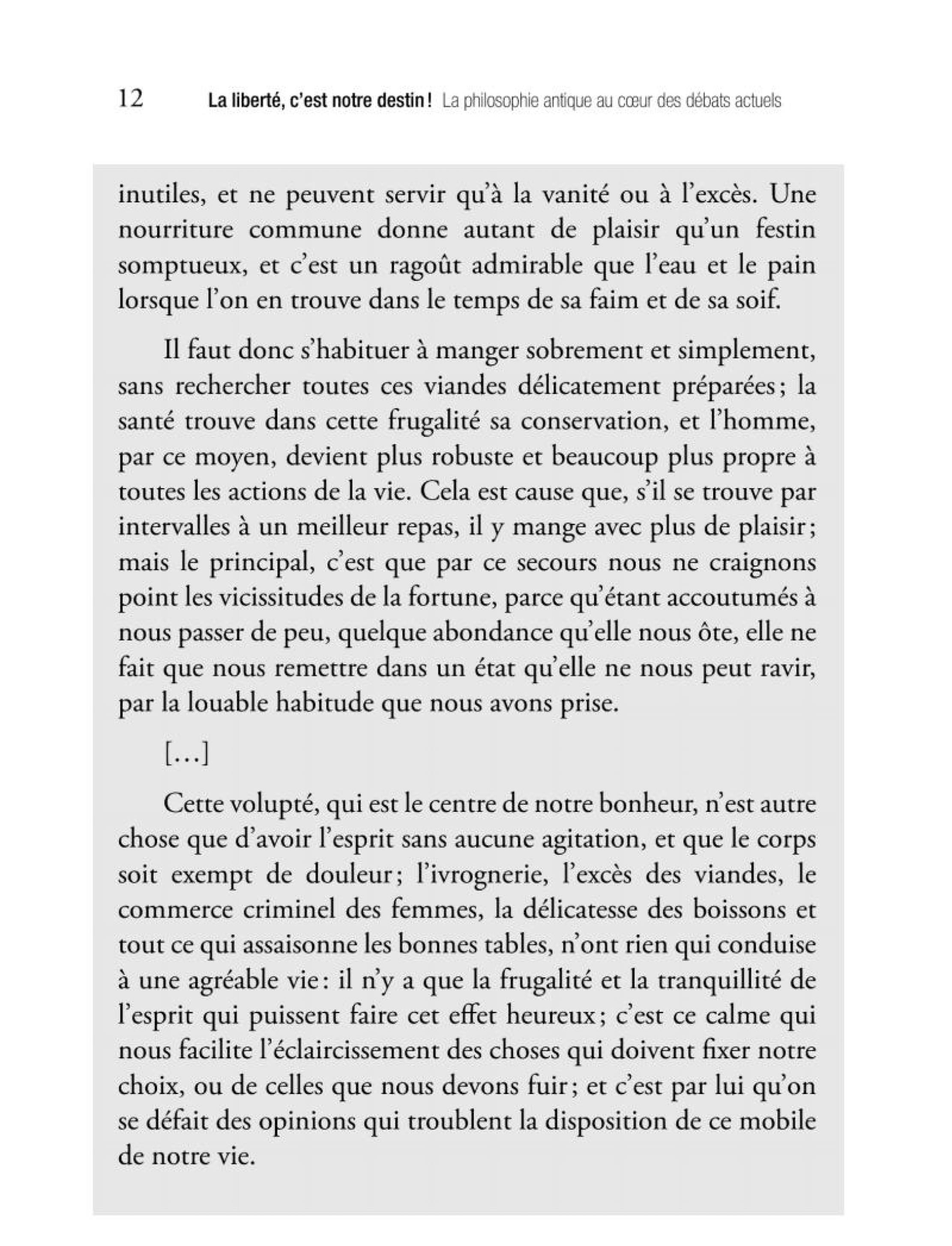
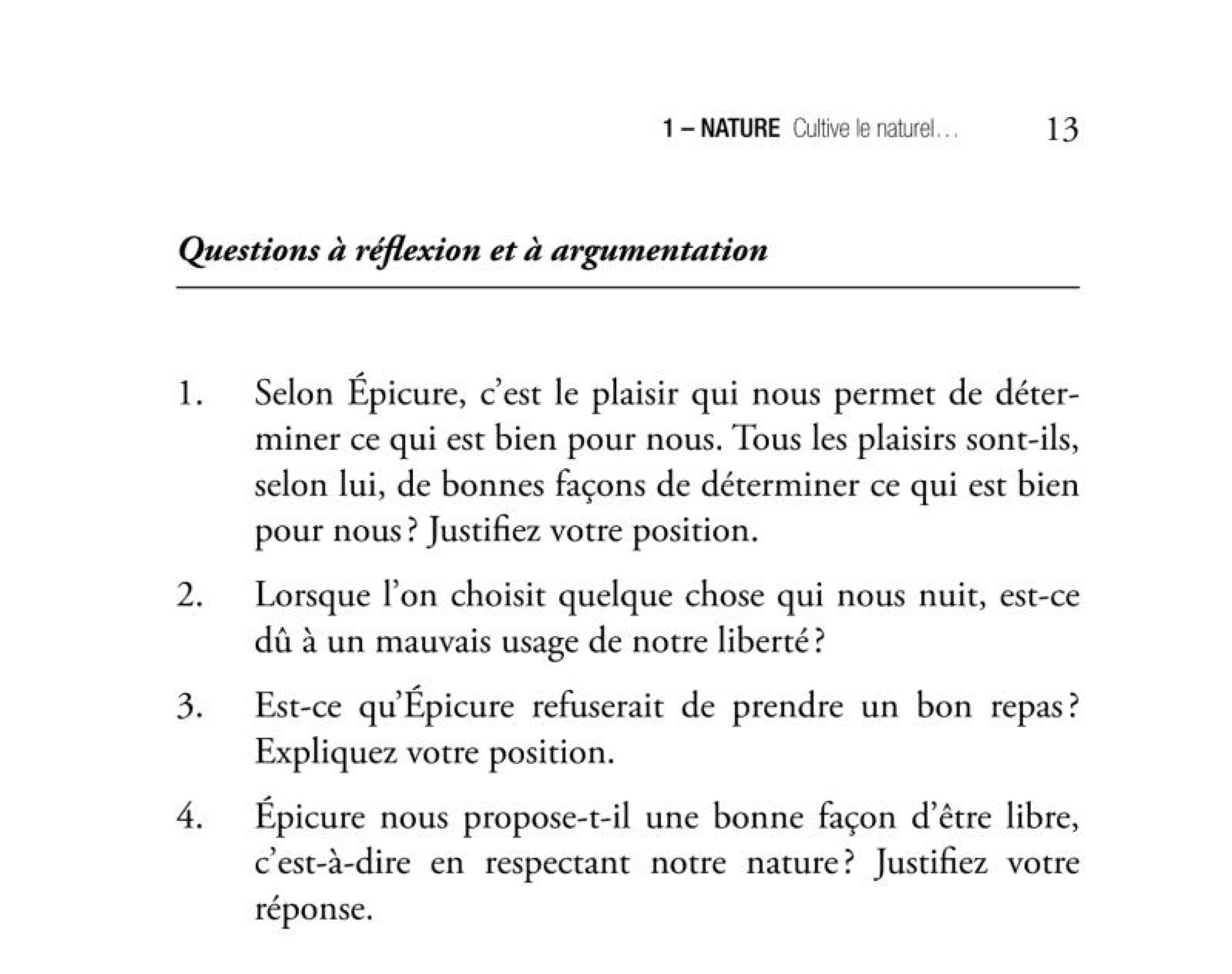


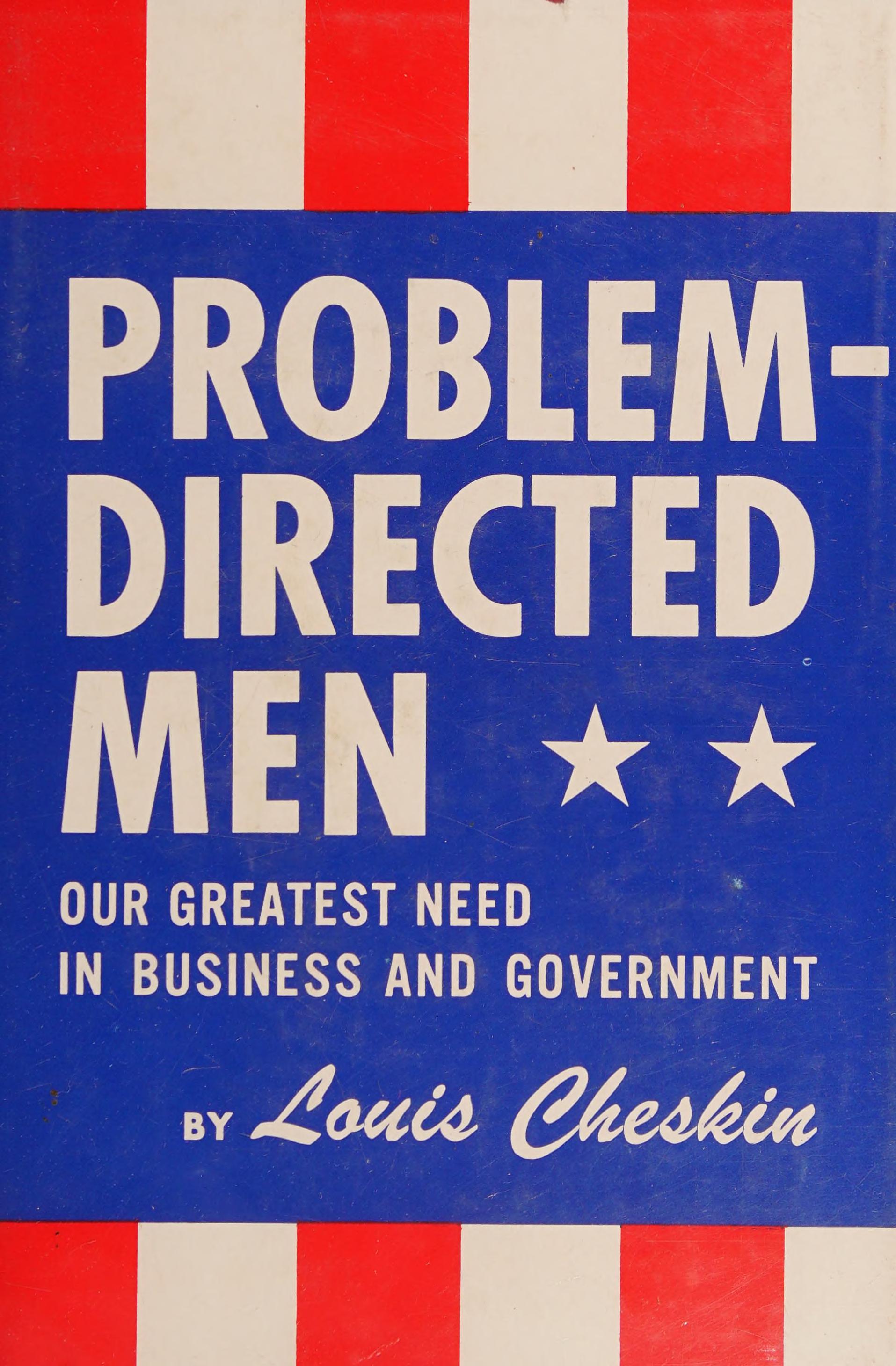
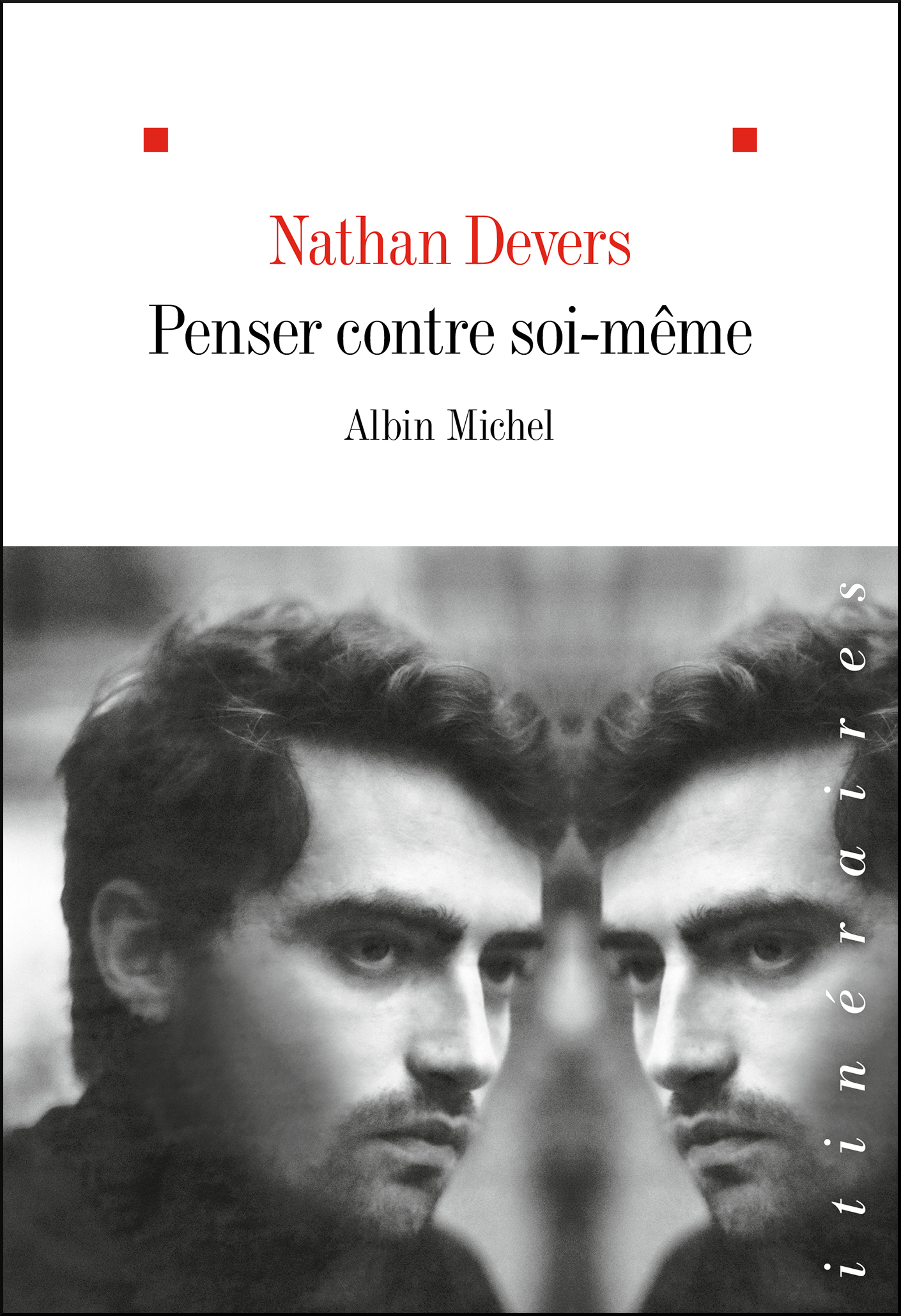

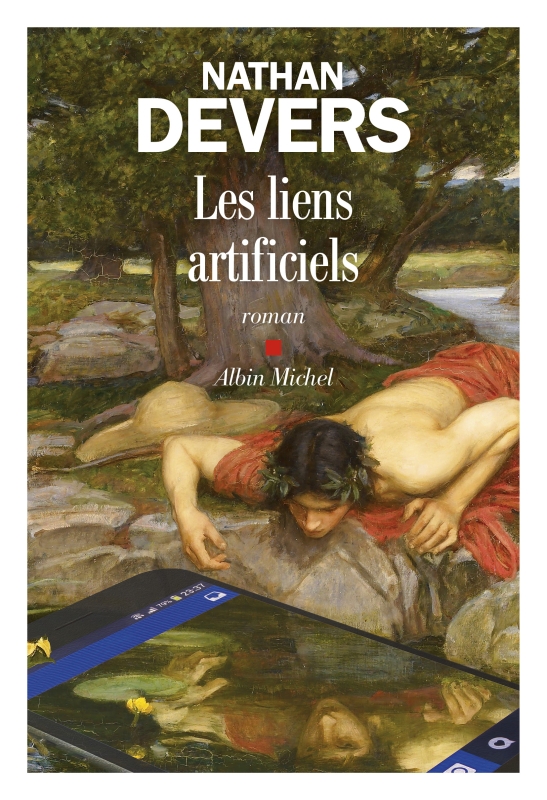
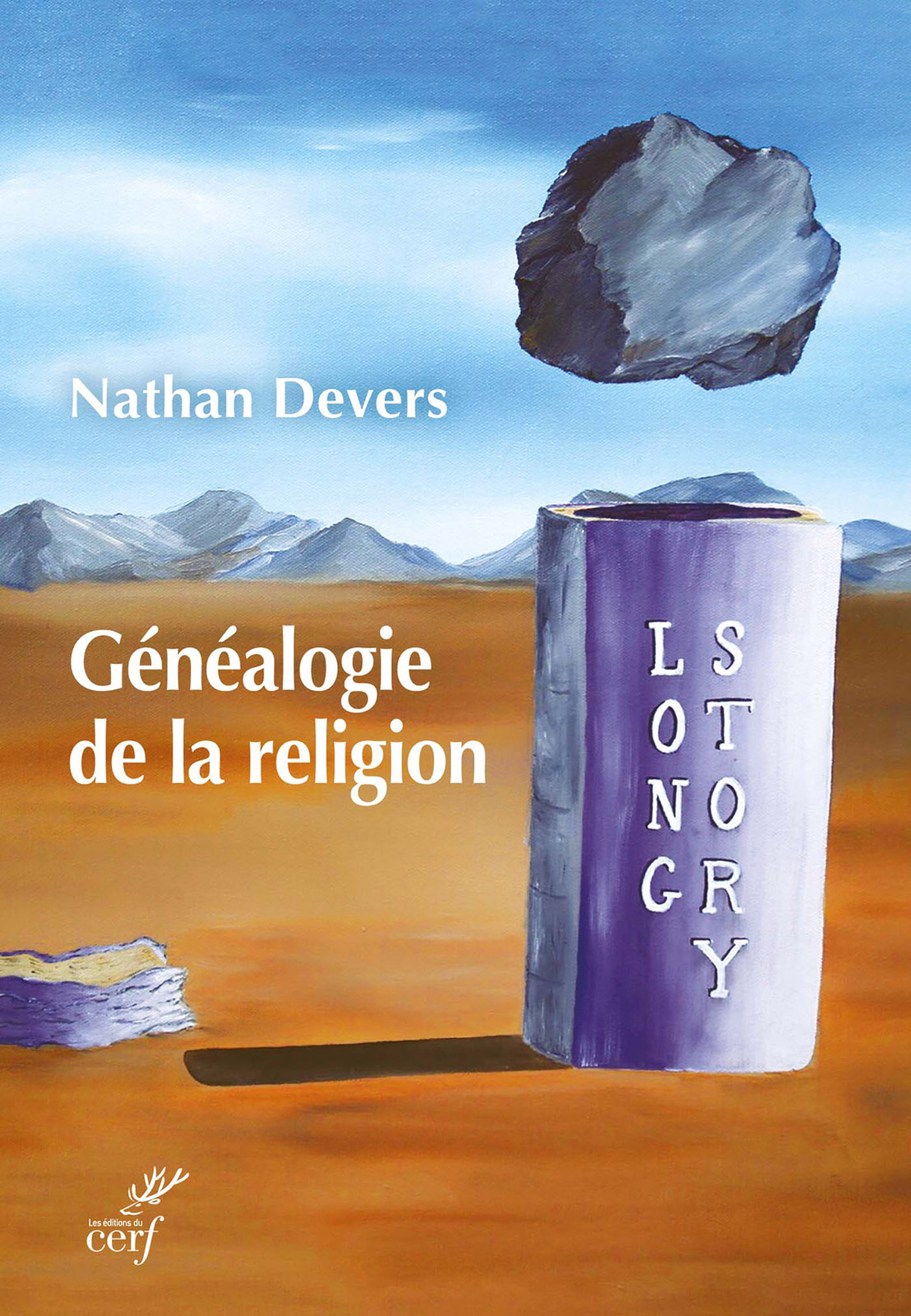
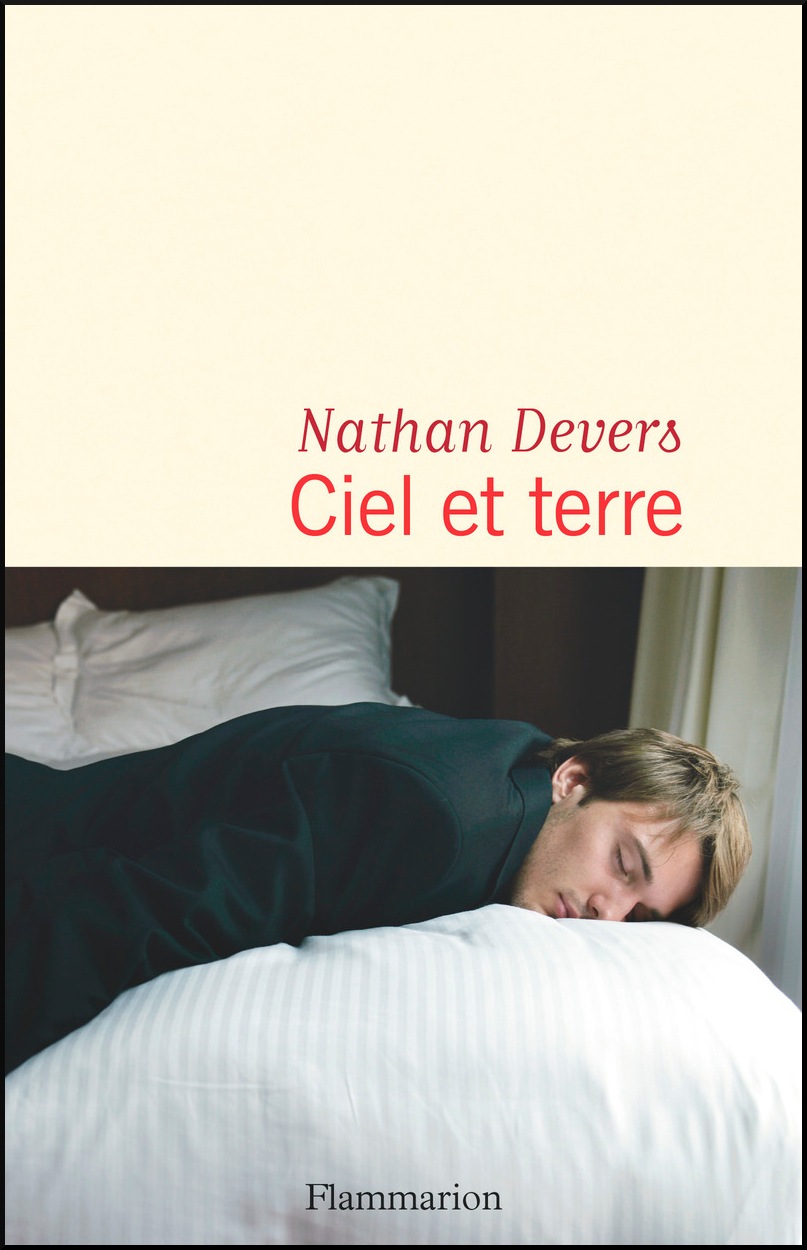
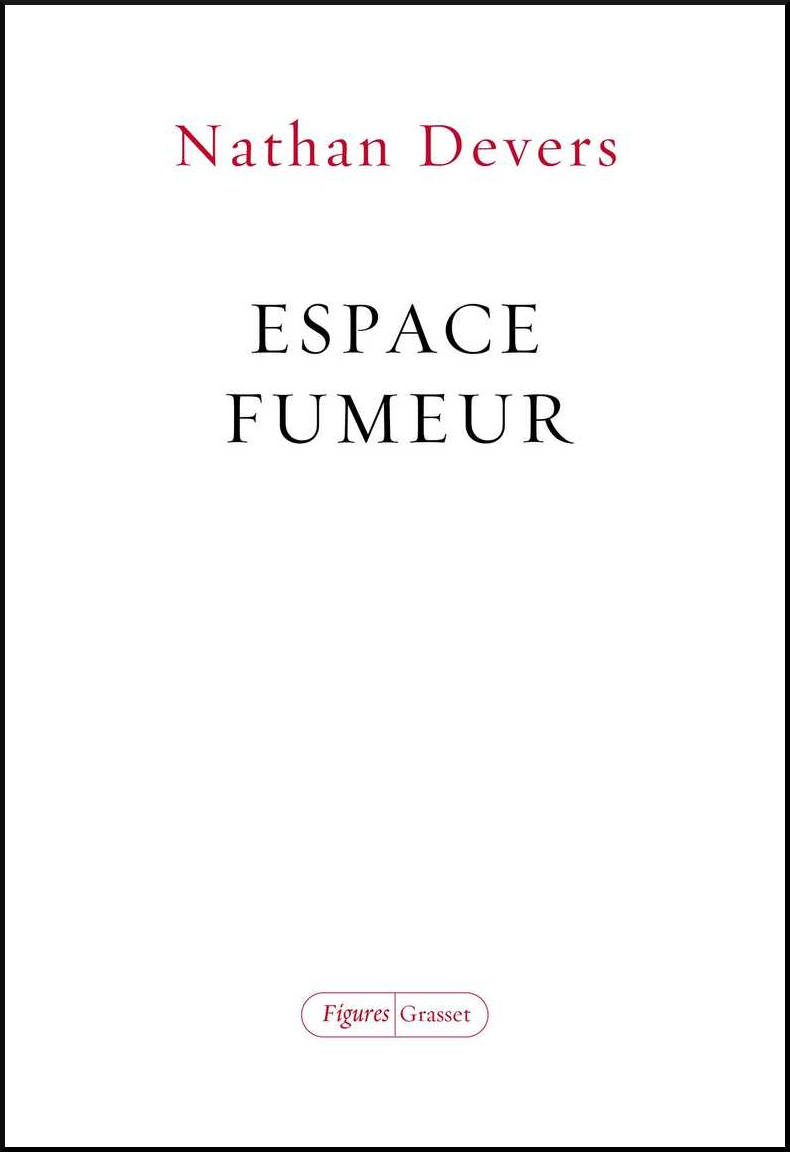
 La théorie de la connaissance (Erkenntnistheorie en allemand), ou philosophie de la connaissance ou encore
La théorie de la connaissance (Erkenntnistheorie en allemand), ou philosophie de la connaissance ou encore  Lorsque l’on aborde l’épistémologie pour la première fois, il faut se montrer prudent car le sens du terme varie. Par epistemology, un anglophone réfère en général à une branche spécialisée de la philosophie, la théorie de la connaissance. Les francophones pour leur part se servent plutôt du terme pour désigner l’étude des théories scientifiques. En fait, comme le note avec justesse Pierre Jacob, les deux acceptions sont étymologiquement justifiées, car le « mot grec épistèmê (qui s’oppose au mot doxa qui signifie « opinion ») peut être tantôt traduit par le mot « science », tantôt par le mot « savoir » »1. On peut réconcilier ces deux acceptions en parlant, de manière très générale, de l’épistémologie comme de la théorie de la connaissance scientifique. Dans l’ensemble des textes que l’on trouvera sur ce site, on utilisera d’abord et avant tout ce sens, plus proche du versant français du terme.
Lorsque l’on aborde l’épistémologie pour la première fois, il faut se montrer prudent car le sens du terme varie. Par epistemology, un anglophone réfère en général à une branche spécialisée de la philosophie, la théorie de la connaissance. Les francophones pour leur part se servent plutôt du terme pour désigner l’étude des théories scientifiques. En fait, comme le note avec justesse Pierre Jacob, les deux acceptions sont étymologiquement justifiées, car le « mot grec épistèmê (qui s’oppose au mot doxa qui signifie « opinion ») peut être tantôt traduit par le mot « science », tantôt par le mot « savoir » »1. On peut réconcilier ces deux acceptions en parlant, de manière très générale, de l’épistémologie comme de la théorie de la connaissance scientifique. Dans l’ensemble des textes que l’on trouvera sur ce site, on utilisera d’abord et avant tout ce sens, plus proche du versant français du terme.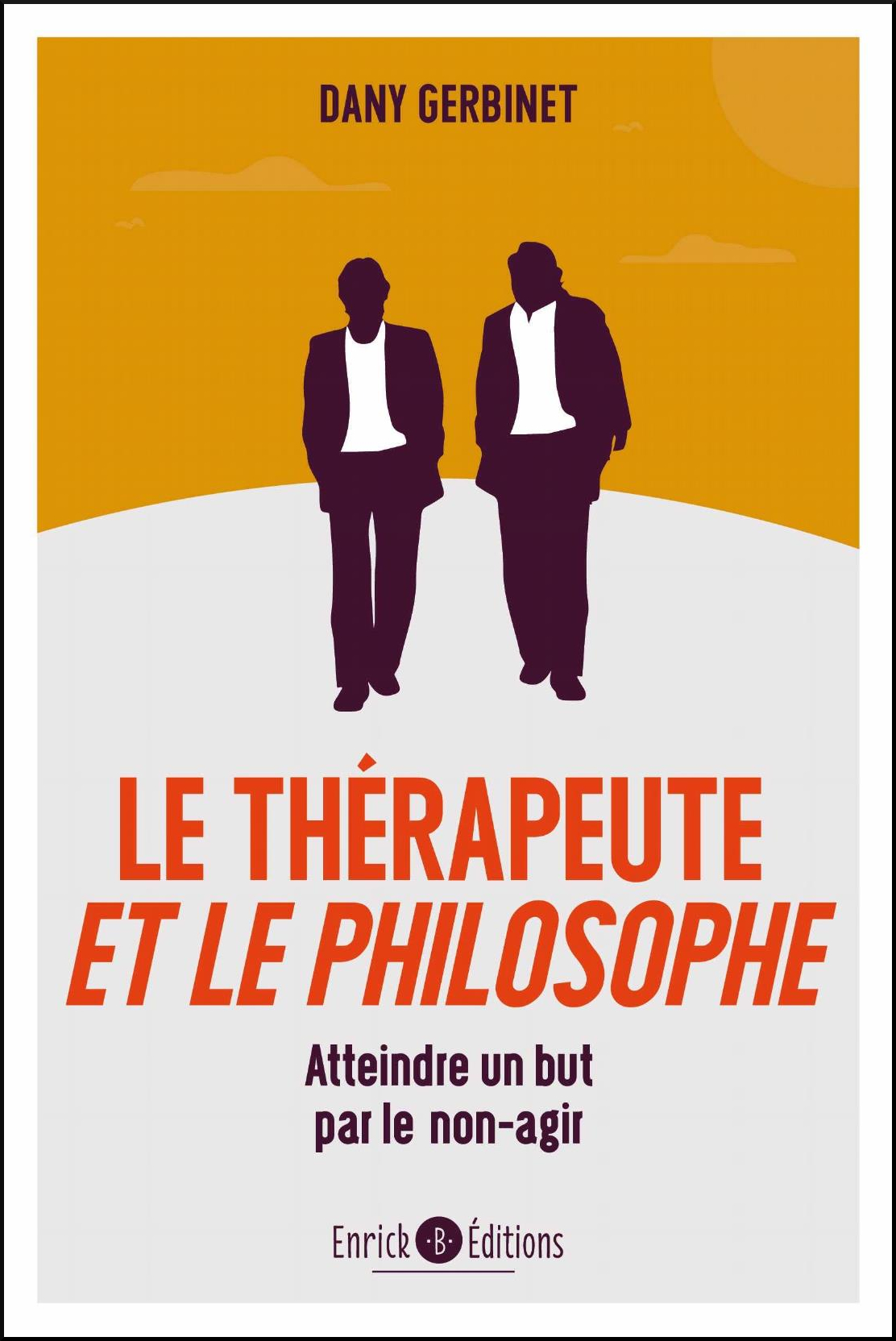
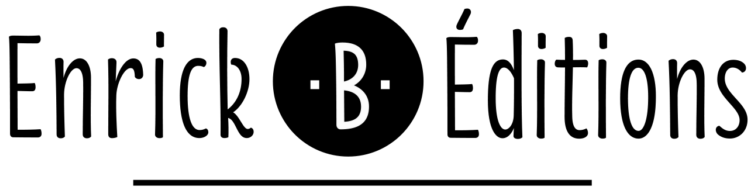

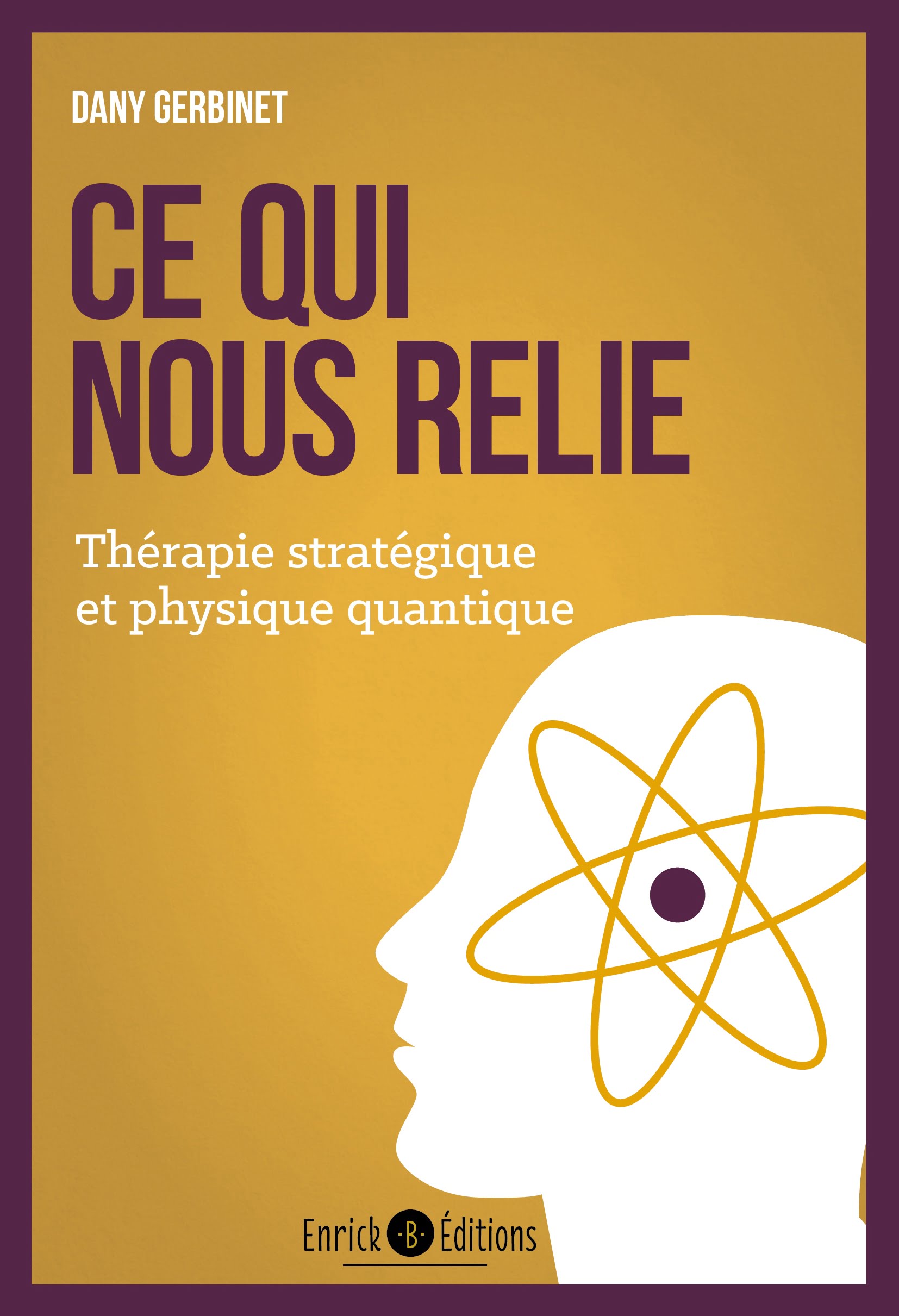


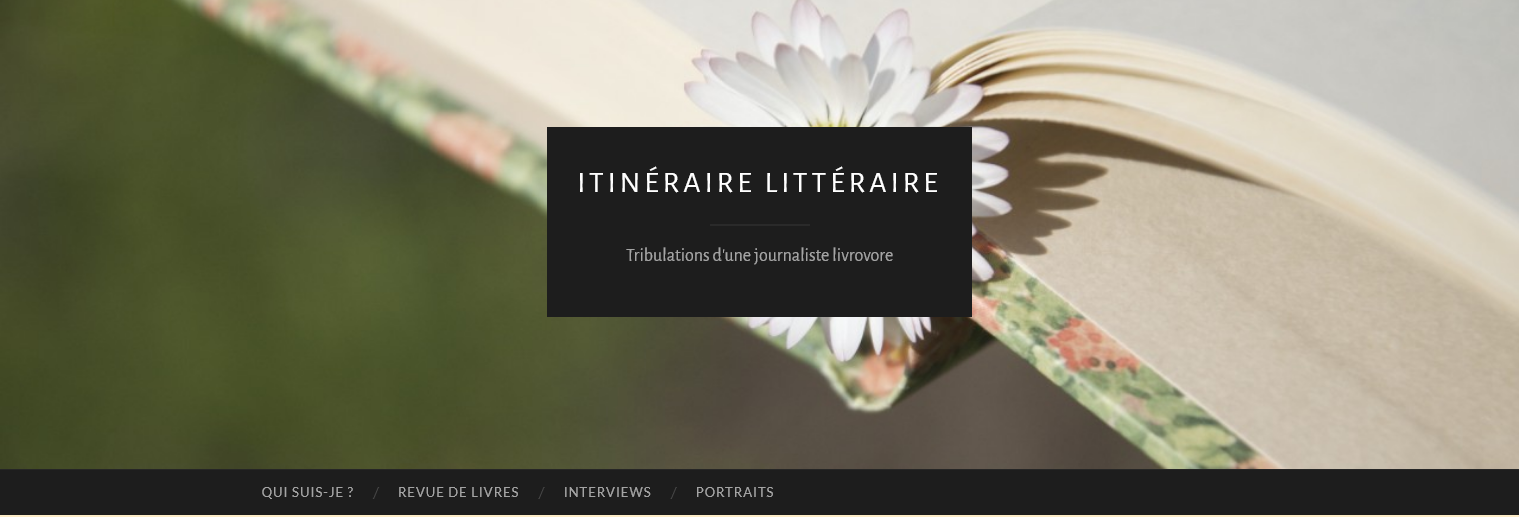

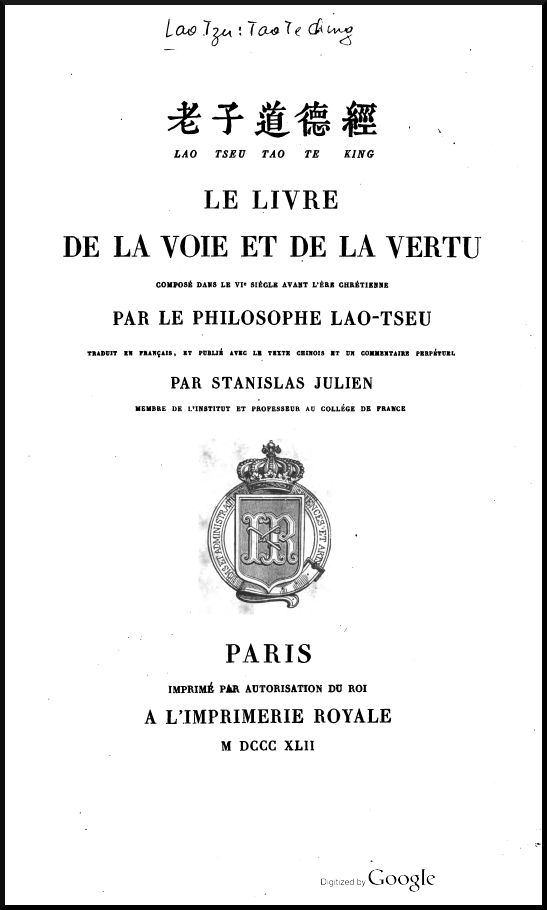
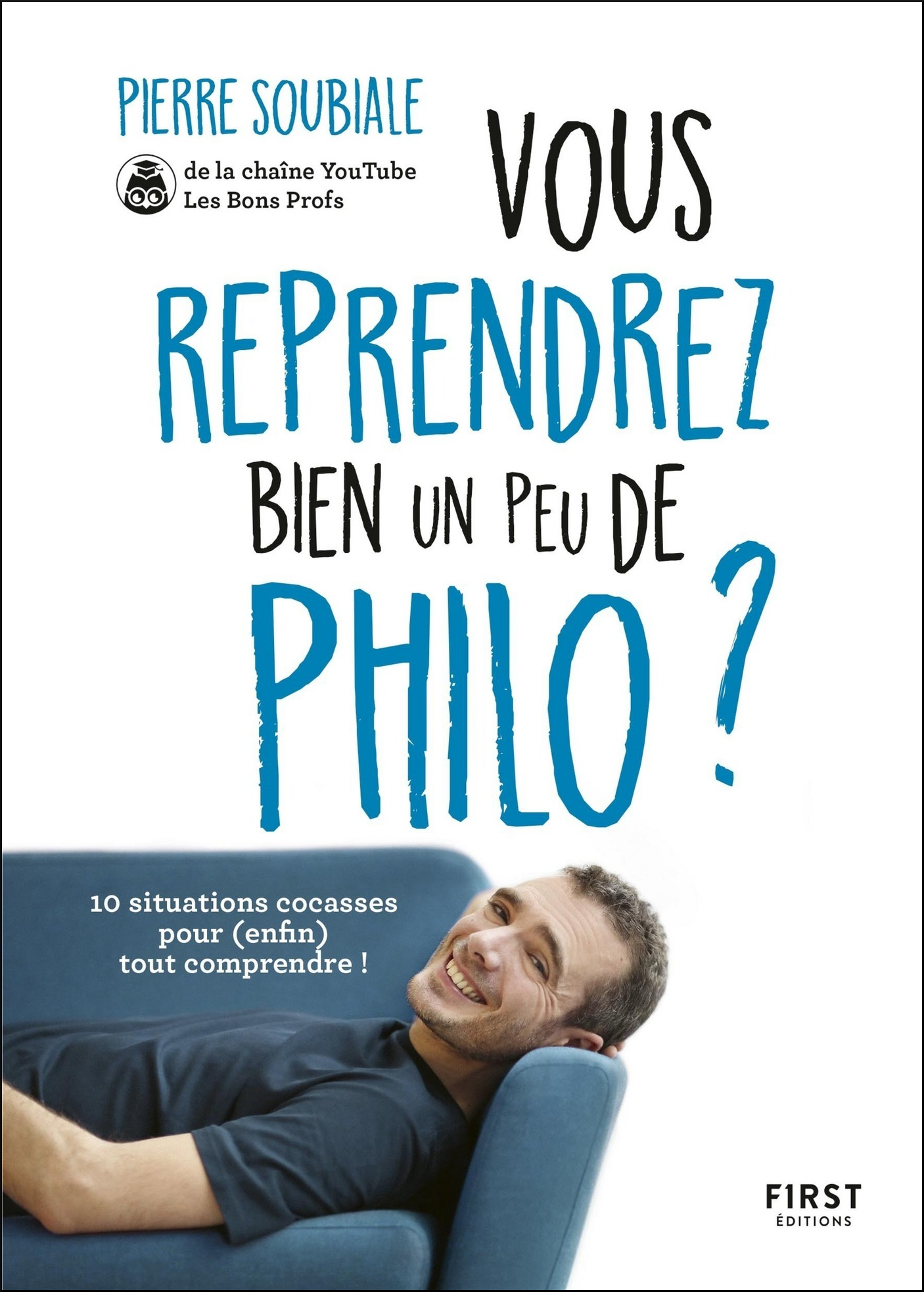


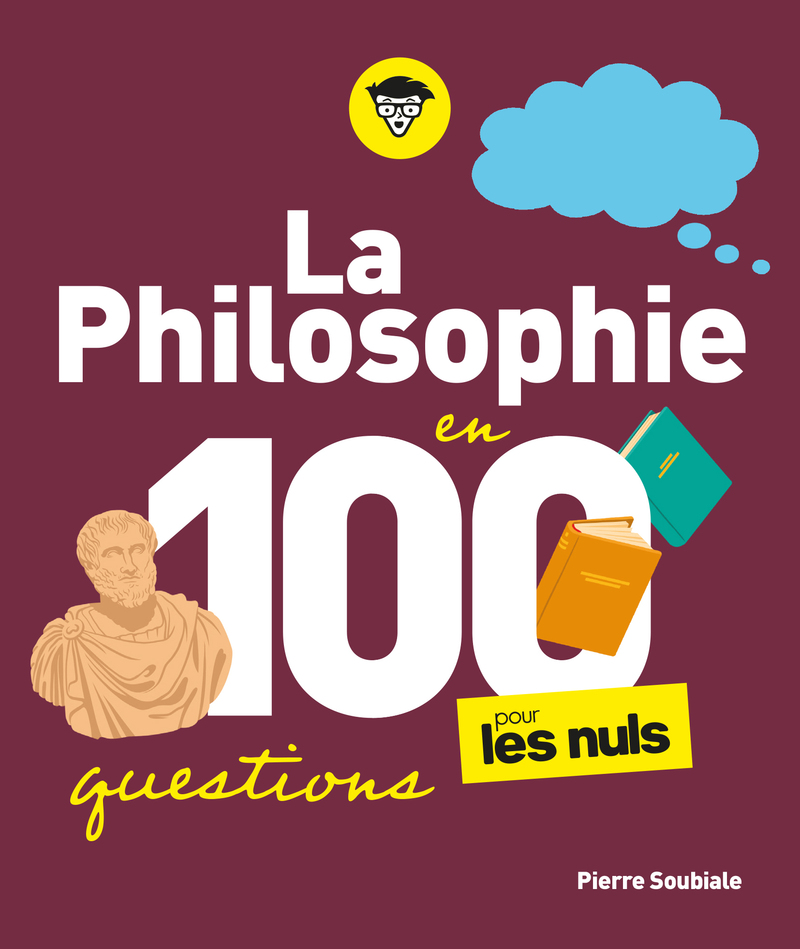
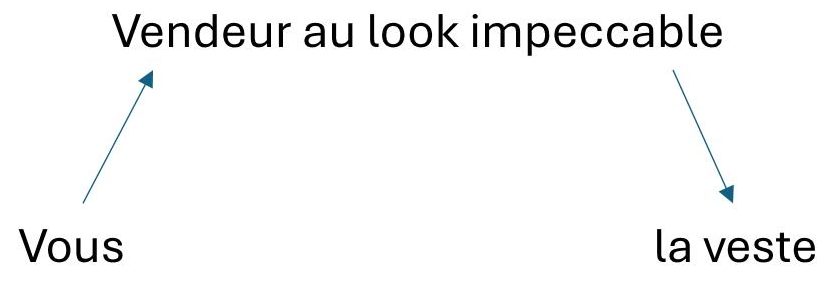

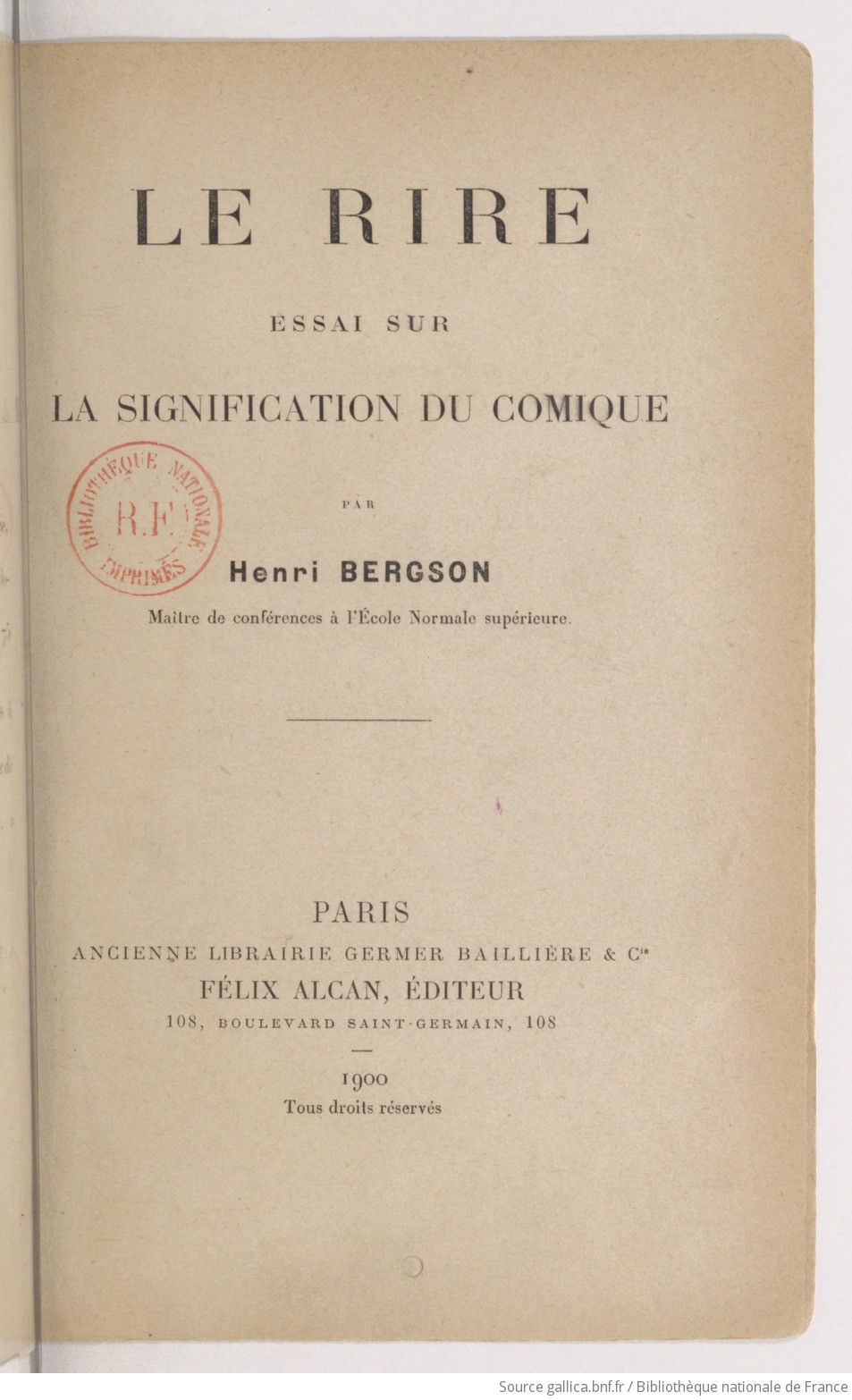





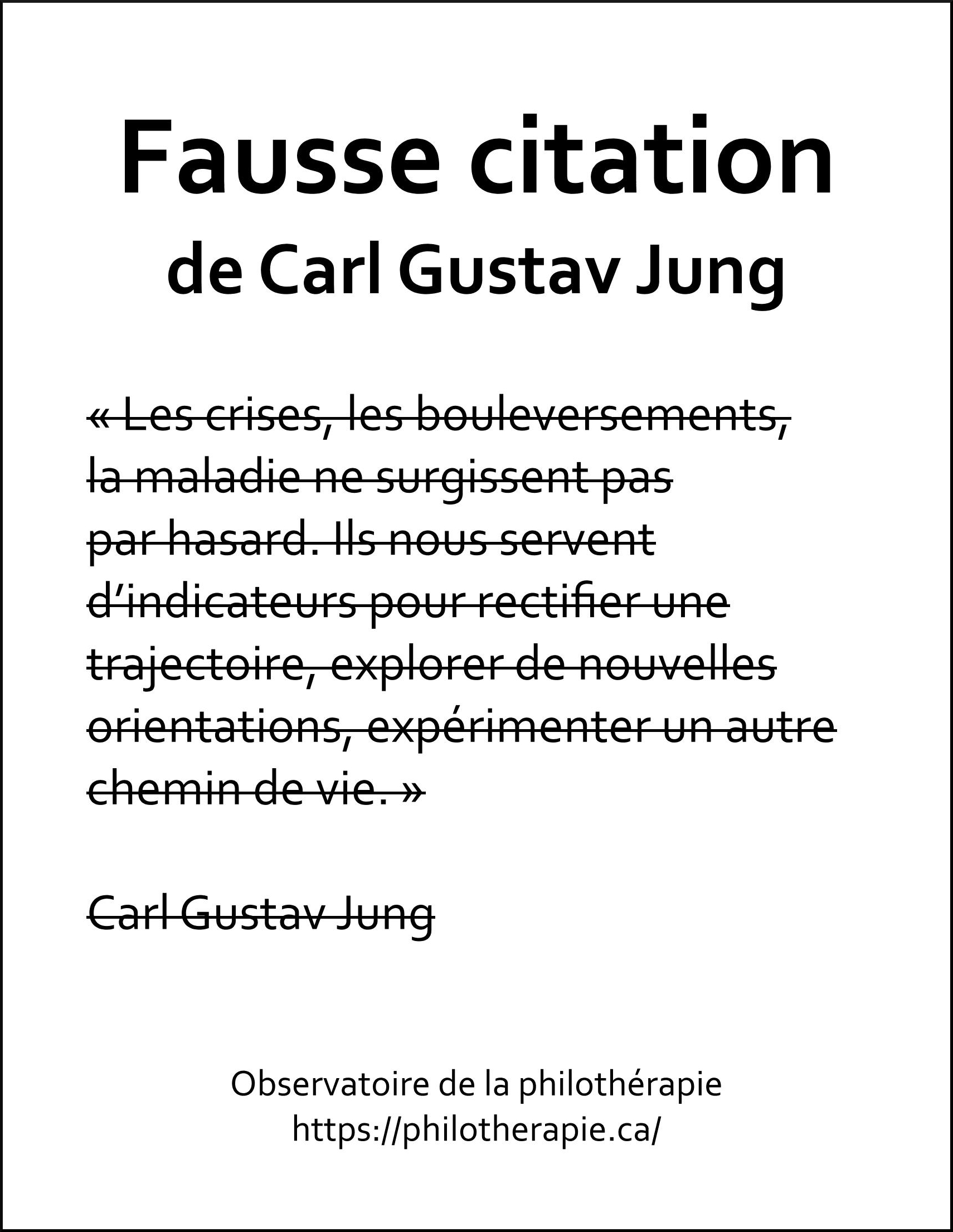














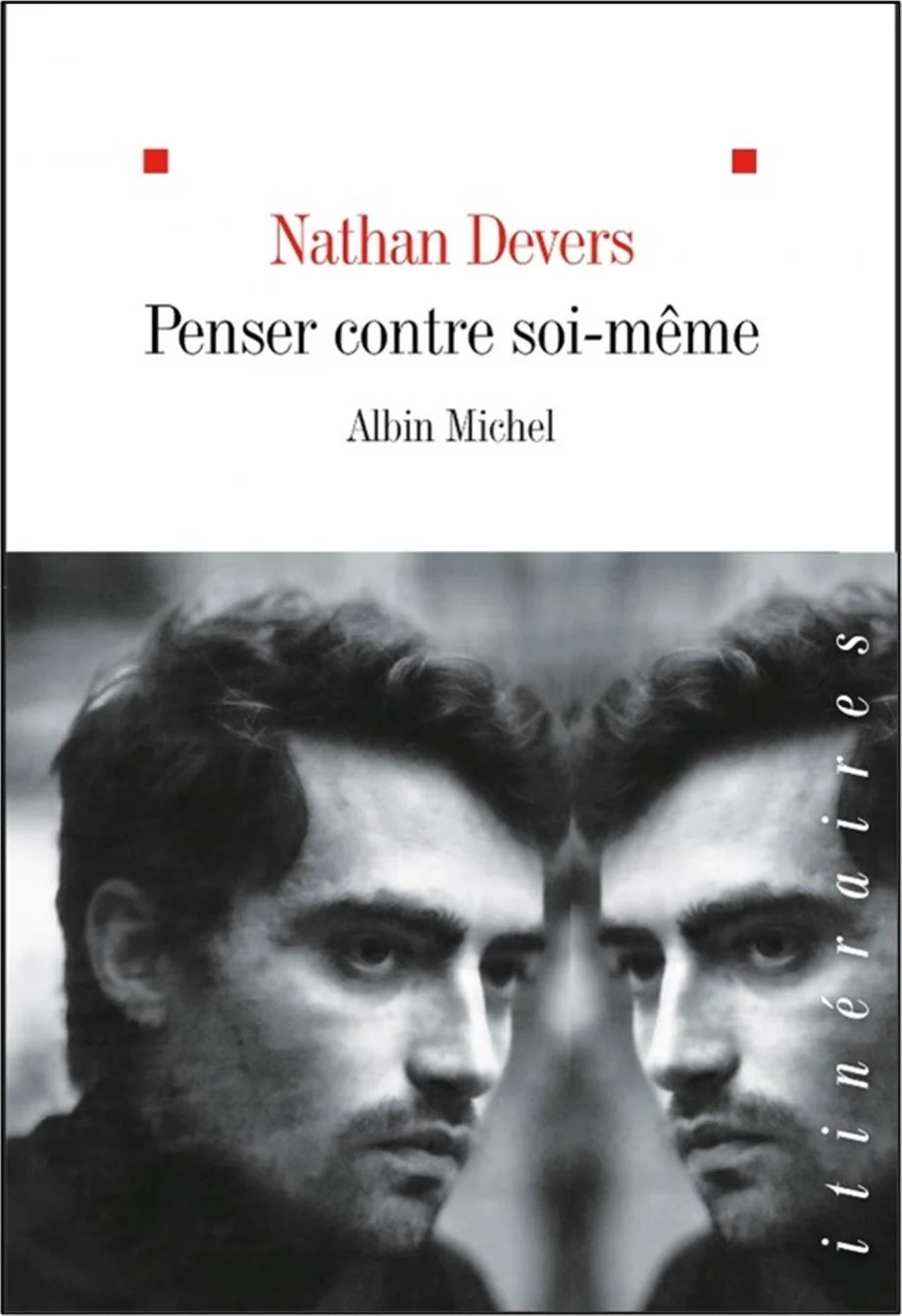


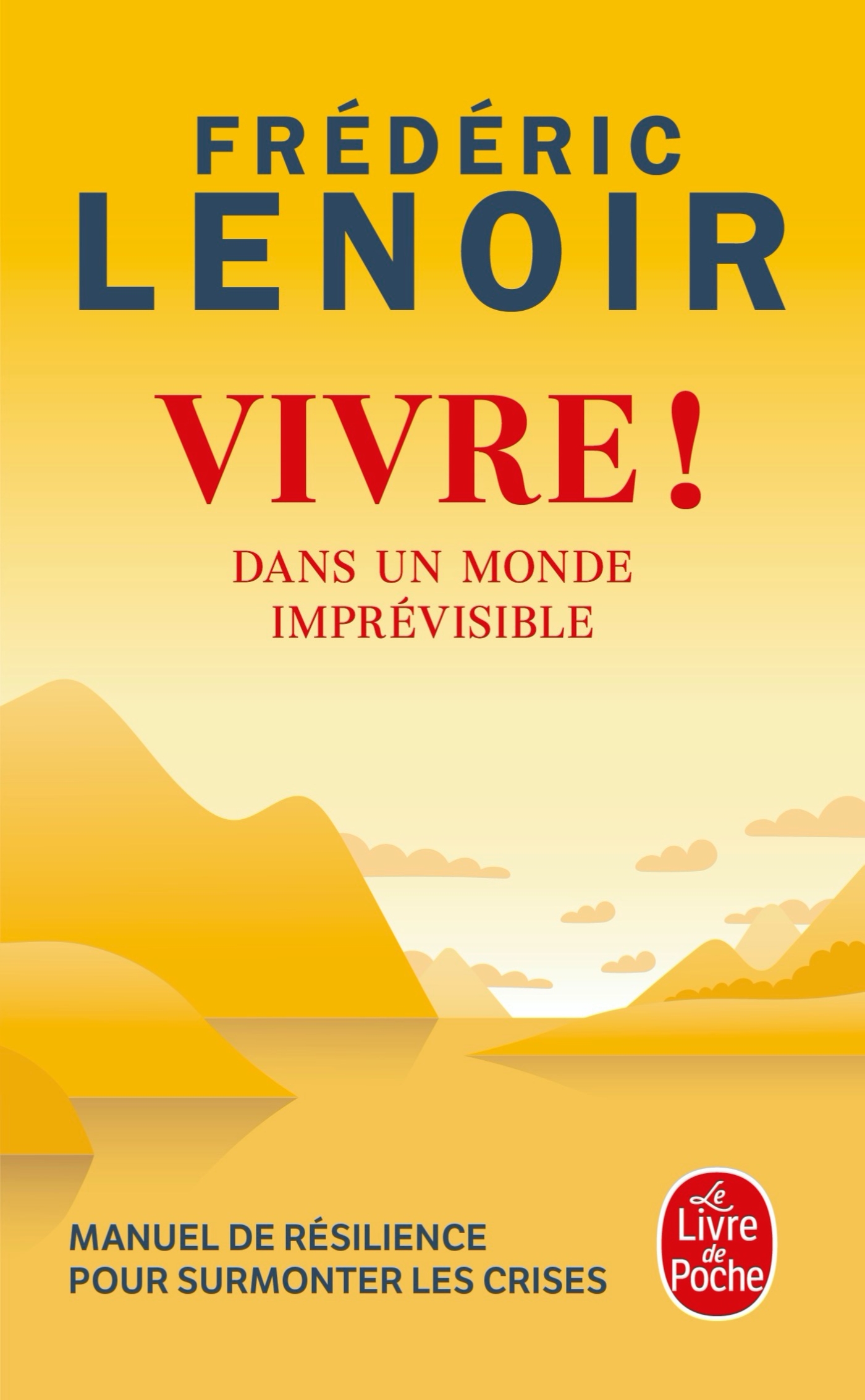




 Quelle est l’origine de la citation suivante : «Les crises, les bouleversements, la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d’indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. » de Carl Gustav Jung
Quelle est l’origine de la citation suivante : «Les crises, les bouleversements, la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d’indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. » de Carl Gustav Jung
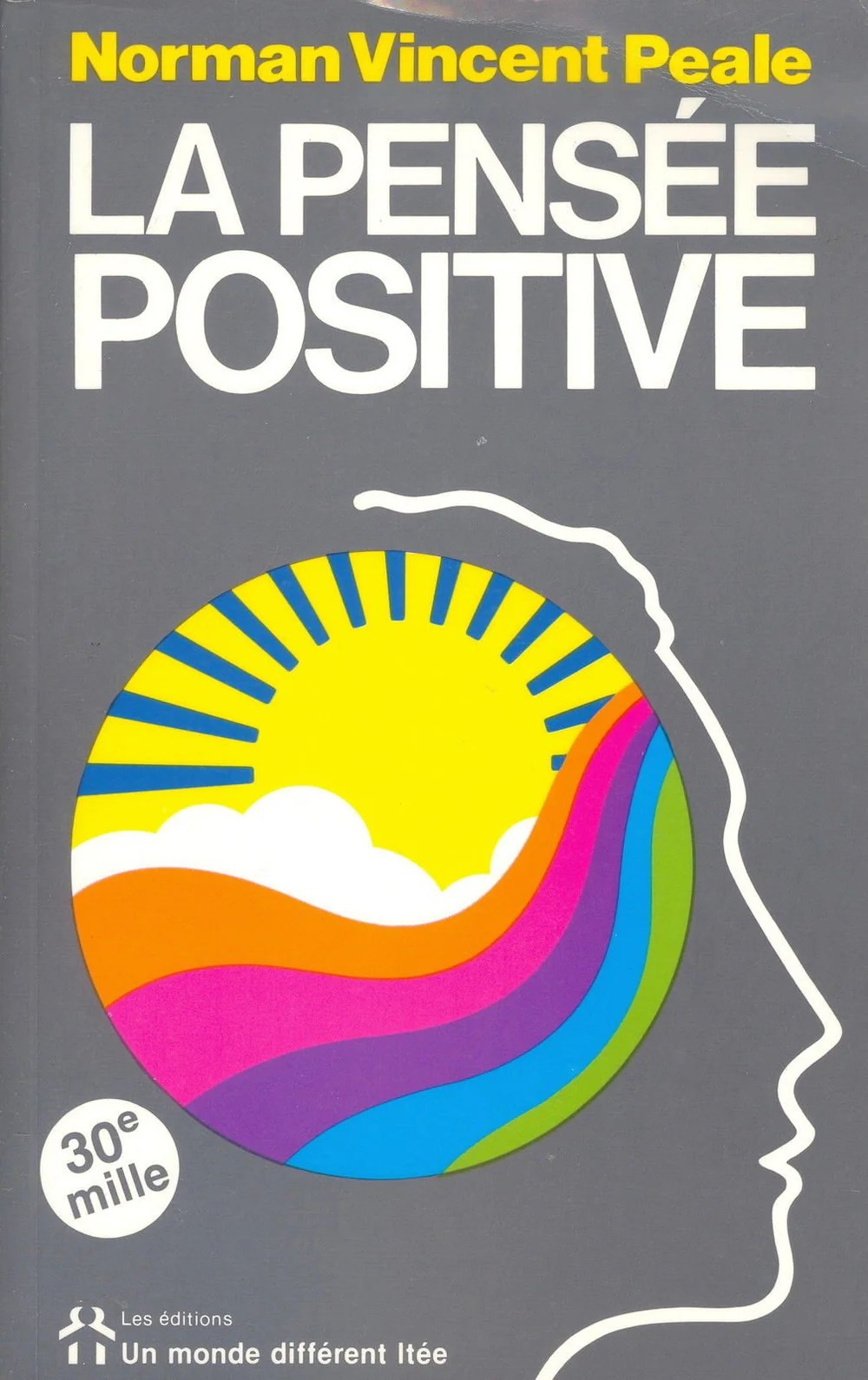
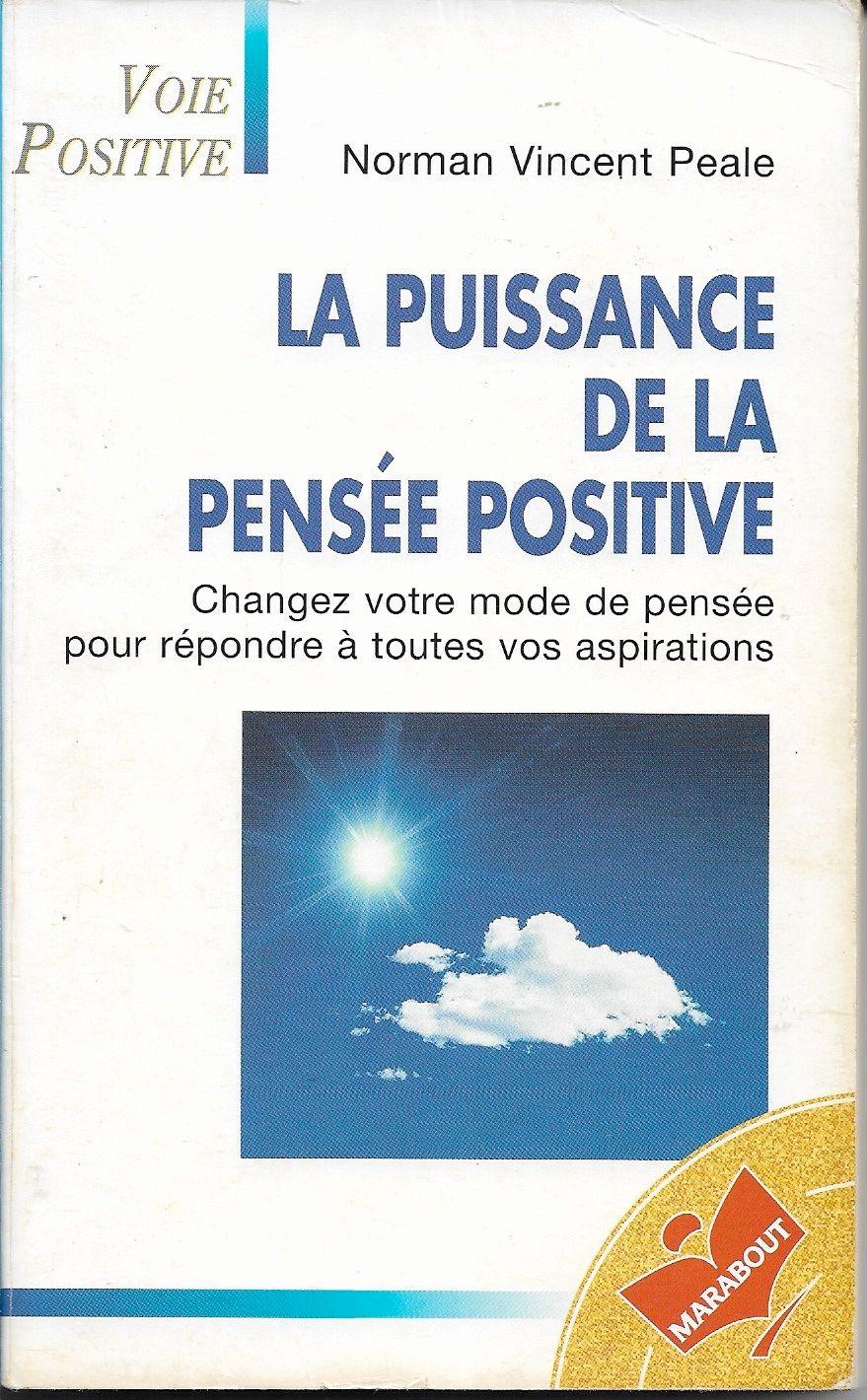

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.